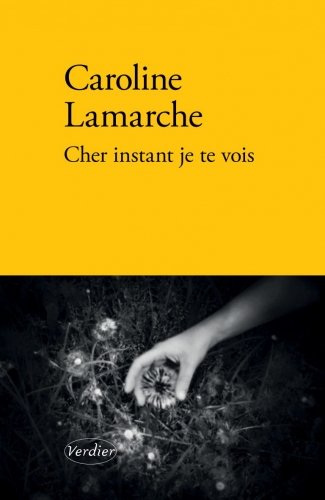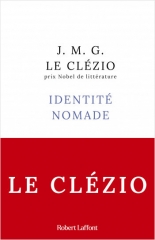Depuis la publication de Proust, roman familial (prix Médicis 2023) de Laure Murat, les éloges* se succèdent, mérités. L’entrée en matière va d’une scène de la série Downton Abbey à la spectatrice qui, à Los Angeles, réagit intensément à un détail, comme à « un signe lointain venu du passé, de l’enfance. » Il est soudain plus clair pour elle que l’aristocratie, le milieu où elle a grandi, « est un monde de pures formes ».

L’autrice travaillait alors à l’introduction d’un recueil d’articles sur Proust qu’elle souhaitait voir publiés, ce qui l’obligeait à évoquer ce monde « de gens titrés, de serviteurs et de gouvernantes, de privilèges, de hiérarchie et d’abondance » décrit dans A la recherche du temps perdu, un monde si proche de l’éducation familiale dont elle s’était radicalement éloignée : « Je n’ai pas d’enfants, je ne suis pas mariée, je vis avec une femme, je suis professeure d’université aux Etats-Unis, je vote à gauche et je suis féministe. »
Pourquoi tant de lecteurs dans le monde entier, « toutes catégories sociales confondues » désignent-ils Proust comme le plus grand écrivain français du XXe siècle ? Réponse de Laure Murat : « Car Proust, dans « ce roman qui n’arrête pas de penser » – le Temps, le moi, les arts, l’écriture, la jalousie, la phénoménologie –, à travers ce je du narrateur et personnage principal, nous restitue à nous-mêmes. » Lire la Recherche est pour elle un « retour aux sources d’une réalité par la fiction », c’est ce qu’elle raconte dans Proust, roman familial.
Sa conviction : « ce qui se transmet vraiment ne s’enseigne pas ». Elle s’est imprégnée dans son milieu d’une atmosphère, de comportements observés, d’un « impérieux silence » : ne jamais parler de soi, ne pas faire de vagues, éviter les sujets qui fâchent, mais « se tenir », à la fois une posture et une retenue, une manière de parler, avec de l’esprit et sans s’appesantir. D’où sa formule lapidaire pour définir le style aristocratique : « Rien, qui danse sur du vide. »
Pour ceux qui pourraient trouver abusif de décalquer « le roman familial de la fresque proustienne » (elle est née en 1967), elle rappelle qui étaient ses parents, mariés en 1960 : la fille aînée du duc de Luynes, descendant du favori de Louis XIII, sa mère, et le prince Napoléon Murat, arrière-arrière-petit-neveu de l’empereur, son père. Même si les titres nobiliaires avaient été abolis en 1789, à la maison ils étaient « le Prince » et « la Princesse », et son grand-père maternel, « Monsieur le Duc ». Le titre princier n’étant transmissible qu’aux filles, elle-même a pour identité « Laure, Marie, Caroline, Princesse Murat ». L’autrice en fait un commentaire amusant.
Pour les aristocrates chez qui il était reçu, Proust était considéré comme un « petit journaliste ». Laure Murat évoque quelques-uns d’entre eux et le salon de Madeleine Lemaire devenu dans la Recherche celui de Mme Verdurin. Remontant son propre arbre généalogique, elle y voit quelques liens ténus entre ce monde et celui de ses ancêtres, des ingrédients communs : « les mariages d’argent, les tensions entre noblesse d’Ancien Régime et noblesse d’Empire, les croisements avec « le sang juif », les détours clandestins par Sodome… »
Dans la Recherche, elle lit des noms qui lui sont familiers, des scènes plus vivantes que si elle les avait vécues. Les aristocrates sont toujours « en représentation » (Charlus en est l’exemple « superlatif ») dans un jeu de rôles permanent où il faut paraître « naturel ». Proust a écrit « la critique la plus cruelle et la plus subtile de l’aristocratie française à laquelle se soit jamais livrée la littérature. »
Par exemple, sur la « vulgarité » des nobles, elle cite et analyse formidablement un extrait, « Les souliers rouges de la Princesse de Guermantes ». A l’erreur de jugement de certains critiques de Proust qui ne voient dans son roman qu’un monument élevé au prestige aristocratique, elle donne deux raisons : la hauteur de vue de l’écrivain qui décrit, raconte et « suspend jusqu’à la dernière extrémité le jugement moral » et le préjugé de ceux qui ne l’ont tout simplement pas ou trop peu lu, comme l’attestent les chiffres de vente.
Pour Laure Murat, le fait que Proust prend « l’homosexualité au sérieux » a aussi été une délivrance. Elle a consacré une thèse sur ce sujet et ses recherches lui ont permis quelques découvertes sur l’auteur de la Recherche. Elle en rend compte, ainsi que des raisons pour lesquelles elle a quitté la maison à dix-neuf ans, devenant pour sa mère une « fille perdue ».
Entre le texte proustien qu’elle cite abondamment à l’appui de sa réflexion et l’examen des causes de la rupture avec les siens, Laure Murat donne dans Proust, roman familial, une approche inédite d’A la recherche du temps perdu et un récit d’émancipation, formidable témoignage de ce que la littérature peut signifier dans la vie réelle.
*Sur les blogs aussi, chez Adrienne, Aifelle, Claudialucia, Dasola, Dominique, Keisha...
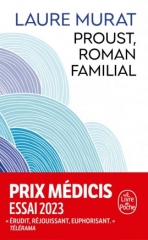 « Aujourd’hui, que peuvent bien signifier les codes du faubourg Saint-Germain pour des jeunes qui passent leur temps sur les réseaux sociaux ? Et quelle est leur capacité d’absorption de la phrase proustienne lorsque tout se tranche en cent quarante caractères ? Questions en réalité sans objet. Enseigner la Recherche à Los Angeles ou en Chine, c’est, pareillement, éprouver l’universalité d’un texte qui fait s’effriter tous les particularismes culturels, d’âge, de classe. Depuis vingt ans, un groupe se retrouve régulièrement dans un café de Buenos Aires pour lire le même livre, indéfiniment : En busca del tiempo perdido. Ce book club d’un genre particulier a fait l’objet d’un documentaire, Le Temps perdu (2020), de Maria Alvarez. On y voit une dame élégante au regard vif déclarer : « Tout ce qui se passe dans ce roman, à un moment donné de ma vie, je l’ai ressenti. Tout. » Cette phrase, n’importe qui, dans le monde entier, peut la prononcer. »
« Aujourd’hui, que peuvent bien signifier les codes du faubourg Saint-Germain pour des jeunes qui passent leur temps sur les réseaux sociaux ? Et quelle est leur capacité d’absorption de la phrase proustienne lorsque tout se tranche en cent quarante caractères ? Questions en réalité sans objet. Enseigner la Recherche à Los Angeles ou en Chine, c’est, pareillement, éprouver l’universalité d’un texte qui fait s’effriter tous les particularismes culturels, d’âge, de classe. Depuis vingt ans, un groupe se retrouve régulièrement dans un café de Buenos Aires pour lire le même livre, indéfiniment : En busca del tiempo perdido. Ce book club d’un genre particulier a fait l’objet d’un documentaire, Le Temps perdu (2020), de Maria Alvarez. On y voit une dame élégante au regard vif déclarer : « Tout ce qui se passe dans ce roman, à un moment donné de ma vie, je l’ai ressenti. Tout. » Cette phrase, n’importe qui, dans le monde entier, peut la prononcer. »