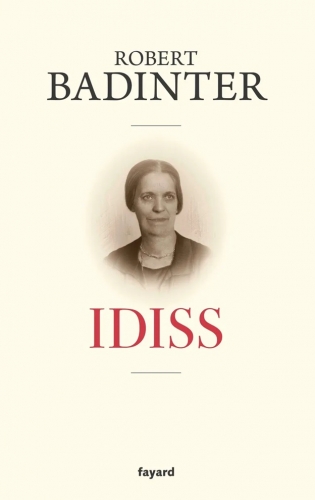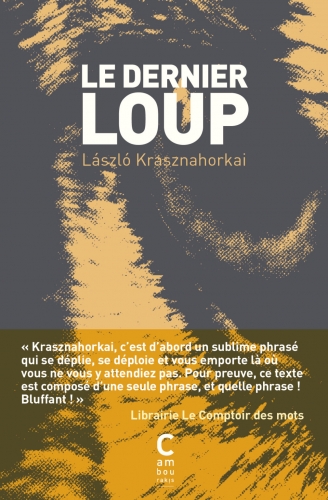De Robert Badinter ((1928-2024), mon souvenir le plus vif est certainement sa présentation à l’Assemblée nationale française, en tant que ministre de la Justice, du projet de loi abolissant la peine de mort, le 17 septembre 1981. J’ai pu suivre cette séance à la télévision et écouter sa voix claire et solennelle (vidéo disponible sur le site de l’INA). Son nom s’inscrira au Panthéon le 9 octobre prochain, la cérémonie coïncidera avec le 44e anniversaire de l’abolition de la peine de mort en France. (Celle-ci existait en Belgique depuis 1830. Son application était rare et la dernière exécution a eu lieu en 1950. Elle fut abolie en 1996.)
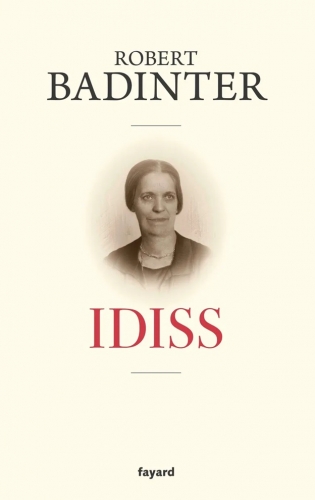
Cette clarté se retrouve sous sa plume pour rendre hommage dans Idiss (2018) à sa grand-mère maternelle. Idiss « était née en 1863 dans le Yiddishland, à la frontière occidentale de l’empire russe. » Après le départ de son mari à l’armée du tsar, seule avec ses deux fils, elle a dû vivre chez ses beaux-parents, pauvres comme Job. Elle brodait nappes et serviettes et allait les vendre au marché, sans grand succès. Un colporteur lui a proposé de participer à son commerce clandestin de tabac en allant par le bois jusqu’à la frontière roumaine toute proche. Dix roubles pour chaque aller et retour. Elle n’avait rien à craindre des douaniers avec lesquels il avait un arrangement.
Par nécessité, elle « devint contrebandière » pendant quelques mois, jusqu’à ce que le gendarme du village, sous la pression du capitaine qui réclamait des sanctions pour ce trafic, lui propose de l’arrêter une fois par quinzaine (une nuit en cellule et une petite amende) – « et tout le monde est content. »
Schulim, son mari, réapparut après cinq ans d’absence. « Du bonheur des retrouvailles naquit ma mère, Chifra. » Dans l’armée, il avait contracté la passion du jeu et bientôt, il accumulait pertes et dettes. Idiss devait tenir la bourse. Schulim devint tailleur et elle, vendeuse d’articles « de Paris ». Pour les juifs de Bessarabie, la menace de l’antisémitisme était toujours présente. L’Amérique attirait, et les grandes villes européennes : Paris, Berlin, Vienne.
Leurs fils Avroum et Naftoul, 23 et 21 ans, choisirent Paris, comme leurs cousins. Seul l’aîné avait fait des études secondaires. Ils firent du commerce de vêtements usagés, envoyaient des mandats. Badinter décrit le désir d’ascension sociale des juifs de France, l’importance des bonnes études : les idéaux de la République française comptaient bien plus que la religion. Leurs fils encouragent leurs parents à venir les rejoindre, mais Idiss hésite : elle est illettrée. Il faudra une dette colossale de son mari pour les obliger à vendre la maison et partir.
Chifra, sa fille, devint Charlotte à l’école. En 1923, elle épousera Simon, anciennement Samuel ; ils vivront avec Idiss, devenue veuve. Pour leurs enfants, ils choisiront des prénoms français, Claude et Robert. Simon était travailleur, Charlotte ambitieuse, ils développèrent avec succès un négoce de fourrures. « Leur ascension sociale fut rapide. »
Robert Badinter, « le dernier-né des petits-enfants d’Idiss », raconte les étapes d’une vie de famille. Leur mère surveille les résultats scolaires, fait donner des cours particuliers, des cours de piano ; son frère et lui reçoivent une éducation bourgeoise. Idiss les conduit à l’école. C’est surtout la situation de sa grand-mère et son rôle qu’il décrit, dans un contexte familial et social, politique aussi, qui évolue. Depuis la Bessarabie natale, ses conditions de vie avaient beaucoup changé. Son petit-fils écrit : « ces juifs de nulle part se trouvaient chez eux partout, pourvu qu’ils fussent avec les leurs. »
Quand les menaces contre les juifs de France sont devenues de plus en plus violentes, dans les années 1940, sa mère, qui n’avait jamais voulu se séparer d’Idiss, a pourtant dû s’y résoudre, pour sauver ses fils. Malade, la grand-mère est restée à Paris sous la garde de son fils Naftoul, elle y est morte quelques mois plus tard, en avril 1942, en pleine Occupation. « C’était le temps du malheur. »
Ce livre, écrit Badinter, « ne prétend être ni une biographie, ni une étude de la condition des immigrés juifs de l’Empire russe venus à Paris avant 1914. Il est simplement le récit d’une destinée singulière à laquelle [il a] souvent rêvé. Puisse-t-il être aussi, au-delà du temps écoulé, un témoignage d’amour de son petit-fils », peut-on lire sur le site de l’éditeur. Mission accomplie.
 « Le deuil que je porte n’est donc pas celui, classique sinon banal, et exemplaire, d’une femme aimée. Mais je reconnais que, tout en ayant trouvé précisément l’amour ailleurs, et donc le bonheur à l’heure où j’écris, Véronique a emporté avec elle une sorte de joie, une sorte de connaissance, une sorte de regard, comme une sorte d’interrogation dont je me retrouve aujourd’hui privé et donc veuf. Comme si elle avait, bien malgré elle, la pauvre, désenchanté une part du territoire de ma vie que je pensais pourtant avoir conquis pour toujours. »
« Le deuil que je porte n’est donc pas celui, classique sinon banal, et exemplaire, d’une femme aimée. Mais je reconnais que, tout en ayant trouvé précisément l’amour ailleurs, et donc le bonheur à l’heure où j’écris, Véronique a emporté avec elle une sorte de joie, une sorte de connaissance, une sorte de regard, comme une sorte d’interrogation dont je me retrouve aujourd’hui privé et donc veuf. Comme si elle avait, bien malgré elle, la pauvre, désenchanté une part du territoire de ma vie que je pensais pourtant avoir conquis pour toujours. »