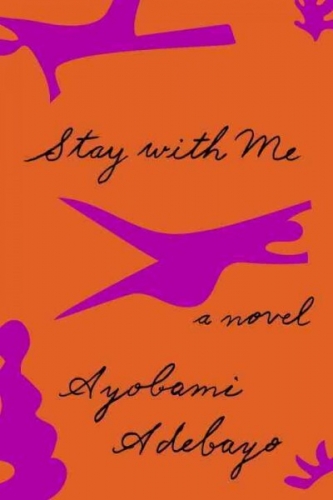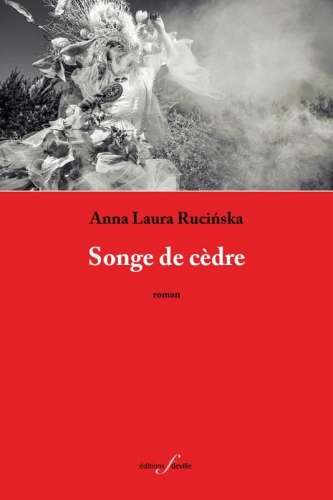Le succès de son premier roman, Reste avec moi (2019, traduit de l’anglais par Josette Chicheportiche, 2021), a fait connaître Ayobami Adebayo, une journaliste et romancière nigériane qui « a étudié l’écriture aux côtés de Chimamanda Ngozi Adichie et Margaret Atwood » (4e de couverture). Il y a dans ce roman sur le désir d’enfant des phrases difficiles à lire pour qui n’en a pas, comme ce sentiment de l’héroïne quand elle est enfin enceinte : « J’étais devenue immortelle, un maillon de la chaîne des êtres humains. »
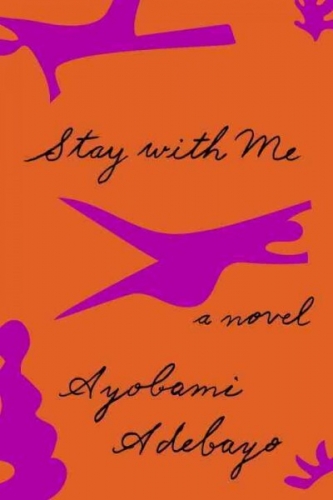
Le récit s’ouvre en 2008, quand Yejide, la narratrice, ses valises prêtes pour un déménagement, s’adresse à son mari, Akin, qu’elle va revoir avant de quitter la ville. Puis leur histoire remonte à 1985, quand Iya (mère, en dialecte yoruba) Martha et ses trois autres mères (sa mère biologique étant morte à sa naissance) rendent visite au jeune couple à Ilesha pour « discuter de choses importantes ». Avec leurs maris, elles viennent présenter une jeune femme à la peau claire et aux lèvres fines : « Eh bien, première femme d’Akin, voici la nouvelle épouse de ton mari. C’est une enfant qui appelle un autre enfant à venir au monde. (…) Une fois qu’elle tombera enceinte et aura une progéniture, nous sommes persuadés que tu en auras une aussi. »
Yejide s’attendait à de nouvelles plaintes sur l’absence d’enfant, quatre ans après leur mariage, et s’était armée de sourires, mais pas à l’arrivée de la toute jeune Funmi ni au calme apparent d’Akin qui ne lui avait parlé de rien. Après qu’il a reconduit leurs visiteurs chez eux, la dispute éclate à son retour. On découvre son point de vue dans les chapitres où il devient le narrateur, en contrepoint des états d’âme de sa femme.
Pour lui, parmi « la kyrielle de filles » que sa mère a fait défiler dans son bureau, Funmi était le choix idéal : « elle était la seule qui ne tenait pas à emménager avec Yejide et moi. Et qui ne demandait pas grand-chose. Du moins au début. » Le compromis prévoyait qu’elle vive dans son propre appartement, à des kilomètres, qu’il passe un week-end par mois avec elle et lui verse une pension « raisonnable », sans plus.
Akin travaille dans une banque à Lagos, du moins quand il n’y a ni troubles ni coup d’Etat. Yejide possède un salon de coiffure – elle tressait déjà des cheveux pendant ses trois années d’université – où l’ambiance est chaleureuse : les clientes racontent des blagues, y passent des heures. Ses « filles » (les coiffeuses) la retiennent quand Funmi se présente au salon et parle devant les autres de sa stérilité.
La sérénité du couple a pris fin. Yejide ne supporte pas la trahison de son mari qui cherche surtout à ne pas avoir d’ennuis. Quand la mère d’Akin finit par la supplier, elle aussi, de ne pas laisser son fils « sans enfants », Yejide se décide à gravir la Montagne de l’Epoustouflante Victoire pour consulter « un faiseur de miracles », qui la rassure. Quelque temps plus tard, Yejide annonce qu’elle est enceinte.
Akin lui reproche d’être allée chez un charlatan et s’inquiète quand elle n’a plus ses règles – est-elle allée avec un autre homme ? Il ne l’a plus touchée depuis des mois. Partout elle annonce sa grossesse, mais à la première échographie, les machines montrent qu’il n’y a « pas de bébé » dans son utérus, ce qui la rend furieuse. Elle dit sentir ses coups de pied, son ventre s’arrondit, Yejide ne veut pas croire à cette grossesse nerveuse qui dure… plus de neuf mois.
Reste avec moi (traduction du prénom d’Olamide, sa première fille) raconte les multiples épreuves que Yejide rencontre sur son parcours d’épouse et mère – on découvrira comment elle tombera vraiment enceinte et comment les enfants mis au monde lui seront arrachés d’une manière ou d’une autre, pour son malheur. Si Akin est lui aussi sommé de devenir père, l’infertilité est d’office mise au compte de sa femme.
Cette histoire dramatique témoigne à la fois des problèmes de couple et des prétendus arrangements (qui n’arrangent rien) dus à la pression familiale et sociale. « Intelligent, subtil, bien écrit, audacieux, neutre. On ne peut que saluer le choix du jury du Prix les Afriques pour l’édition 2020 » écrit Gangoueus sur son blog de lecture.
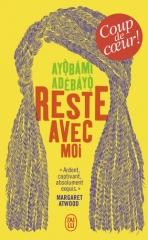 « Les raisons pour lesquelles nous accomplissons certains actes ne sont pas toujours celles dont [sic] les autres se rappelleront. Parfois, je me disais qu’on avait des enfants parce qu’on voulait laisser derrière soi quelqu’un qui puisse expliquer qui nous étions une fois que nous ne serions plus là. Si Oluronbi avait vraiment existé, je ne pensais pas qu’elle aurait eu d’autres enfants après Aponbiepo. L’histoire aurait été plus indulgente à son égard si quelqu’un avait été là pour conserver son souvenir. Je racontai ainsi beaucoup d’histoires à Olamide, en espérant qu’elle aussi, un jour, raconte la mienne. »
« Les raisons pour lesquelles nous accomplissons certains actes ne sont pas toujours celles dont [sic] les autres se rappelleront. Parfois, je me disais qu’on avait des enfants parce qu’on voulait laisser derrière soi quelqu’un qui puisse expliquer qui nous étions une fois que nous ne serions plus là. Si Oluronbi avait vraiment existé, je ne pensais pas qu’elle aurait eu d’autres enfants après Aponbiepo. L’histoire aurait été plus indulgente à son égard si quelqu’un avait été là pour conserver son souvenir. Je racontai ainsi beaucoup d’histoires à Olamide, en espérant qu’elle aussi, un jour, raconte la mienne. »