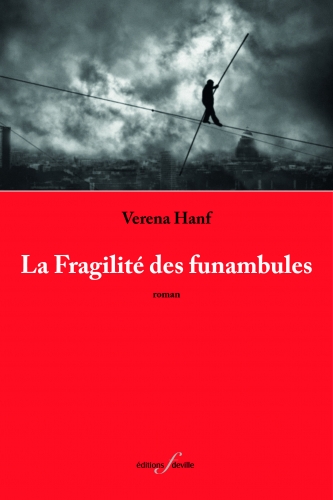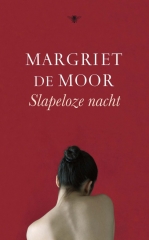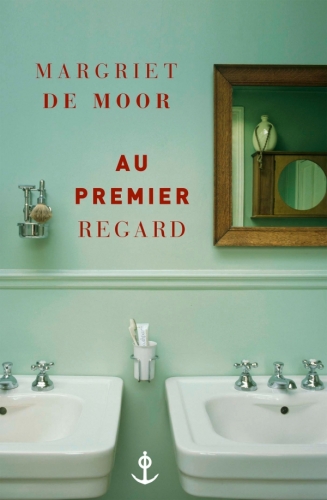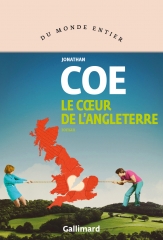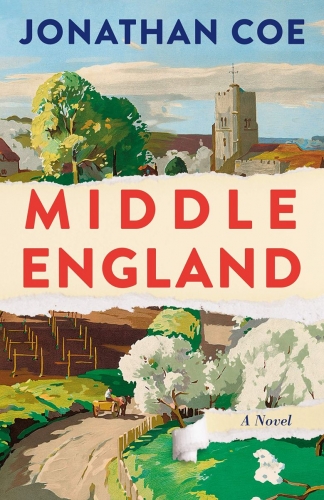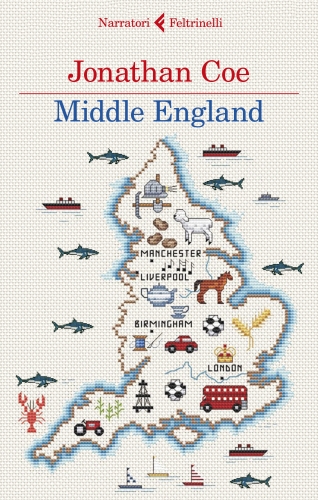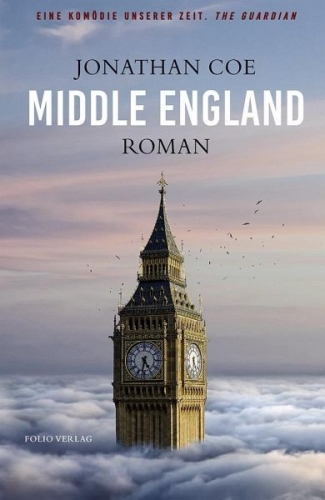Verena Hanf, de livre en livre, dessine la toile des relations humaines dans notre société. La fragilité des funambules, qui vient de paraître à Bruxelles, montre le difficile équilibre à garder dans nos rapports avec les autres, quand les tensions ne manquent pas d’apparaître, parfois pour un rien, le plus souvent pour des raisons profondes.
En voici la belle épigraphe, tirée du Loup des steppes de Hermann Hesse : « En réalité, aucun moi, même le plus naïf, n’est une unité, mais un monde extrêmement multiple, un petit ciel étoilé, un chaos de formes, de degrés et d’états, d’hérédités et de possibilités. »
Au centre du roman, dont l’histoire se déroule en passant du point de vue d’un personnage à l’autre, Adriana. Cette jeune femme roumaine s’occupe pendant la journée de Mathilde, la petite fille d’un couple d’expatriés allemands, parfois excédée par cette « grenouille grincheuse » née dans « cette famille trop riche, dans cette maison trop vaste, dans cette banlieue trop propre, un biotope de bourges ».
Six heures et demie. Adriana en veut à son employeuse, Nina, une psychothérapeute, de rentrer à nouveau en retard : elle a besoin de respirer, de prendre le bus assez tôt pour pouvoir téléphoner de chez elle à ses parents ; elle voudrait entendre la voix de son garçon, Cosmin, avant qu’il soit au lit. Elle l’a laissé au pays à la garde de ses grands-parents, elle n’a plus entendu sa voix depuis plusieurs jours.
Nina, pendant ce temps-là, soupire dans les embouteillages bruxellois, fatiguée de sa dernière patiente « qui ne voulait plus se taire ». En rentrant, elle se préparera « un énorme plat de pâtes » ; il faudra aussi de la salade pour son mari, Stefan, « apôtre du manger-sain » à qui ce genre de nourriture déplaît. Très pris par son travail de juriste, elle le juge trop peu présent auprès de leur fille.
Heureusement, elle peut compter sur Adriana, « une vraie perle, fiable » que la petite adore – Nina l’admire aussi, pour ses qualités et pour son courage. Adriana lui a confié un jour l’horreur qu’elle a vécue. Cosmin est né d’un viol collectif, onze ans plus tôt. Elle a laissé l’enfant chez ses grands-parents, qui prennent bien soin de lui.
Mathilde pleure facilement quand elle est contrariée, quand sa nounou la brusque, quand ses parents se disputent, quand sa mère est trop fatiguée pour lui lire une histoire le soir. Bien qu’énervée, Adriana tâche de se radoucir pour rassurer l’enfant. Elle se sait souvent trop sur la défensive. Elle s’inquiète de son garçon qui ne parle pas beaucoup au téléphone, même si « les mecs ne sont jamais bavards », comme dit son copain Gaston pour la rassurer.
Une soirée telle que la ressent Nina, s’efforçant à la patience, se versant un grand verre de vin pour se détendre, pour rester conciliante, a peu à voir avec ce que se dit Stefan de son côté. Celui-ci trouve toujours une raison de la critiquer, s’irrite dès qu’elle boit trop ou qu’elle lui reproche de trop peu s’occuper de Mathilde. Il préfère souvent s’isoler à l’étage, aller dormir.
Ce qui bouleverse leur routine avec son lot de frustrations, c’est la chute de la mère d’Adriana qui s’est cassé le pied. Du coup, son père exige qu’elle vienne chercher le petit, qu’elle s’occupe elle-même de son fils. Adriana est « abasourdie » : comment faire dans son minuscule appartement ? à son travail ? Comment bien s’occuper de lui dans cette ville étrangère et dangereuse pour un enfant pas habitué au trafic ? Comment réagira-t-il en découvrant Gaston ?
Verena Hanf / photo © Mareille Landau
Verena Hanf campe ses personnages dans leur situation à la fois personnelle et sociale, nous rend curieux du sort de chacun. Adriana ne se comporte pas en victime, souvent la boule au ventre la rend prompte à la colère, mais elle tâche de garder le contrôle, tout en ruminant une vengeance. Nina n’est pas heureuse avec son mari distant, égocentrique, bien que leur vie soit confortable. Le sympathique Gaston se montre plein d’empathie pour Adriana. La place des enfants, le rôle des grands-parents roumains, tout cela est rendu avec justesse et sensibilité.
La fragilité des funambules de Verena Hanf est « un roman actuel qui évoque la diversité sociale d’une grande ville et le pouvoir des préjugés », indique l’éditeur bruxellois. Le titre convient à tous ces personnages sur le fil de leur vie (comme Alma dans La griffe) et d’abord à Adriana, dans un pays étranger où les regards sur elle ne sont pas toujours bienveillants.