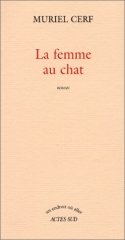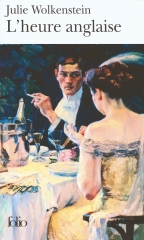Dans Le jeu des ombres (Shadow Tag, 2010, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Isabelle Reinharez), Louise Erdrich raconte la crise d’un couple et d’une famille, en quelques mois de 2007 à 2008. La narration se partage entre le carnet bleu et l’agenda rouge tenus par Irène, à la première personne, et le récit d’un narrateur externe. Irène America et Gil, son mari peintre, ont trois enfants : Florian, Stoney et Riel.
Le jeu est dévoilé dès la première page : depuis la naissance de Florian en 1994, Irène écrit au jour le jour dans un agenda rouge comme celui que Gil lui avait offert alors pour y consigner sa première année en tant que mère. Les anciens sont cachés au fond d’un tiroir et le dernier, elle le sait, Gil s’est mis à le chercher et à le lire afin de découvrir si elle le trompe. Aussi tient-elle à présent un second journal, le « véritable », dans un carnet bleu pour lequel elle a loué un coffre à l’agence bancaire, et c’est là qu’elle écrit en secret.
En son absence, Gil descend de son atelier pour ouvrir le tiroir du bureau de sa femme au sous-sol. La veille, elle a noté dans l’agenda rouge quelques observations sur les enfants et puis cette phrase : « Je crois que je vais perdre la tête à cause de ce que je fais. » Gil est curieux et furieux de ce que sa femme lui cache. « De dix ans sa cadette », Irène est le sujet de ses tableaux « dans toutes ses incarnations – mince et virginale, une jeune fille, puis femme, enceinte, nue, dans des poses sages ou franchement pornographiques. » Ses portraits se vendent très cher et l’ont rendu célèbre. Gil est fier de pouvoir faire vivre sa famille grâce à son travail.
Mais depuis des années, leur amour est devenu douloureux, jusque dans leur façon plus violente de faire l’amour. Sa femme lui semble indifférente à son égard et pourtant « Irène avait dû l’aimer énormément pour lui donner des enfants alors que ses racines tribales – un méli-mélo de Klamath, de Cree et de Chippewa sans terres du Montana – n’étaient pas reconnues. » Irène et lui boivent de plus en plus, et trop, ils s’en rendent compte.
A table, Gil interroge les enfants sur leur journée. Stoney, six ans, a peint. « Euh, des décors. Pour une pièce. » Son père lui demande de reformuler sans « euh » et par une phrase entière, l’enfant vacille, Irène vient au secours de son fils timide. Quand Gil veut savoir où en est son travail sur les ours bruns, Stoney corrige : sur les loups. A ce moment, Irène se souvient d’avoir noté les ours par erreur dans l’agenda et se sent mal. Riel, leur fille, s’inquiète aussitôt pour sa mère, qui monte se faire couler un bain chaud : elle aime le contact de l’eau, sa nudité, la solitude – exister sans être observée l’apaise. Les chiens dorment dans l’entrée, au pied de l’escalier.
Irène est une femme impressionnante, « élancée, grande, brune de peau », les cheveux en bataille, un maquillage vif quand elle sort avec Gil. Le lendemain, pendant que Gil s’occupe du petit déjeuner, elle rassemble les affaires des enfants, prépare leurs sacs, enfile un énorme manteau pour les emmener à l’arrêt du bus, puis prolonge la promenade avec les chiens, en réfléchissant. « Si Gil ne savait pas qu’elle savait qu’il lisait son journal, elle pouvait y écrire des choses visant à le manipuler. Et même à lui faire du mal. Elle se dit qu’elle commencerait par un simple essai, un hameçon irrésistible. »
Poser pour Gil lui pèse de plus en plus, vu la manière dont il la représente. « L’image n’est pas la personne, songea-t-elle, ni même l’ombre d’une personne. » Tous deux boivent durant les séances à l’atelier pour supporter la tension. Irène voudrait que Gil retourne voir un psy. Elle regrette que sa mère Winnie Jane, une ojibwé, ne soit plus là. Gil, en s’appropriant son image, marche sur son ombre et elle a beau s’écarter, « impossible de dégager cet écheveau d’obscurité de sous son pied. »
Le jeu des ombres raconte leur relation de plus en plus difficile et la manière dont leurs enfants, qui le ressentent, se rapprochent les uns des autres pour se rassurer. Chacun a ses trucs : Florian, doué pour les maths, se passionne pour la science ; Stoney dessine ; Riel s’intéresse à son héritage indien et demande à sa mère de le lui transmettre. Dans un désarroi profond vis-à-vis de Gil, dont elle souhaite se séparer, Irène rencontre par hasard May et découvre qu’elle est sa demi-sœur. Quelqu’un qui la soutiendra ?
La peinture occupe une grande place dans la vie du couple et dans le roman, mêlée à l’amour-haine qui s’exaspère entre mari et femme et inquiète leurs enfants. Que veut vraiment Irène et comment Gil va réagir, espérant qu’elle renonce à l’éloigner, c’est l’enjeu de cette histoire, une guerre psychologique où chacun des protagonistes a sa part secrète.