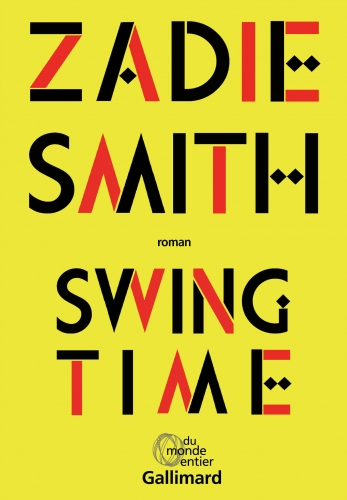Quand vous entrez aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB), vous ne pouvez pas manquer d’admirer, dans l’immense forum, une peinture monumentale de Constant Montald. Il me semble qu’il s’agit de La Fontaine de l'inspiration, dont un détail figure sur la page d’accueil des MRBAB ou bien de La barque de l'Idéal qui figure sur cette photo des Journées du Patrimoine. Les MRBAB viennent de rouvrir leurs portes. On peut à nouveau visiter, dans un premier temps, les salles du Musée d’art ancien devenu « Old masters museum ».

Constant Montald, La fontaine de l'inspiration, 1907, huile sur toile,
535 x 525 (dimensions d'origine) ; 393 x 490 (sans châssis), Bruxelles, MRBAB
Une exposition Constant Montald (1862-1944) a été présentée en 1982 à la Médiatine du Château Malou (Woluwe-Saint-Lambert) : « Une vie, une œuvre, une amitié – Emile Verhaeren ». Montald et Verhaeren étaient de grands amis, deux couples amis même. En 1909, Verhaeren lui écrit : « Vous nous manquez. Non seulement pour les parties de cartes, mais pour le coude à coude journalier. Vous êtes les seuls êtres au monde avec lesquels nous pourrions vivre. Nous vous aimons bien. »

Catalogue de 1982 (illustré en N/B) : détail de Vasque aux ramiers, 1927
Quel plaisir de rouvrir ce petit catalogue qui me rappelle beaucoup de choses oubliées sur ce peintre qui préférait « le sentiment des choses à leur réalité » (Grégoire Le Roy) et a exposé ses œuvres, à la fin du XIXe siècle, au Salon d’art idéaliste, dans la voie de l’ésotérique Jean Delville. Ces adeptes de « la Beauté spirituelle, la Beauté plastique, la Beauté technique » avaient pour maîtres « Böcklin, Burne-Jones, Puvis de Chavannes entre autres ».

Constant Montald, Nymphes dansant, vers 1898, huile liant mat et détrempe sur toile,
95,5 x 135,5 cm, Bruxelles, MRBAB
Francine-Claire Legrand, à qui j’emprunte ces citations, distingue ainsi le symbolisme et l’idéalisme : le symbole est mystère, on le voit bien dans l’œuvre de Fernand Khnopff ; l’allégorie « est claire puisqu’elle doit être édifiante ». Montald recherche « le grand art », « serein et solennel » en peignant des œuvres à la fois décoratives et monumentales. Il veut représenter le Bonheur, l’Eden hors de ce monde, avec des couleurs fictives, « des ors intemporels », des nus parfois drapés – « un passeport pour des départs vers l’imaginaire ». Mais il a peint aussi des paysans, des scènes villageoises.

Constant Montald, Affiche pour l'Exposition triennale des Beaux-Arts de Gand, 1895
Fils d’un cordonnier gantois d’origine italienne (Montaldo), Constant Montald a d’abord travaillé comme peintre en bâtiment et suivi des cours du soir à l’Académie de Gand (peinture décorative). Il y obtient le premier prix à l’issue de ses études en 1885, puis le prix de Rome en 1886. Après son mariage en 1892, il expose de plus en plus souvent à Bruxelles où il s’installe en 1897.

Constant Montald, Portrait d'Emile Verhaeren, 1911
Jean-Baptiste Baronian raconte « les paradoxes d’une amitié ». Constant Montald a rencontré Verhaeren en 1898 et peint de nombreux portraits du grand homme de lettres au tournant du XIXe et du XXe siècle. Leur amitié s’est trouvée renforcée par les liens entre Marthe Verhaeren-Massin et Gabrielle Montald-Canivet, femmes d’artistes et femmes artistes (lire dans Koregos la belle étude de Barbara Caspers). Verhaeren, symboliste et passionné, est beaucoup plus concret que Montald, tourné vers la mythologie gréco-romaine, inspiré par la Renaissance et le préraphaélisme, chantre de l’harmonie. Deux esthétiques différentes, mais « c’est un peu une seule éthique que poursuivent les deux hommes », écrit Baronian de ces deux créateurs séduits par le socialisme et l’espoir dans le progrès.

Constant Montald dans son jardin, photo 1930
Montald était « un personnage » : sa prestance, sa distinction, son allure vestimentaire, sa joie de vivre ont fait de lui un professeur très aimé à l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, où il fut nommé en 1897. Parmi ses élèves, il y a eu Marie Howet, Paul Delvaux, Jean-Jacques Gailliard, Anto Carte… Il les encourageait à l’audace, à la persévérance, à la liberté dans la création même s’ils s’écartaient de ses propres préférences.

Constant Montald, Jardin sous la neige, 1916, Peinture à la colle sur carton,
69,5 x 81 cm, Bruxelles, MRBAB
Dans sa technique, quelques constantes : une peinture mate – les fresques italiennes de la Renaissance « firent de lui un adepte inconditionnel des grandes peintures murales » – à la colle, des toiles de gros coton américain, « rude et solide », du carton souvent, bien qu’il soit peu résistant. Pour la peinture à l’huile, il préconise trois couleurs : « le rouge anglais, l’ocre jaune, parfois brun ou rouge, et l’outremer, irremplaçable » (Denise Thiel-Hennaux), sans oublier l’emploi de « l’or lumière » où il était maître.

Constant Montald, L'heure dorée, 1927,
Gouache sur papier marouflé sur panneau
Je n’ai jamais visité la Villa Montald que le peintre s’était fait construire à Woluwe-Saint-Lambert et dont le jardin, soigné par Gabrielle, admiré de tous, a reçu de nombreuses personnalités diverses et beaucoup d’artistes : Verhaeren bien sûr (lui recevait les Montald au Caillou-qui-bique où Montald a fait tant de portraits du poète), le sculpteur Charles Van der Stappen, le graveur Charles Bernier, George Minne, Stefan Zweig, entre autres. Montald, qui jouait de plusieurs instruments (sa femme du piano), organisait chaque mois des séances musicales.
Une vidéo de cinq minutes sur Constant Montald (Inès Vigo, YouTube, 2017, ci-dessus) vous permettra de découvrir en musique l’univers de ce peintre des jardins paradisiaques, des arbres et des fleurs, des éphèbes et des nymphes, et peut-être de tomber sous le charme.