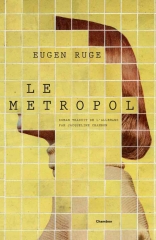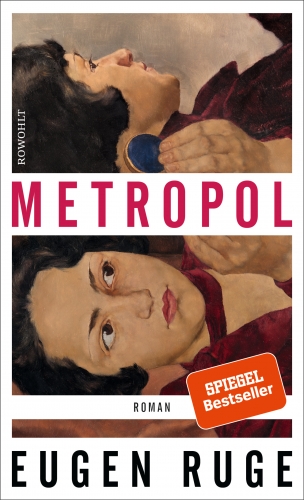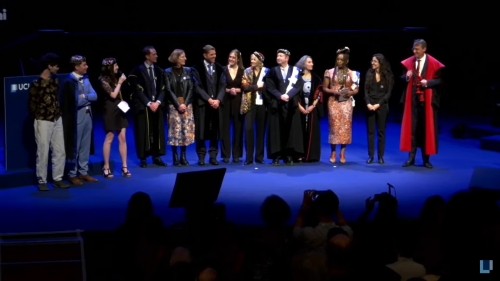Une invitation qui ne se refusait pas : Daardaar ou « le meilleur de la presse flamande en français » – un site dont je vous ai déjà parlé – proposait à ses abonnés de rencontrer l’équipe et de découvrir les huit épisodes de « Pardon ? ». Et où cela ? A deux pas de chez moi !
J’étais loin de soupçonner que derrière un banal immeuble résidentiel du boulevard Lambermont se déploie un grand espace de « coworking » en intérieur d’îlot, mais c’était bien là, une bannière de Daardaar flottait devant l’entrée. Au bout du couloir, un autre couloir et tout au fond, quelques personnes déjà assises pour la projection, d’autres en train de bavarder.
Accueillie aimablement par un membre de l’équipe, j’ai reconnu un seul visage : celui de Joyce Azar, « la jeteuse de ponts qui raconte la Flandre aux francophones » (SoirMag), journaliste à la VRT (flamande) et chroniqueuse à la RTBF (radio et télévision francophones) avec « Vu de Flandre ». Vous trouverez la photo et les fonctions de chacun sur le site de Daardaar.
Après un apéro qui a permis de faire connaissance avec l’un ou l’autre, Aubry Touriel, le réalisateur de « Pardon ? », a présenté ces nouvelles capsules diffusées sur le site de Daardaar et sur les chaînes bruxelloises Bruzz et Bx1. Dans le même esprit que Karambolage sur Arte, l’objectif est de créer des passerelles entre les communautés linguistiques. « Pardon ? » : on le dit aussi bien au nord qu’au sud du pays quand on n’a pas compris son interlocuteur.
Les enfants étaient impatients de voir les « dessins animés » : de petites histoires autour de quatre expressions flamandes expliquées en français et de quatre expressions françaises expliquées en flamand. La première projetée ironise gentiment sur la question « Quelle est la capitale de la Flandre ? » Bien vu pour illustrer l’expression « donner sa langue au chat ». Pour ma part, j’ignorais complètement ce que veut dire « De kogel is door de kerk », littéralement : la balle a traversé l’église !
Comme on le voit dans le générique de fin, beaucoup de personnes interviennent pour produire ce genre de clip vidéo, huit en moyenne. Il a fallu du temps pour les réaliser, d’autant plus que cette série a impliqué des citoyens, en faisant appel aux abonnés pour le choix des expressions et même pour les personnages des capsules. Le dessin d’animation est signé Camille Toussaint, comme celui figurant sur la bannière de Daardaar. Les huit épisodes sont à voir sur le site – amusez-vous !
La rencontre s’est terminée par des échanges. Du bon matériel didactique, a-t-on fait remarquer. Existe-t-il en Flandre un équivalent de Daardaar ? Non. Beaucoup souhaitent qu’on y fasse preuve de la même curiosité pour la presse francophone. Il a été question aussi, inévitablement, du financement. Rien que les droits d’auteur coûtent déjà très cher. Tous les membres de l’équipe de Daardaar sont bénévoles et gagnent leur vie par ailleurs.

Geen blad voor de mond nemen - YouTube / © Camille Toussaint
« Pardon ? » a été réalisé dans le cadre d’un appel à projets. Pour continuer, il faudrait des subsides tout en veillant à préserver l’indépendance totale de Daardaar, a insisté Joyce Azar, la responsable éditoriale. Une opération de crowdfunding les a aidés dans le passé, mais ce n’est pas à refaire régulièrement. L’asbl cherche donc des alternatives pour se financer et poursuivre son objectif : refléter en français ce qui se dit en Flandre. Si le travail de Daardaar vous tient à cœur et que vous souhaitez les soutenir, cliquez sur « Appel aux dons ».
Je suis ravie d’être allée à cette présentation sympathique et d’avoir découvert la jeune équipe enthousiaste de Daardaar. La région bruxelloise est bilingue, mais trop souvent encore, la barrière de la langue, voire de la culture, fait que les francophones et les néerlandophones s’y croisent sans se rencontrer. Le site de Daardaar est un bel endroit où apprendre à mieux se connaître. A découvrir absolument.