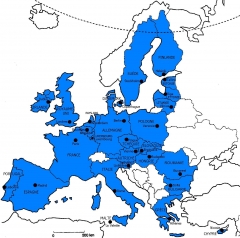« Sub Terra », l’exposition en cours à la Maison des Arts de Schaerbeek, Lola Meotti l’a conçue pour cet endroit ouvert aux artistes contemporains. En 2015, la commissaire invitée en a eu l’idée en visitant en Allemagne un ancien complexe sidérurgique devenu salle d’exposition, « tombée nez à nez avec un visage : un crâne surmodelé Vanuatu », dont une photographie est accrochée dans l’entrée.

Crâne du Vanuatu, photo © Hans-George Merkel (détail)
Sous la terre ? J’étais un peu perplexe en découvrant le sujet, avec une vague crainte d’y rencontrer le royaume des morts. Dans la salle à manger ancienne est projeté le film documentaire de Giovanni Cioni sur les âmes du Purgatoire, à Naples – In Purgatorio (2009). On y était. Heureusement, ce n’est qu’une des formes de relation entre les hommes et ce qui se trouve sous la terre. La terre donne et reçoit. Les hommes la creusent, l’exploitent, la cultivent.

© Seyni Awa Camara, Assékou (Jeune fille vierge), 1997, terre cuite, 45 x 20 x 20 cm
La sculptrice et potière Seyni Awa Camara, autodidacte, modèle la terre et dispose ses nombreuses sculptures dans sa maison, par ordre de taille. Toutes sont cuites dans un trou creusé dans sa cour, « dans le four à céramique le plus rudimentaire qui soit, et se figent dans le feu à ciel ouvert ». Sa mère l’a initiée aux techniques traditionnelles, mais ses œuvres, libres et imaginatives, vendues au marché, rompent avec les productions artisanales usuelles.
Ce n’est pas mon premier coup de cœur dans la grande salle tapissée de nuages de la Maison des Arts, mais celui-ci est particulièrement spectaculaire et symbolique : Corine Borgnet y expose Le dernier souper (2019), une table somptueusement dressée sous le lustre en cristal doublé dans le miroir. Vue de plus près, cette « vanité » surprend par l’aspect ossifié de la vaisselle (verres, assiettes, couverts) et des garnitures : tout est en jesmonite et os de volaille. Tout semble figé par le temps, oiseaux, insectes, couronne…

© Corine Borgnet, Le dernier souper, 2019, jesmonite et os de volaille
Je pense au Sermon sur la mort de Bossuet – « […] entassez dans cet espace, qui paraît immense, honneurs, richesses, plaisirs : que vous profitera cet amas, puisque le dernier souffle de la mort, tout faible, tout languissant, abattra tout à coup cette vaine pompe […] – et en même temps, je trouve cette œuvre d’une beauté surprenante dans l’ensemble et dans les détails, avec cette pile vertigineuse d’assiettes défiant l’équilibre comme l’œuvre défie le temps.

© Carole Louis, éléments en lien avec une performance et installation au Chili, 2021
Dans la bibliothèque, pour une fois, les rayonnages ne sont pas vides. Carole Louis y a posé des bouteilles de soda et des canettes restées enterrées un temps sous le sable (sauf les bouchons), décor dérisoire autour du surprenant objet au milieu de la pièce, une installation qui rappelle une de ses performances à Antofagasta, au Nord du Chili, lors de la Biennale d'Art contemporain 2021.
A l’étage, on se rend compte de la créativité des artistes contemporains pour nous montrer des objets que nous pensons reconnaître, illusion qui s’efface quand on s’en approche. De subtiles transformations se sont produites. Ainsi, Tatiana Bohm a travaillé sur un secrétaire à abattant en acajou et tiroirs en citronnier : elle l’a gravé et doré à même le bois de dessins du graveur liégeois du XVIe siècle, Théodore de Bry, sur les expéditions européennes en Amérique.

© Tatiana Bohm, Reliquaire de Théodore de Bry, 2022 (détail)
Ce sont des illustrations sur l’esclavage des autochtones, sur les tortures infligées par les conquistadors. Sur les tiroirs, des plaques de verre, de cuivre ou d’acier gravées et patinées diversement encadrent un médaillon qui contient toutes sortes de métaux précieux. Cette artiste développe toutes sortes de techniques pour intervenir « sur ou avec des images de la violence du monde ».
Diana Scherer, pionnière de « l’art biotechnologique », s’intéresse au « cerveau » des plantes et étudie leurs systèmes racinaires. Elle expose des « tissages » très particuliers à partir de végétaux (plants d’orge et autres) qu’elle fait pousser sur une matrice afin de diriger leurs racines – laissant le reste au hasard et au temps : une fois la matrice retournée, le résultat est aléatoire, comme le montre la photo de l’affiche.

© Diane Sherer, Hyper rhizome #12 (détail), 2022
Si vous consentez à vous laisser surprendre, visitez « Sub Terra » pour découvrir les douze artistes présentés. Ne manquez pas de descendre à la cave – l’endroit est évidemment bien choisi – où une installation in situ de Loup Lejeune intitulée Plasma (2023) interroge les rapports de force entre nature et culture à l’aide de toutes sortes de matériaux, dans un environnement sonore immersif.

Pour cette expo originale, à voir jusqu’au 14 mai, la Maison des Arts de Schaerbeek propose comme toujours diverses animations, y compris pour les enfants (un joli parcours en affiches signées Jacinthe Folon.)
 « Lara avait un jour demandé à Cléo comment juger du niveau d’une danseuse. La rapidité de ses gestes, sa souplesse, sa grâce ? Devant l’écran, elle comprit que c’était autre chose : cette capacité à ravir l’attention, toutes les attentions, par millions, dont celle de Lara. Cette capacité à donner envie d’être Cléo, agile, athlétique, précise et troublante.
« Lara avait un jour demandé à Cléo comment juger du niveau d’une danseuse. La rapidité de ses gestes, sa souplesse, sa grâce ? Devant l’écran, elle comprit que c’était autre chose : cette capacité à ravir l’attention, toutes les attentions, par millions, dont celle de Lara. Cette capacité à donner envie d’être Cléo, agile, athlétique, précise et troublante.