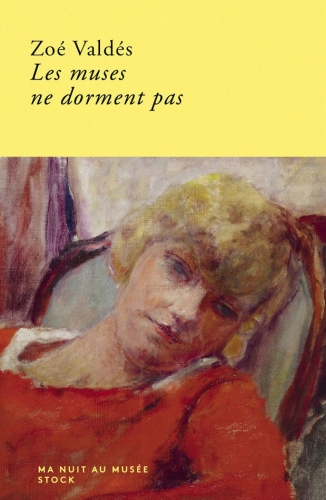Nous étions nombreux la semaine dernière à visiter Marc Chagall, L’épaisseur des rêves à La Piscine de Roubaix, avant que l’exposition ferme ses portes ce dimanche 13 janvier. (Une autre est prévue au musée du Luxembourg à Paris bientôt.) Un parcours quasi totalement inédit pour moi qui n’en suis pas à ma première visite pourtant à ce peintre de personnages en flottaison dans un univers coloré à nul autre pareil : la plupart des œuvres exposées appartiennent à des collections particulières, notamment un bel ensemble de sculptures et de créations pour la scène rarement montrées.

Double portrait au verre de vin, 1917 – 1918, Paris,
Musée national d’art moderne - Centre Pompidou.
(don de l’artiste, 1949) © Adagp, Paris 2012
On y est accueilli par le Double portrait au verre de vin du Centre Pompidou, d’emblée ce sont les thèmes chers au peintre de Vitebsk arrivé à Paris en 1910 : les amoureux (Bella et lui), les paysages de sa vie (sa ville natale à l’arrière-plan), la fantaisie dans l’espace (lui juché sur les épaules de sa femme et, touche finale, un ange en mauve qui les bénit du ciel).

Costumes pour un joueur de bandera, pour un coq, pour une chauve-souris
(Aleko, scène IV), 1942. Collection particulière.
De la première salle, on aperçoit de loin sur une estrade de nombreux costumes de scène. Après des esquisses pour La chute de l’ange, où perce l’angoisse des années trente, des maquettes à l’aquarelle et aux crayons de couleur pour le ballet « Aleko » (période où l’artiste a trouvé refuge aux Etats-Unis pendant la seconde guerre mondiale) entourent ces tenues lumineuses, une vingtaine, que j’ai regardées avec ravissement : robe de soie blanche aux oiseaux d’une dame de société, costumes de gitane, de joueur de bandera, ou encore de coq, de chauve-souris. L’imagination, la gaieté, la liberté du peintre sont là.

Maquette pour le rideau de scène de « L’Oiseau de feu » d’Igor Stravinski : la forêt enchantée (détail),
1945, Collection particulière. © Adagp, Paris 2012
Après la mort de Bella en 1944, Marc Chagall continue à travailler pour la scène, cette fois pour L’oiseau de feu de Stravinski – superbe Forêt enchantée, une des trois maquettes pour le rideau. J’aurais voulu vous montrer Dédié à Bella ou L’attente sous le bouquet, mais le verre protecteur et l’éclairage ne me l’ont pas permis. Un homme y est assis sous un arbre devenu bouquet. Tout est grâce et sensibilité dans cette aquarelle de 1938.

Autoportrait à la pendule, 1947,
Collection particulière. © Adagp, Paris 2012
Deux belles toiles m’ont retenue, Autoportrait à la pendule et, sur le mur opposé, Entre chien et loup. Sur l’une et l’autre, le peintre au visage bleu se représente avec sa palette : dans le premier autoportrait, il peint au chevalet un homme les bras en croix embrassé par une mariée ; dans le second, un étonnant couple en bleu blanc rouge devant Vitebsk enneigé où un réverbère se met en marche – le sujet de la toile sur le chevalet est caché. Toujours, chez Chagall, la vie et le mouvement.

Entre chien et loup, 1938-43,
Collection particulière © Adagp, Paris 2012
« L’épaisseur des rêves », le titre de l’exposition de Roubaix, évoque le Chagall qui fut aussi céramiste et sculpteur, un aspect méconnu de son œuvre. Revenons sur « Aleko », créé à Mexico en 1942 : « Ce séjour mexicain (…) est sans doute important dans le passage de la surface de la toile ou du papier à la troisième dimension de la sculpture. La référence à Gauguin et la découverte de la céramique plastique précolombienne semblent s’associer dans l’esprit du travail de la terre que Chagall entreprend à Vallauris dès son retour en France. » (Dossier de presse) On montre deux poupées Kachina des Indiens Hopi dont l’une a clairement inspiré un costume de monstre vert à rayures noires pour L’oiseau de feu.

Deux têtes à la main, 1964,
Collection particulière. © Adagp, Paris 2012
Il y aurait deux cents vases originaux de Chagall, beaucoup sont montrés ici – vous en avez peut-être vu quelques-uns à Martigny en 2007. Des formes irrégulières, des figures sur fond blanc, en dialogue avec sa peinture. Jamais je n’avais vu autant de sculptures de Chagall (marbres, pierres, rares bronzes) où l’on retrouve sa fantasmagorie, souvent en bas-relief : amoureux, visages (Deux têtes à la main), nus, oiseaux, ânes, chèvres, poissons, lune, mais aussi Christ en pierre de Rognes et autres figures bibliques. Sur un autoportrait en médaillon, un petit corps de femme surmonte le profil de Chagall. Ces œuvres « donnent envie d’être touchées, d’être caressées », comme l’écrit Itzhak Goldberg (La tentation de la 3e dimension).

L’Envolée de la mariée à la dentelle, 1970,
Collection particulière.© Adagp, Paris 2012
A la fin de l’exposition, après une série de paysages parisiens aux couleurs fortes et des esquisses pour le merveilleux plafond de l’Opéra de Paris, on découvre d’étonnants et délicats collages des années 60-70 qui révèlent une autre facette de son art. Papiers et tissus imprimés, bouts de dentelle, végétaux même s’intègrent dans ces œuvres de petit format à la gouache ou à l’encre de Chine. Au bout de ce parcours riche de quelque deux cents œuvres, autant de fenêtres sur les rêves de Chagall, les dernières salles s’intitulent : « Au-delà de la couleur ».