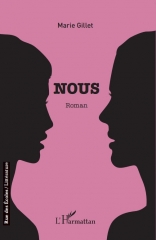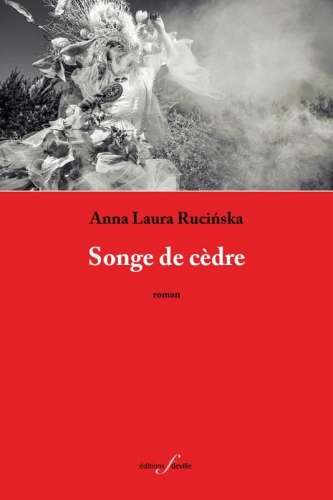L’autre moitié de soi traduit assez bien The Vanishing Half de Brit Bennett (traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Karine Lalechère), littéralement « la moitié disparue ». C’est sur le retour à Mallard en Louisiane d’une des sœurs jumelles que s’ouvre le roman, en 1968 : Desiree Vignes, disparue avec sa sœur Stella une quinzaine d’années plus tôt – elles avaient seize ans –, « tenait la menotte d’une fillette de sept ou huit ans, noire comme le goudron ».

© Aimé Mpane, Patte blanche, série de 27 panneaux multiplex taillés à l’herminette et acrylique, 2021
[ Exposition Remedies aux Musées royaux des Beaux-Arts > 13.02.2022 ]
Cela fait sensation dans cette petite ville célèbre pour la peau claire de ses habitants métis « qui ne seraient jamais acceptés en tant que Blancs mais qui refusaient d’être assimilés aux Nègres. » Les familles veillent depuis longtemps à rendre « chaque génération plus claire que la précédente ». Adele Vignes, devenue veuve après le lynchage de son mari (sous le regard de ses filles), savait que les jumelles avaient été vues un temps à La Nouvelle Orléans, mais elle ignorait que ces inséparables s’étaient séparées : « Stella était devenue blanche et Desiree avait épousé l’homme le plus noir qu’elle avait pu trouver. »
A la fin de leur seconde, Adele avait annoncé aux jumelles qu’elles ne retourneraient plus au lycée, qu’il fallait gagner de l’argent et qu’elle leur avait déjà trouvé une place de domestique chez les Dupont dans leur maison d’Opelousas. Elles avaient obéi, bien que ni l’une ni l’autre ne voyaient leur avenir en tant qu’employées de maison.
Desiree rêvait d’ailleurs depuis longtemps ; l’idée d’abandonner sa mère révoltait jusqu’alors Stella, fille serviable et bonne élève. En allant à La Nouvelle Orléans, elles espéraient trouver un meilleur emploi qui leur permettrait d’envoyer de l’argent à leur mère. Si Desiree a pris le chemin du retour avec sa fille Jude, après six ans de mariage, c’est parce que Sam l’a frappée, une fois de trop. Elle avait rencontré son mari avocat à Washington, où l’administration fédérale l’avait embauchée après sa formation pour lire les empreintes digitales.
Sa mère lui fait bon accueil, sans pouvoir s’empêcher de remarquer que la petite lui « ressemble autant que le jour à la nuit ». Quand Earles, un ancien amoureux réapparaît aussi à Mallard et reconnaît Desiree à l’Egg House où elle travaille comme serveuse faute de mieux, celle-ci ignore qu’il gagne sa vie en recherchant des personnes disparues, cette fois pour le compte de Sam.
Comme il s’enquiert de Stella, Desiree lui raconte comment elles ont d’abord travaillé dans une blanchisserie de La Nouvelle Orléans, avant que Stella réponde à une annonce pour un poste de secrétaire à Maison Blanche, le grand magasin de la ville. Alors que tout le monde voit en Desiree une femme de couleur, sa jumelle passe aisément pour une femme blanche et c’est en tant que telle qu’elle est engagée. Un soir, les affaires de Stella ont disparu, elle a laissé un message : « Pardonne-moi ma chérie. Je dois vivre ma vie. » Early propose son aide à Desiree pour retrouver sa trace.
L’autre moitié de soi, qui raconte leur histoire mouvementée sur trois générations, d’Adele à Jude, est un roman centré sur les liens familiaux, le problème racial et les barrières sociales aux Etats-Unis dans les années 1970-1980. Leur couleur de peau vaut aux deux soeurs des destinées très différentes. On découvrira quel genre de vie mène Stella « la blanche », loin des siens.
Le titre, s’il renvoie d’abord aux jumelles séparées, fait aussi écho au choix de Stella qui renonce à une part d’elle-même, ainsi qu’à un personnage transgenre qui va prendre de l’importance au fil du temps. Cela fait beaucoup, mais ce gros roman accroche et fait tourner les pages – on n’est pas étonné d’apprendre qu’il va être adapté en série. Sous son allure de best-seller (comme le roman précédent de Brit Bennett, Le cœur battant de nos mères), il traite de questions sérieuses. Peut-on devenir quelqu’un d’autre ? Comment se sentir à sa place dans la société ? Les rêves sont-ils forcément liés à des renoncements ? « Un grand roman de l’identité afro-américaine », selon Le Monde.