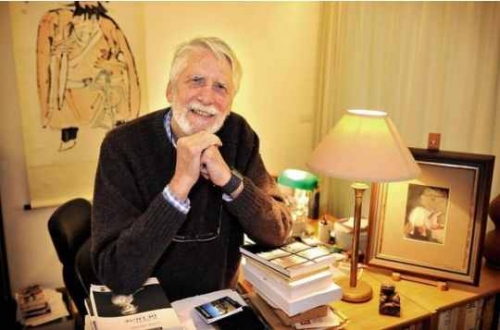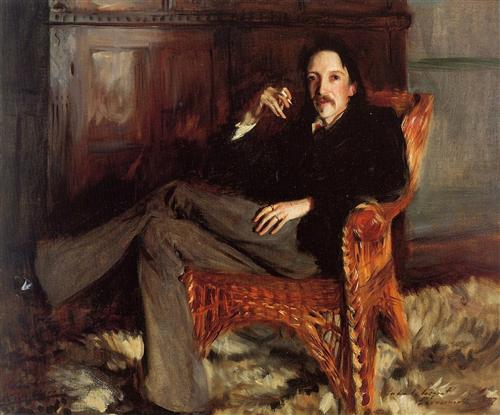« Et les mains ? Avec elles nous demandons, nous promettons, appelons, congédions, menaçons, prions, supplions, nions, refusons, interrogeons, admirons, comptons, confessons, nous nous repentons, nous craignons, exprimons de la honte, doutons, instruisons, commandons, incitons, encourageons, jurons, témoignons, accusons, condamnons, absolvons, injurions, méprisons, défions, nous nous fâchons, nous flattons, applaudissons, bénissons, nous nous humilions, nous nous moquons, nous nous réconcilions, nous recommandons, exaltons, fêtons, nous nous réjouissons, nous nous plaignons, nous nous attristons, nous nous décourageons, nous nous désespérons, nous nous étonnons, nous nous écrions, nous nous taisons : et que ne faisons-nous pas, avec une infinie variété rivalisant avec [celle] de la langue ? »
Montaigne, Les Essais, Livre II, chapitre XII

La sculpture française au XVIe siècle (détail de la couverture)
Et pour qui voudrait comparer avec le texte original en moyen français :
« Quoy des mains ? nous requerons, nous promettons, appellons, congedions, menaçons, prions, supplions, nions, refusons, interrogeons, admirons, nombrons, confessons, repentons, craignons, vergoignons, doubtons, instruisons, commandons, incitons, encourageons, jurons, tesmoignons, accusons, condamnons, absolvons, injurions, mesprisons, deffions, despittons, flattons, applaudissons, benissons, humilions, moquons, reconcilions, recommandons, exaltons, festoyons, resjouïssons, complaignons, attristons, desconfortons, desesperons, estonnons, escrions, taisons : et quoy non ? d'une variation et multiplication à l'envy de la langue. »