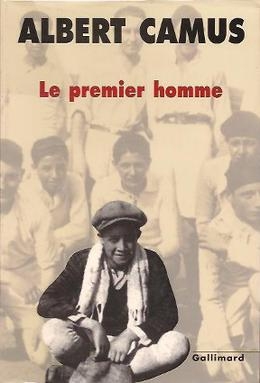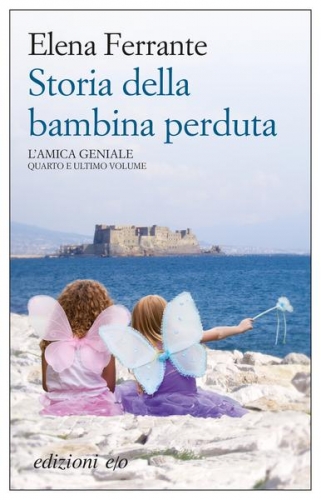Quand Le premier homme a été publié en 1994, à partir du manuscrit trouvé dans la sacoche de Camus à sa mort en 1960, je l’ai lu avec une grande curiosité. J’en gardais le souvenir de sa recherche du père, du bel hommage à son instituteur d’Alger. A la relecture, j’ai mieux perçu à quel point ce récit est un cri d’amour à sa mère. Aux passages déjà cochés, j’en ai ajouté d’autres, comme ceci dans les annexes qui donne parfaitement le ton : « En somme, je vais parler de ceux que j’aimais. Et de cela seulement. Joie profonde. »
Sa mère qui entendait mal, Catherine Hélène Sintès (famille originaire de Minorque), ne savait ni lire ni écrire. C’est à elle que s’adresse la dédicace : « A toi qui ne pourras jamais lire ce livre ». La première partie (Recherche du père) démarre en Algérie dans la carriole à deux chevaux conduite par un Arabe qui amène ses parents – un homme d’une trentaine d’années, une femme pauvrement habillée, presque au terme de la grossesse – et son frère de quatre ans alors, par une nuit de l’automne 1913, à une « petite maison blanchie à la chaux ». Là, elle accouche d’un garçon : Jacques. Les personnages du Premier homme ne portent généralement pas leur vrai nom ; bien qu’autobiographique, le récit des origines d’Albert Camus raconte celles de Jacques Cormery. Sa mère s’y appelle d’abord Lucie, puis Catherine ; son père, Henri.
Au chapitre de la naissance succède sans transition Saint-Brieuc : à quarante ans, Jacques y cherche la tombe de son père, « blessé mortellement à la bataille de la Marne, mort à Saint-Brieuc le 11 octobre 1914 ». Il ne l’a pas connu et ne peut pas « s’inventer une piété qu’il n’avait pas », mais il a promis à sa mère, restée en Algérie bien que lui vive en France, d’aller sur cette tombe. Comme « son vieux maître » s’est retiré à Saint-Brieuc, il a décidé, avant de le rencontrer, de « rendre visite à ce mort inconnu ». L’émotion surgit d’un calcul : « 1885-1914 », vingt-neuf ans ! « L’homme enterré sous cette dalle, et qui avait été son père, était plus jeune que lui. »
Le premier homme est annoté en bas de page : variantes, ajouts en marge, notes de l’éditeur. Le court chapitre 3 (visite à Victor Malan à Saint-Brieuc, « Chapitre à écrire et à supprimer » en marge) fait place aux Jeux de l’enfant où nous découvrons Jacques « dans la chaleur de juillet », obligé de faire la sieste par sa grand-mère dans le petit trois pièces d’un faubourg d’Alger où elle vit avec eux. C’est le retour « à l’enfance dont il n’avait jamais guéri, à ce secret de lumière, de pauvreté chaleureuse qui l’avait aidé à vivre et à tout vaincre. » Parfois il échappe à la sieste et rejoint ses camarades de jeu au jardin d’essai – ce beau parc d’Alger découvert il y a quelques années à une exposition du peintre Gérard Edsme.
A son retour près de sa mère, 72 ans, ils s’embrassent, se regardent – « des années de travail épuisant avaient respecté en elle la jeune femme que Cormery enfant admirait de tous ses yeux ». Il l’interroge sur son père : « Il me ressemblait ? – Oui, c’était toi, craché. Il avait les yeux clairs. Et le front, comme toi. » Il voudrait la faire venir en France, elle ne veut pas, se sent trop vieille pour affronter le froid.
On découvre comment la famille de Camus vivait, chichement mais dans la dignité, l’oncle sourd, mais « fin et rusé », qui lit le journal tous les jours, qui emmène Jacques nager et chasser. Camus raconte l’école où son ami Pierre et lui obtenaient les premières places, il fait le beau portrait de « Monsieur Bernard » (M. Germain, son instituteur) qui leur donnait des joies « qu’ils ne trouvaient pas chez eux, où la pauvreté et l’ignorance rendaient la vie plus dure, plus morne » – « on les jugeait dignes de découvrir le monde. »
Outre la lecture, dont il leur donne le goût, il lui doit « le seul geste paternel, à la fois réfléchi et décisif, qui fût intervenu sans sa vie d’enfance ». L’instituteur voulait leur faire passer le concours pour obtenir la bourse des lycées et collèges, mais sa grand-mère s’y opposait, exigeant qu’il travaille pour les aider. Le maître est venu chez eux pour la convaincre, offrant son aide gratuite pour l’aider à réussir. Camus lui porte une reconnaissance éperdue.
La deuxième partie, Le fils ou le premier homme, relate les années au lycée, la prise de conscience des différences sociales, la vie des rues par où il passe, à pied ou en tramway, les angoisses aussi. Quelles belles pages sur le départ des hirondelles, sur les parcs d’Alger, les arbres, l’ivresse qu’il ressent dans cette « jungle parfumée » ! Durant les vacances d’été, le garçon travaille, il s’y est engagé auprès de sa grand-mère. Une fois sa première paie déposée sur la table, elle ne le battra plus. « Oui, il était un homme, il payait un peu de ce qu’il devait, et l’idée d’avoir diminué un peu la misère de cette maison l’emplissait de cette fierté presque méchante qui vient aux hommes lorsqu’ils commencent à se sentir libres et soumis à rien. »