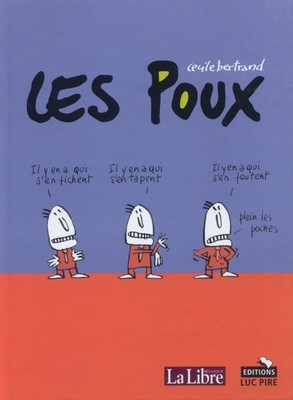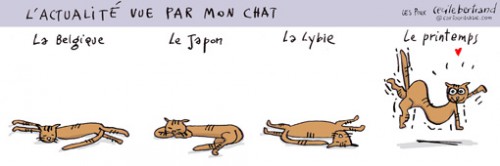En se promenant le long du lac Léman, à Lausanne, sur le quai de Belgique (Ouchy), si joliment fleuri autour de remarquables vieux arbres, impossible de ne pas remarquer l’entrée du Musée olympique. Elle se trouve juste en face du bateau « Helvétie » qui a accueilli ses visiteurs durant les presque deux ans de rénovation du musée, rouvert en décembre 2013.
Cette fois, nous avons décidé de gravir les marches pour visiter le musée de l'olympisme (on peut emprunter un escalier roulant). Le parc-jardin en terrasses vers le lac comporte des sculptures dédiées aux athlètes, mais on y trouve aussi « La pluie » de Folon au bout d’un bassin.
Tout près du sautoir à la perche impressionnant où la barre est mise au niveau du record du monde masculin (le record féminin est indiqué par une flèche un peu plus bas), deux jeunes filles asiatiques avaient décidé de se mesurer à Usain Bolt sur la piste du cent mètres : quand on s’élance de la ligne de départ, des balises lumineuses indiquent où se trouve déjà le prodigieux sprinter – au bout de la ligne quand elles n’étaient encore qu’à mi-course !
Dès l’entrée, le musée olympique en jette plein la vue avec sa rampe d’accès et ses éclairages colorés. On y explique d’abord l’origine des jeux olympiques et leur esprit, selon la formule d’excellence soufflée à Pierre de Coubertin : « Citius, Fortius, Altius ».L’histoire des JO se décline au mur sur une ligne du temps, accompagnée d’objets d’époque et de tables virtuelles à consulter tout au long du parcours.
Torche olympique, mascottes, tenues de sport, accessoires, photos, affiches, vaisselle, médailles – de nouveaux modèles sont créés pour chaque édition des JO, le design évolue – le musée expose tout ce qui participe à l’élaboration des jeux, et aussi les maquettes des stades olympiques.Le « nid d’oiseau » réalisé pour les JO de Pékin en 2008 est une des plus belles. Etonnante aussi cette robe décorée symbolisant la Suisse ? l'Autriche ?, portée lors d’une cérémonie d’ouverture.
Grandes photos, grands événements des JO, magnifique diaporama sur un grand écran courbe où tous les détails de l’effort sportif apparaissent dans un superbe montage, on pourrait passer une journée entière au Musée olympique (plus de trois mille mètres carrés d’exposition permanente), mais en deux heures, il y a déjà moyen de s’en faire un bon aperçu. On peut aussi faire une pause sur la terrasse du TOM Café avec vue sur le lac.
Le musée comporte trois niveaux. Au dernier, les aspects concrets de la vie d’athlète sont abordés de manière très ludique : exercices d’équilibre, jeux, quizz – celui sur l’alimentation met à mal bien des préjugés – etc. Pour les sportifs, la visite du Musée olympique s’impose, mais celui-ci a de quoi ravir tous les visiteurs et à tout âge. Et son site, si le sujet vous passionne, est plein de ressources.
« Créer un monde meilleur par le sport » : l’esprit de l’olympisme porte de hautes valeurs. Reste à voir si l’évolution commerciale des JO, leur financement, les risques de dérive nationaliste et autres effets pervers du sport spectacle ne les mettent pas en péril. On voudrait croire, bien sûr, qu’ils contribuent à promouvoir « la compréhension mutuelle, l'esprit d'amitié, la solidarité et le fair-play ».