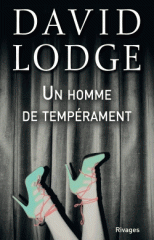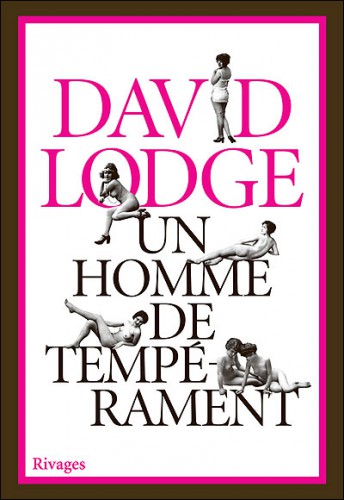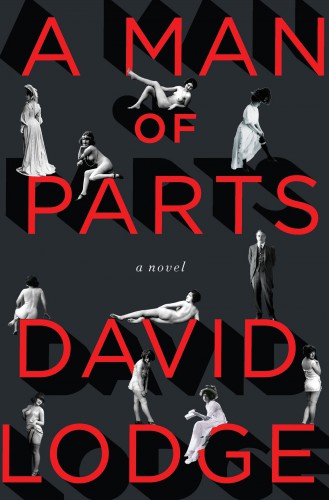Ce joli titre d’exposition – en français à la Côte belge, ce n’est pas si courant, merci – met à l’honneur les peintres inspirés par Ostende aux Galeries Vénitiennes, sur la digue de la reine des plages belges, jusqu’au 15 septembre. « Bonjour Ostende » est d’abord le titre d’une amusante toile cubiste de Floris Jespers choisie comme affiche : silhouettes de promeneurs à la manière d’un collage, la tête ailleurs, sur un bord de mer où les poissons s’envoient en l’air – Ostende avec ses cabines rayées, ses bateaux à l’horizon.

Floris Jespers, Bonjour Ostende, 1926-1927
Plusieurs oeuvres de Floris Jespers, dont « La plage d’Ostende », remarquable aussi, accueillent les visiteurs avant qu’ils pénètrent dans une longue salle d’exposition où les tableaux sont présentés par ordre chronologique, de 1650 à nos jours. Les anciennes représentations de la ville relèvent de la peinture d’histoire (Peter Snayers, « Le Siège d’Ostende ») et mettent en valeur le port, l’arrivée des bateaux, le marché aux poissons, la plage et la digue.
Au XIXe siècle, Michel Van Cuyck, peintre ostendais, montre la société élégante en promenade sur la digue et, sur la plage, des cabines sur roues qu’on retrouve dans une grande toile verticale de François Musin, « La plage de l’ouest et le casino d’Ostende ». Le Kursaal (ou Casino) est un endroit mythique à Ostende, son architecture a évolué au cours du temps. Musin a peint cette vue (vers 1885) depuis la plage où des pêcheurs à cheval, des enfants, des familles, prennent l’air non loin des cabines aux rayures pimpantes –un drapeau noir jaune rouge piqué dans le sable flotte au vent – sous le mur oblique de la digue avec ses grands hôtels et, tout au bout, l’arrondi de la promenade autour du casino. Superbe.
François Musin, La plage de l'ouest et le casino d'Ostende, vers 1885
(Toile plus lumineuse en réalité)
Van Cuyck est l’un des artistes locaux chez qui le jeune James Ensor (1860-1949) a pris des cours de dessin, celui-ci est évidemment bien présent avec des marines et des vues en plongée sur des rues qu’il apercevait de son atelier sous les toits. Ses célèbres Bains d’Ostende (1890) sont drôlissimes : personnages grotesques, chiens lubriques, plage grouillant de monde sous un ciel rieur, on ne s’embête pas ! Jean-Jacques Gailliard peint Ensor marchant sur la digue, mains derrière le dos, de profil, tout en noir, avec chapeau et parapluie (« Ensor Ostendais »).
On croise aux Galeries Vénitiennes des noms bien connus en Belgique : Degreef, Hannon, Vogels, Permeke surtout. On reconnaît « Le port d’Ostende » de Willy Schlobach avec sa grande oblique (collection Belfius), la touche pointilliste de Finch, « L’hippodrome Wellington », et on est attiré irrésistiblement vers le fond de la galerie où l’on reconnaît la patte d’un autre grand peintre ostendais, cher à notre cœur, Léon Spilliaert (1881-1946) – rien que pour lui, le déplacement vaut la peine.

Spilliaert, Fillette à la plage (détail), 1909
Quel ensemble ! Une « Marine (nocturne) » presque noire, d’un noir d’encre, où l’on devine à peine l’horizon, une « Marine (avec vue sur le Royal Palace) » très claire, légère comme une esquisse, où le peintre distribue ses gris subtils dans l’espace dont mieux que quiconque il rend l’ouverture sur l’infini. Deux repères, le Royal Palace, à gauche, et un bateau qui fume entre ciel et mer. Une « Marine bleue et rouge » au pastel, une autre « aux voiles oranges », et que dire de cette « Digue d’Ostende » à contre-jour, somptueuse ? Une « Fillette à la plage » retient son chapeau ; sur le seuil d’une « Maison appelée « La Chaire » à Ostende », un pêcheur fume la pipe assis sur l’escalier.
Je ne connaissais pas Jan De Clerck (1881-1962), Ostendais lui aussi, qui nous montre entre autres des bassins du port ou un chantier naval sous la neige ou en été. J’ignorais que Erich Heckel, expressionniste allemand (un des fondateurs de Die Brücke), amené en Flandre par la première guerre (comme infirmier volontaire) avait peint tant de vues d’Ostende – quel dommage que la moitié d’entre elles soient accrochées si haut qu’il faudrait un escabeau pour les approcher !

Erich Heckel, Casino d'Ostende, 1917
Je pourrais encore vous parler de Wolvens, de Brusselmans, de Raveel (« Het groen in de zee »)… Mais passons à la photographie et aux images captées, dans les salles annexes : Lili Dujourie y a aligné sept écrans sur lesquels on peut regarder bouger la mer en noir et blanc, marée basse, marée haute, vue de son appartement. Plus loin, de la même artiste flamande, « Ostende » (1974), dix-huit petites photos noir et blanc prises un jour de tempête.
Contraste avec « Twilight » (« Crépuscule », 2008), un beau film en couleurs de Michel Lorand sur grand écran : un marcheur passe sur la plage avec son chien, c’est un peu flou, la caméra oscille de gauche à droite et inversement, peu à peu la lumière change… Quelques images sur son site vous en donneront un aperçu. Vous pourrez découvrir aussi d’anciens films sur Ostende, il y a de quoi vous remplir les mirettes aux Galeries Vénitiennes (à côté de l’Hôtel des Thermes). Et dans le beau catalogue bilingue de Xavier Tricot (Pandora) qui commence par « Certains noms de villes suscitent le rêve. »