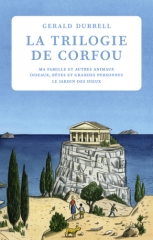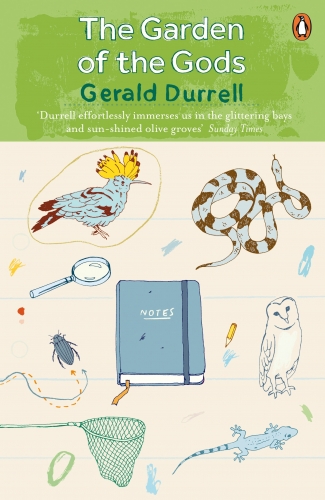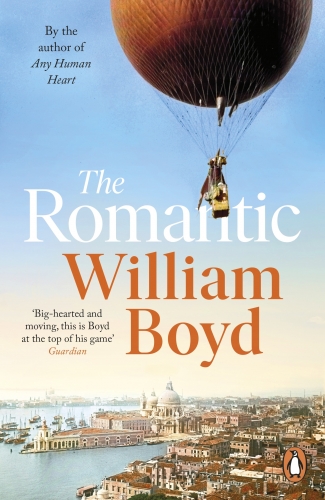Le romantique ou la vraie vie de Cashel Greville Ross (traduit de l’anglais par Isabelle Perrin) est le dernier roman paru de William Boyd. Dans le prologue signé à Trieste en février 2022, W. B. parle de l’autobiographie inachevée de son personnage « tombée en sa possession » avec d’autres souvenirs : « j’ai considéré que l’histoire de sa vie, de sa vraie vie, serait bien mieux servie si on l’écrivait ouvertement, sciemment, honnêtement sous la forme d’un roman. »
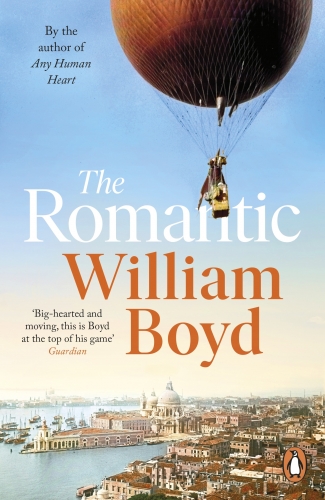
Cashel Greville (1799-1882) a pour premier souvenir d’enfance en Irlande, une rencontre avec un homme en noir sur un cheval noir, qu’il a pris pour la Mort ou « le diable en personne ». Le cavalier lui a parlé avec l’accent anglais de Stillwell Court, différent de celui de Glanmire Lane, le cottage où il vivait avec sa tante Elspeth, gouvernante qui faisait la classe aux deux filles de sir Guy et Lady Stillwell.
Quand Cashel a eu cinq ans, elle lui a parlé de ses parents morts dans un naufrage en 1800. Bien éduqué, le garçon étudiait bien et son accent écossais, tenu de sa tante, s’était teinté d’irlandais. Quand le départ de ses élèves pour la France fut annoncé, Elspeth annonça leur déménagement à Oxford, en Angleterre, où il s’appellerait désormais Cashel Ross et elle, Mme Pelham Ross ; il devrait l’appeler « mère ». Enceinte, Elspeth comptait sur lui pour ne rien dire de leur vie d’avant, afin d’éviter des ennuis.
Leur « nouvelle vie » est plus confortable à The Glebe, une maison cossue avec des domestiques, grâce à son nouveau « père », M. Pelham Ross, très souvent pour affaires en Afrique du Sud. En 1809 naissent deux faux jumeaux, Hogan et Buckley. Cashel devient un jeune homme, déniaisé par Daisy, la femme de chambre, bientôt renvoyée pour vol. Quand M. Ross revient, ses affaires africaines tout à coup terminées, Cashel, intrigué, fouille dans son bureau.
Une lettre commençant par « Cher sir Guy » lui fait découvrir le secret de leur double vie : Ross est le nom d’emprunt de sir Stillwell. Interrogée, Elspeth lui raconte leur liaison et sa véritable origine : il est leur premier fils. Furieux de tous ces mensonges, Cashel s’enfuit pour « se construire une nouvelle vie quelque part, n’importe où ». Sur une place de marché, le 99e régiment d’infanterie du Hampshire recrute. Cashel est engagé comme tambour sous le nom de Cashel Greville.
En 1815, Napoléon s’échappe de l’île d’Elbe. Le régiment s’attend à devoir passer à l’action. On leur fait traverser la Manche, puis marcher vers Hal, avant de prendre la direction de Waterloo. Cashel y perd son ami Croker, l’autre tambour, puis reçoit un coup de lance qui lui traverse la jambe. La blessure mettra du temps à guérir. Renvoyé en Angleterre sept mois plus tard, réformé, il y reçoit à l’hospice la médaille de Waterloo et une pension pendant deux ans.
Avec le temps, Cashel a compris à quel point sa mère lui manque et il rentre à la maison. Son père propose alors de lui acheter une commission d’officier dans la Compagnie anglaise des Indes orientales, pour « voir le monde ». A Madras, il mène une vie de nabab avant de participer à la troisième guerre de Kandy, sur l’île de Ceylan. Choqué par un massacre ordonné par le commandement, Cashel refuse de tirer sur des hommes désarmés et est renvoyé en Angleterre.
Sur le navire du retour chargé de thé, l’aumônier phtisique avec qui il s’était lié se suicide et laisse à Cashel les soixante-sept ouvrages de sa bibliothèque – de quoi lire sur l’océan Indien. C’est alors que naît son projet d’écrire lui-même sur ses voyages. Lors d’une escale, il embarque sur un navire hollandais qui le dépose à Ostende. Cashel retourne à Waterloo et entame un tour d’Europe.
A Pise, venu en aide à deux Anglaises en arrêtant leur voleur, il est reçu chez Mme Williams et Mme Shelley, la femme du poète. Grâce aux Shelley, il va rencontrer leur ami, le fameux lord Byron, puis Claire Clairmont, la demi-sœur de Mary Shelley. De retour de Gênes, Cashel reçoit un billet de Shelley lui demandant d’apporter discrètement à Lerici, où ils passent l’été, le portefeuille qui contient des lettres intimes de Claire à Shelley. Cashel découvre des relations cachées, lui-même reçoit des avances.
Aux péripéties militaires succèdent des parties mondaines et amoureuses qu’il observe avant d’y être mêlé, surtout après qu’on lui a présenté la « contessa » Raffaella Rezzo, mariée avec un homme riche, « pas exactement belle, mais puissante, unique » : elle sera l’amour de sa vie. Mais il quittera Ravenne où elle vit, « devenu aveugle à la beauté depuis qu’une beauté l’avait trahi ».
Aimer vs partir : Cashel va vivre de nombreuses aventures, continuer à écrire, connaître le succès mais aussi la prison, voyager jusqu’à Zanzibar. Son histoire, c’est « toujours aller de l’avant, mais en laissant derrière lui des gens qu’il aimait ». Ecrit à la troisième personne, Le romantique tient du roman picaresque. Je me suis moins attachée à Cashel Greville Ross qu’à Brodie Moncur, dans L’amour est aveugle, mais sa traversée du monde au XIXe siècle ne manque pas de ressort.