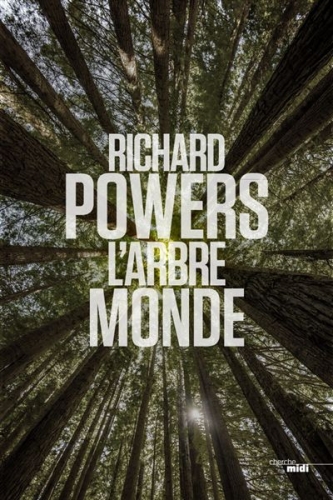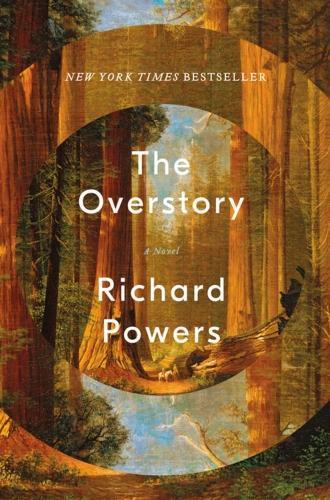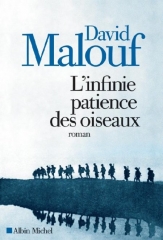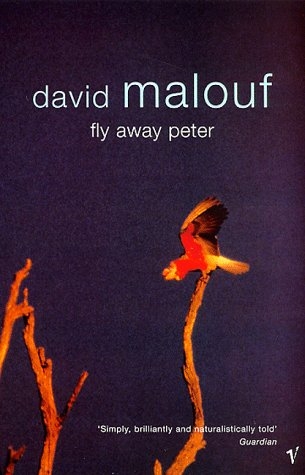Quel bonheur de découvrir chez David Malouf, romancier australien (né en 1934) jamais lu jusqu’à présent, une écriture sobre et une grande sensibilité dans la manière de montrer le monde. L’infinie patience des oiseaux (Fly away Peter, 1982) n’a été traduit en français (de l’anglais (Australie) par Nadine Gassie) qu’en 2018. Deux cents pages de fine observation des oiseaux et de la paix, dans les premiers chapitres lumineux, puis des hommes, des oiseaux et de la guerre.
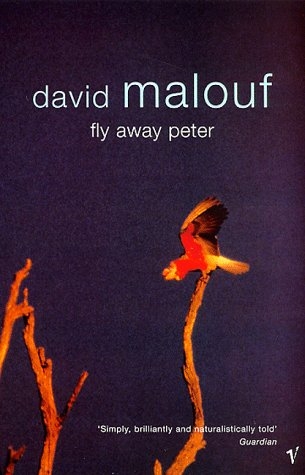
« Toute la matinée, loin là-bas sur sa gauche où la lumière des marais finissait et les terres agricoles commençaient, une forme disgracieuse s’était élevée hors d’un pré invisible et avait décrit de lents circuits dans l’air, grimpant, piquant, ballottant un peu, puis disparaissant sous les arbres. » Avec les yeux et les jumelles de Jim Saddler, nous observons « une vaste population d’oiseaux aquatiques » au-dessus des marécages non loin du Pacifique.
Tous ces oiseaux qui vont et viennent d’une partie de la terre à l’autre le fascinent, il connaît leur nom, leurs comportements, et quand Ashley Crowther, 23 ans, rencontre Jim, 20 ans, sur les terres héritées de son père où il est revenu après ses études à Cambridge puis en Allemagne (« pour y étudier la musique »), en 1914, son tempérament d’esthète est immédiatement séduit par la manière dont Jim lui fait écouter le chant d’un oiseau puis lui parle de l’oiseau-dollar – « Rolle oriental, précisa Jim. Il vient des Moluques. »
Ashley, même quand il regarde, n’a « aucun nom à mettre sur les choses ». Il apprécie ceux qui savent le faire, tout comme il accueille son ami Bert, passionné d’aviation, qui fait voler son « zinc » dans la région. Enchanté des connaissances de Jim, il lui offre de l’employer à répertorier les espèces d’oiseaux sur ses terres, dont il veut faire « un sanctuaire » plutôt que de les domestiquer à la manière anglaise. Jim est ravi, malgré la mauvaise humeur de sa brute de père quand il l’apprend.
« Si Ashley avait découvert Jim, ce fut Jim qui découvrit Miss Harcourt. Miss Imogen Harcourt. » Jim observe un échassier sur un pan de berge, « l’un de ces petits chevaliers sylvains qui apparaissent chaque été et viennent, pour la plupart d’entre eux, du nord de l’Asie ou de la Scandinavie », et aperçoit soudain dans l’axe de ses jumelles un visage sous une capeline : une femme a dans le viseur de sa boîte noire le même échassier que celui qu’il vient d’observer. Dans la cinquantaine, toujours équipée de son tripode, la photographe passe pour un peu folle.
Miss Harcourt l’accueille sans chichis dans sa maisonnette en aval de la rivière quand il vient se présenter et lui propose une tasse de thé. Elle sait qui il est : l’homme aux oiseaux qui dresse des listes précises pour Ashley Crowther. « Elle était indépendante, mais pas bizarre. » Dans sa chambre noire, il découvre le chevalier « avec une netteté parfaite sur un arrière-plan flou de terre et de touffes d’herbe » : « Parfait, souffla-t-il. – Oui, dit-elle. J’en ai été contente aussi. »
Jim et Ashley s’entendent dans l’observation silencieuse des oiseaux. « Nul ne parlait. C’était curieux, cette façon qu’avait le lieu de s’imposer à eux et de les subjuguer. Même Ashley Crowther, qui préférait la musique, était ici silencieux et posé. Il demeurait assis sans bouger, sous le charme. Et peut-être, songeait Jim, que c’est aussi de la musique, cette sorte de silence. »
« La guerre finit par arriver, à la mi-août, mais discrètement, l’écho d’un coup de feu tiré des mois en arrière qui avait pris tout ce temps pour faire le tour du monde et les atteindre. » Jim n’en revient pas de l’effervescence qui s’empare des gens autour de lui, de l’enthousiasme des jeunes hommes à s’engager. A l’époque des grandes migrations, derniers jours d’août et premiers de septembre, il observe et note les nouvelles arrivées des « réfugiés », comme les appelle Imogen Harcourt : hirondelles des arbres, pluviers à face noire, bécasseaux maubèches…
Jim finira par s’engager comme soldat, lui aussi, avant qu’Ashley, entretemps marié et devenu père, parte à son tour en Europe comme officier. « Le monde dans lequel Jim se retrouva ne ressemblait à rien qu’il eût jamais connu ou imaginé. C’était comme si dans son sommeil il avait pris un mauvais tournant, était arrivé du côté obscur de sa tête et y était resté coincé. »
D’autres « gars parfaitement ordinaires comme lui » sont impliqués. Il aime écouter leurs histoires – « et agissant comme une sorte de réconfort intime pour lui seul, il y avait la présence des oiseaux, qui permettait à Jim d’établir dans sa tête une autre carte, où les deux parties de sa vie, ici et là-bas, étaient reliées, et de retrouver par moments son chemin vers un cycle naturel des choses que les oiseaux continuaient, eux, à suivre sans perturbation. »
A l’approche de la ligne de front, tout empire. Les caillebotis sous eau dans les tranchées, l’humidité, l’odeur, les cadavres, les heures d’attente sur les banquettes de tir, les rats et finalement les explosions qui tuent l’un, épargnent l’autre, tout devient monstrueux. L’infinie patience des oiseaux commence dans l’éblouissement et se termine à l’opposé, avec les choses terribles de la guerre que David Malouf rend avec simplicité, de plus en plus rarement interrompues par le chant d’un rossignol.
 « « Le voilà, dit Loki, inutilement. C’est Mimas. »
« « Le voilà, dit Loki, inutilement. C’est Mimas. »