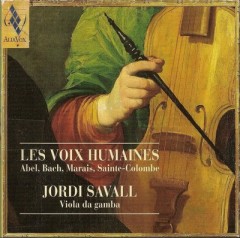Le jour peut entrer
traverser les feuillages
du fer et du verre
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
Le jour peut entrer
traverser les feuillages
du fer et du verre
des traits de lumière
sur l’étang vers l’arbre roux
tenue de saison
« Dans le jardin, de temps à autre, Enjo voyait passer l’homme aux tempes grises, une bêche sur l’épaule ou un éventail à la main. Elle ne lui avait encore jamais adressé la parole et celui-ci semblait l’éviter, arborant un sourire contrit lorsque leurs itinéraires malgré tout se croisaient. Son livre tombé sur les genoux, délaissant les dragons et les princes, c’est d’une attention soutenue qu’elle l’observait alors qu’il taillait un arbre avec une application d’orfèvre, ou agençait des pierres comme s’il s’agissait d’ossements d’un dinosaurien. Il y avait dans ses gestes toute l’étrangeté de la constance. »
Hubert Haddad, Le peintre d’éventail

Maison de thé dans le jardin aux azalées
Yoshida Hiroshi, 1876–1950 © Museum of Fine Arts Boston
Retour au Japon avec le dernier roman de Hubert Haddad, Le peintre d’éventail. Celui qui ouvre et ferme le récit, Xu Hi-Han, né de parents chinois (Taïwan), avait quinze ans quand il a rencontré Matabei Reien et fréquenté son atelier à Atôra. Ce peintre d’éventail inconnu avait choisi de finir sa vie là, « entre montagne et Pacifique », parmi les grands arbres.
"Fin novembre au parc Hibiya" © Tokyo-Paris allers-retours, le blog de sylvie b
Hi-Han, à dix-huit ans, est parti étudier à Tokyo et c’est en reconnaissant le vieil homme en piteux état, sur une photo de magazine, qu’il décide, plein de repentir, d’aller le retrouver. Il recueillera ses dernières paroles : « Ecoute le vent qui souffle. On peut passer sa vie à l’entendre en ignorant tout des mouvements de l’air. Mon histoire fut comme le vent, à peu près aussi incompréhensible aux autres qu’à moi-même. »
Vivre d’espérance jusqu’à l’heure du chaos, voilà comment Matabei résume sa vie : « L’histoire vraie de Matabei Reien – celle qui concerne les amateurs de haïkus et de jardins – commence vraiment ce jour d’automne pourpre où dame Hison l’accueillit dans son gîte. » Quand il s’est installé dans la pension « en bas de la première montagne », c’était au départ pour quelques jours, « histoire de changer d’air ». Les arbres, le lac Duji, la forêt de bambous géants, « cette lumière cendrée », voilà ce qui l’y a retenu, et les chants d’oiseaux si variés.
La plupart des pensionnaires, célibataires comme lui, sont heureux de s’éloigner du bourg et de découvrir derrière l’auberge « le plus beau jardin qui fût ». Il faut presque un an à Matabei pour remarquer la présence du peintre jardinier – « maître Osaki avait atteint un rare degré d’invisibilité » – et sa baraque à l’ombre d’un grand châtaigner, au fond du jardin. Leur hôtesse, une « belle femme mûre », est une ancienne courtisane d’un commerce agréable.
C’est en se promenant que Matabei, du haut d’une élévation, retrouve devant une vue splendide le goût de dessiner. Après la disparition de sa famille dans un bombardement qui l’a laissé orphelin, « il s’était peu à peu reconstruit à Kobe, dans le quartier européen » où après des études avortées et divers emplois, il avait connu le succès comme peintre abstrait et designer. Un jour, il percute en voiture une jeune femme qui a fait irruption à la sortie d’une voie souterraine dans la banlieue de Kobe – un regard étonné, un sourire, puis le choc –, l’étudiante meurt le soir même aux urgences. Et quelques jours plus tard, c’est le grand séisme de 1995, que Matabei vit comme « une réplique » de ce drame.
A la pension, sa chambre donne de plain-pied sur le jardin et un soir, il aperçoit dans sa baraque éclairée le jardinier en train de peindre : « Osaki Tanako élaborait des éventails de papier et de soie aux trois couleurs d’encre. » Celui qui a transformé la friche de dame Hison en jardin d’agrément offre le thé à Matabei, ils font connaissance. Mais Matabei ne confie à personne ce qui a mis fin à sa vie antérieure, la mort d’une jeune fille inconnue, plus encore que le tremblement de terre dévastateur.
Les saisons se succèdent à Atôra, il y jouit du jardin – « Le temps s’écoulait uniformément, fleuve sans source ni estuaire. » Le vieux jardinier finit par lui proposer de l’aider un peu, il est depuis le début au service de dame Hison, comme la vieille cuisinière, fatiguée elle aussi. Osaki et Matabei parlent de l’art des éventails, du jardin, du vent.
Sur un éventail que le jardinier lui offre, où il a peint un paysage « d’une sublime harmonie », figurent ces trois vers :
« Chant des mille automnes
le monde est une blessure
qu’un seul matin soigne ».
L’art du haïku est au cœur de ce roman ; l’auteur a d’ailleurs publié à part Les haïkus du peintre d’éventail (composés pendant l’écriture du roman). Quand il fait le bilan de sa vie, Matabei que personne n’attend nulle part s’interroge : « Peindre un éventail, n’était-ce pas ramener sagement l’art à du vent ? »
Atôra ou la quête d’une sagesse nouvelle, voilà ce que conte Hubert Haddad dans Le peintre d’éventail. Une quête née d’une souffrance, d’une absence, nourrie de belles rencontres dans ce « havre d’oubli » : Osaki, dame Hison qui lui permet de partager sa couche de temps à autre, un moine aveugle, puis ce jeune garçon engagé pour aider au jardin et à la cuisine, Hi-Han. Et enfin, Enjo, une étudiante recueillie par l’aubergiste, d’une beauté troublante.
« Le manuel du parfait jardin de maître Osaki se nichait donc, dessins et poèmes, dans les pliures de ses trois lots d’éventails. » Au fil du récit, une harmonie se dessine, mais aux deux tiers du roman, tout est balayé. Hubert Haddad, né à Tunis en 1947, en France depuis 1950, fasciné depuis toujours par le Japon, nous entraîne avec Le peintre d’éventail (prix Louis-Guilloux 2013) au pays du raffinement, et de la catastrophe. Poétique. Bouleversant.
« Un art s’ordonne sur l’économie irréductible de l’espèce humaine. Sa mesure n’est pas la proportion du corps, comme dans la statuaire antique, ou bien les géométries naturelles, la rigide observance des symétries cristallines ou végétales, ni même l’aléatoire des nuées dans le ciel. Il s’ordonne sur la mesure de la voix qui n’en finit pas de prévaloir dans l’instant, et où l’homme connaît les limites d’une singularité irréductible.
La voix plus que le corps et son agir tient l’humain et l’homme, lui donne
comme songe et fragrance le surgissement incomparable et la marque pressentie, suspectée. »
Daniel Klébaner, L’art du peu