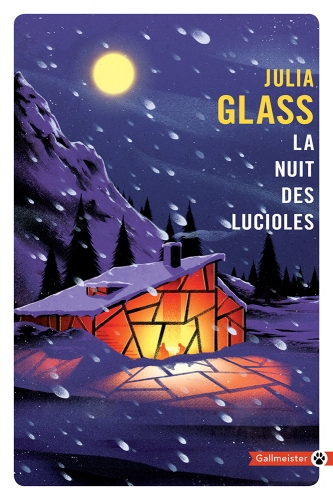Il y a bien des années, j’avais pris plaisir à lire Jours de juin de la romancière américaine Julia Glass. En apprenant que certains personnages reviennent dans La nuit des lucioles (And the Dark Sacred Night, 2014, traduit de l’américain par Anne Damour), j’avais noté ce titre, qui s’est rappelé à moi lors de ma dernière visite à la bibliothèque.
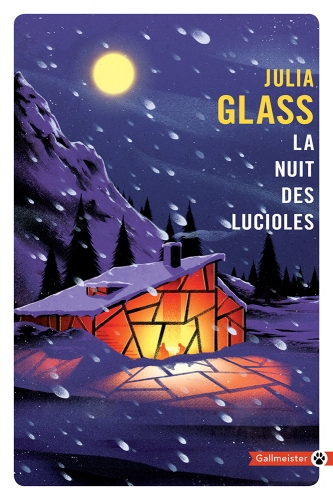
Le roman s’ouvre sur la rencontre, à la fin des années soixante, entre Daphne et Malachy, deux jeunes musiciens qui font connaissance durant un séjour de master class et d’études musicales de haut niveau ; elle est violoncelliste, lui, flûtiste. Puis Kit (Christopher), le personnage principal, apparaît au premier chapitre, intitulé Quelqu’un à aimer. Au lendemain d’Halloween, c’est lui, leur père, qui s’occupe de réveiller les jumeaux, Will et Fanny, et de les conduire à l’école après le petit déjeuner.
A son retour, Sandra, sa femme, a trouvé dans le courrier une notification de refus pour un poste d’assistant (Kit n’a pas complété son dossier à temps), c’est un sujet de tension entre eux : elle estime qu’il ne fait pas assez d’efforts pour retrouver un emploi. Elle lui indique avant de partir les tâches du jour pour lesquelles elle compte sur lui – il y a toujours à faire dans leur maison modeste de 1910. Il n’osera pas lui parler tout de suite de la fuite dans le toit qu’il a constatée au grenier, la réparation sera coûteuse.
Historien de l’art, Kit s’est passionné pour l’art des Inuits, il a voyagé au Canada pour s’en rapprocher. C’est peu après qu’ils sont tombés amoureux. A présent, sa femme n’en peut plus de son « inertie », elle a recommencé une psychothérapie « pour ne pas devenir folle », même s’ils n’en ont pas vraiment les moyens. Aux yeux de Sandra, il est temps pour Kit, à quarante ans passés, de bouger, « de partir et de trouver ». Elle lui conseille d’aller interroger Jasper, son beau-père, le seul père qu’il ait eu, pour trouver des réponses à ses questions sur son père biologique dont sa mère refuse obstinément de lui parler.
A l’époque où ils vivaient ensemble, sa mère et lui, « seuls tous les deux », elle jouait souvent du violoncelle, ce qui la rendait heureuse tous les jours de sa vie. « Le bonheur ne vient pas comme ça, uniquement parce que tu le désires ou le mérites, avait-elle dit. Je ne pense pas que tu sois trop jeune pour le savoir. Tu dois apprendre seul à faire entrer le bonheur dans ta vie. Parfois, quand il menace de s’éloigner, il te faut tendre le bras par la fenêtre et l’attirer à toi, comme si tu capturais un oiseau. »
Tout le roman tourne autour de cette question vitale pour Kit : qui était son père biologique ? pourquoi ne l’a-t-il pas connu ? est-il encore en vie ? Et pour Sandra : y a-t-il des antécédents utiles à connaître pour la santé des jumeaux ? Kit admet sa situation de blocage et part retrouver Jasper, qu’il n’a plus revu depuis dix ans, et qui vit seul dans la région des Green Mountains (Vermont).
Que son fils adoptif veuille « faire un break » chez lui réjouit Jasper, une bonne nouvelle pour lui alors qu’un vieux pin vient de s’abattre sur un angle de sa maison, à protéger de la neige annoncée, et que son vieux chien qui menait l’attelage est mort. Jasper ne connaît pas toute l’histoire du père de Kit ; il en sait tout de même bien plus que Kit, mais il a promis le secret à sa mère.
Je ne vous en dis pas plus sur La nuit des lucioles, un récit qui saute d’une époque, d’un couple, d’une famille à l’autre. Les personnages sont nombreux, il vaut mieux prendre le temps de bien les situer dès le départ. On finit par s’y retrouver en avançant. A travers les recherches de Kit, Julia Glass aborde de nombreux thèmes : la quête des origines, bien sûr, l’art et la musique, la vie de couple, l’éducation, les relations entre parents et enfants, les liens familiaux, les problèmes de santé, les choix et les modes de vie différents selon le lieu et le milieu…
Bien que parfois décousu, ce long roman retient par les multiples situations où sont plongés ses personnages de tous âges. L’abondance de détails narratifs est à double tranchant : cela facilite l’immersion dans l’intrigue, en revanche cela met les émotions à distance. Pour ma part, j’ai préféré Jours de juin, le premier roman de Julia Glass. Celui-ci, je l’ai lu avec l’esprit un peu ailleurs, cela joue aussi dans mon ressenti. A vous de voir. Un extrait bientôt.
 « Le Noël suivant, après avoir invité Bart chez Nana et Grandpa à chanter les chants de saison et à boire l’eggnog, elle annonça à Kit, dans l’intimité de son ancienne chambre, où les manteaux s’entassaient sur les lits jumeaux, que dès que le divorce serait prononcé, Bart et elle se marieraient. Rien de compliqué, lui assura-t-elle, juste une cérémonie civile (comme s’il pouvait se soucier de la taille de la réception, de ce que sa mère porterait, des vœux qu’elle prononcerait devant il ne savait quelle puissance supérieure). Et ensuite elle irait s’installer dans la maison de Bart.
« Le Noël suivant, après avoir invité Bart chez Nana et Grandpa à chanter les chants de saison et à boire l’eggnog, elle annonça à Kit, dans l’intimité de son ancienne chambre, où les manteaux s’entassaient sur les lits jumeaux, que dès que le divorce serait prononcé, Bart et elle se marieraient. Rien de compliqué, lui assura-t-elle, juste une cérémonie civile (comme s’il pouvait se soucier de la taille de la réception, de ce que sa mère porterait, des vœux qu’elle prononcerait devant il ne savait quelle puissance supérieure). Et ensuite elle irait s’installer dans la maison de Bart.