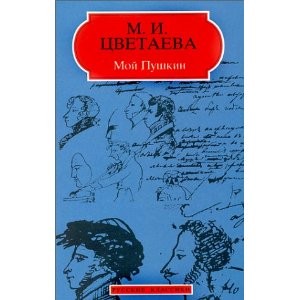Marina Tsvetaïeva (ou Tsvetaeva, 1892-1941) est tout sauf tiède, sa plume est de feu. Quand elle décide d’écrire sur Pouchkine, ce n'est pas sur le poète sacralisé par les Soviétiques – « notre Pouchkine ». C'est Mon Pouchkine (Moï Pushkin, 1937), tout simplement, son Pouchkine intime. André Markowicz (traducteur) : « Face à ce « nous », Marina Tsvetaïeva dit « je ». Face au Pouchkine statufié, non seulement elle parle de la formation même de son art, mais elle affirme un aspect essentiel du mythe de Pouchkine en Russie. Pouchkine est, pour chacun de nous, l’auteur de notre enfance. »

Naumov, Le Duel
« Ca commence comme un chapitre du livre de chevet de nos mamans et de nos grand-mamans – Jane Eyre – le mystère de la chambre rouge.
Dans la chambre rouge, une armoire mystérieuse.
Mais avant l’armoire mystérieuse, autre chose : un tableau dans la chambre de ma mère – Le Duel. » (Incipit)
Et Tsvetaïeva de décrire la scène, de nommer les protagonistes, D’Anthès et Pouchkine, la neige, les hommes en noir. A trois ans, elle comprenait : « Ce coup de feu, c’est nous tous qu’il a blessés au ventre. » Dans la chambre noire et blanche de sa mère, Pouchkine est son premier poète, un poète assassiné. Et depuis, elle divise le monde ainsi, la foule et le poète, contre la foule, c’est son choix. Avec les deux autres tableaux de la maison « aux trois étangs » (sa famille habitait Moscou, passage des Trois Etangs), ce Duel « préparait, en vérité, l’enfant au siècle de frayeur qui l’attendait. »

La statue de Pouchkine (Moscou)
« Pouchkine était nègre. » Cheveux crépus, lèvres lippues, des yeux « noirs comme jais » dont le blanc était bleu. « Le poète russe est un nègre. Le poète est un nègre. Le nègre, on le tue. Nécrologie du poète. » Avant ce poète mort en duel, il y a dans la vie de Marina Tsvetaïeva « la Statue-Pouchkine », but et limite des promenades. Quand la nourrice de sa sœur annonçait « A Pouchkine, on se repose », Marina la reprenait : « Pas à Pouchkine, à la Statue-Pouchkine ».
Première mesure de l’espace, premiers jeux : au pied du socle, elle posait sa « poupée-petit-doigt », une poupée en porcelaine blanche qui se vendait dans les quincailleries – déjà le noir et le blanc – et se demandait combien de figurines il faudrait empiler pour faire une Statue-Pouchkine. Première rencontre avec les matériaux : fonte, porcelaine, granit. Première leçon de hiérarchie : Marina est une géante pour la poupée, une petite fille pour Pouchkine – « Mais la Statue-Pouchkine, qu’est-elle donc pour la figurine ? »

Pouchkine jeune
Tsvetaïeva aime la race noire du géant, le sang noir dans les veines blanches du sang-mêlé, preuve de la nullité des théories racistes. Un jour, en aparté, sa mère attire son attention sur un visiteur qu’elle vient d’introduire au salon, « le fils de Pouchkine », « tout le portrait de son père. » La fillette de quatre ans est si troublée qu’elle ne sait où poser le regard en le voyant sortir, elle ne voit que l’étoile qu’il porte sur la poitrine. Son père la reprend : « Tu as vu le fils de Pouchkine. Tu pourras le raconter à tes petits-enfants ». Ce n’est que bien plus tard, à Paris, en 1928, que Tsvetaïeva découvre que pour venir chez eux, le fils de Pouchkine est passé devant la maison des Gontcharov où est née la future peintre Natalia Serguéevna Gontcharova, « la petite-nièce de la femme de Pouchkine ».
Dans l’armoire défendue de l’enfance, la sœur aînée de Marina possédait un trésor défendu, les Œuvres choisies d’A. S. Pouchkine, « un volume énorme, bleu-violet » avec le titre en lettres d’or. La petite lit dans l’armoire, « le nez contre le livre, sur l’étagère, dans le noir, presque » et reçoit Pouchkine « en plein dans le cœur, en plein dans le cerveau. »

Marina Tsvetaïeva
D’abord Les Bohémiens aux noms inédits, et ce mot tout neuf : « l’amour ». A la nourrice de sa petite sœur, qui demande à Marina de raconter une fable, elle raconte Les Bohémiens, le texte qui lui a « inoculé » l’amour. Plus tard, à six ans, souvenir d’une soirée publique pour Noël, « Tatiana et Onéguine », une scène d’Eugène Onéguine : « Ma première scène d’amour détermina toutes les autres, cette passion pour l’amour malheureux, impossible – à sens unique. Dès cet instant, j’ai refusé toute idée de bonheur et je me suis vouée – au non-amour. »
Il y avait un autre Pouchkine, reçu en cadeau : l’édition scolaire, « le Pouchkine aseptisé », dont elle n’aimait que « le petit Africain, la main sous le menton. » Ce Pouchkine bleu et maigre, elle ne le lisait pas. Le poète, souvent, questionne, ce qui troublait l’enfant – « Je dois au Pouchkine historique de mon enfance mes plus inoubliables visions. » Souvenir de certains mots, inattendus, de certains vers, terrifiants. De scènes qui l’emplissent de peur, de pitié, de tristesse. Elle les cite, ressuscite ses impressions d’alors, rêve de ce poème sur la mer qu’elle n’a jamais vue encore : « Adieu, espace des espaces ! » Et sa déception quand leur mère les emmène pour la première fois « à la mer » – « ça, la mer ? » Il lui faudra du temps pour l’aimer, avec Pouchkine, grâce à l’amour de Pouchkine pour la mer.
Mon Pouchkine, écrit à Paris à quarante ans passés, est le récit d’une enfance, d’une initiation, d’une rencontre avec un poète qui la fait poète à son tour. Le récit, loin de tout académisme, est une véritable quête proustienne où la littérature se mêle au plus intime de la vie. Il est suivi de neuf poèmes de Pouchkine traduits en français par Marina Tsvetaïeva elle-même, dont Adieux à la mer – en voici la quatrième strophe :
« Comme j’aimais tes indolences,
Tes fauves pas, tes rythmes lents,
L’intensité de tes élans,
L’immensité de tes silences. »