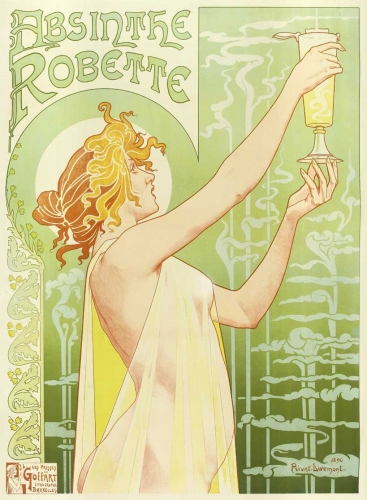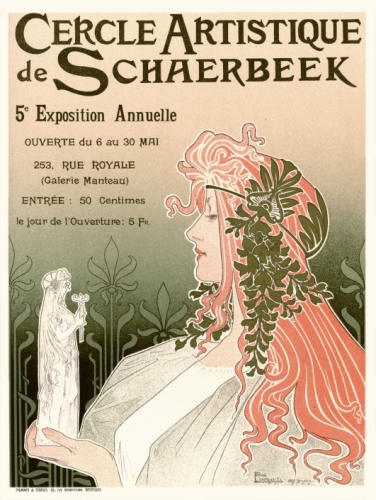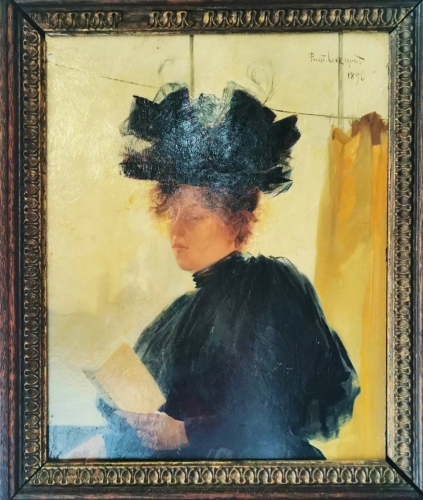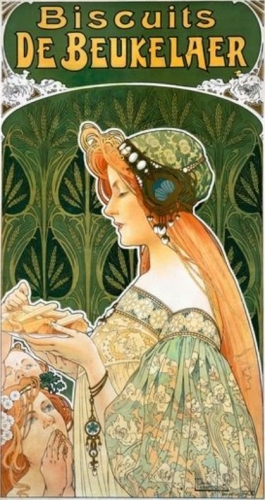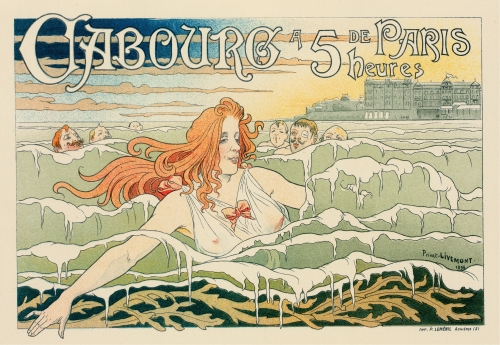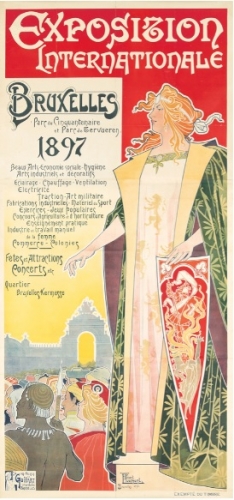Après la Brafa au Heysel, je ne m’attendais pas à recevoir une nouvelle invitation à une foire d’art : Antica Brussels vient de présenter à Tour & Taxis sa première édition. Dans le même esprit qu’Antica Namur, ce salon printanier a rassemblé 72 exposants, des galeristes et des antiquaires belges et étrangers.

Un ensemble de 1925 (galerie Wolvesperges)
1925 a fait date dans l’histoire de l’art, avec la fameuse Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris, qui a donné son nom à l’Art déco. Le meuble et la toile ci-dessus datent de cette période de renouveau artistique. Un « rare bas d’armoire de la maison De Coene » en acajou, ébène de Madagascar, bois de rose, avec une belle applique en bronze doré (la clé s’y dissimule au pied du bouquet) est surmonté d’une nature morte « aux fruits et à la bouteille de vin » signée Robert De Winne.

Coupe Chine - Cie des Indes, XVIIIe s.,
et composition florale contemporaine aux fleurs de porcelaine (La Métairie)
Un passionné de porcelaines françaises proposait des objets anciens et des céramiques contemporaines. Son stand illustre bien le public ciblé par le salon Antica, celui des amateurs de ventes dites « bourgeoises », à la recherche d’objets de qualité et aussi de prix accessibles. Des fleurs de porcelaine piquées dans des coupes et vases anciens les rendent très décoratifs, comme des « objets de curiosité ».

Léon Spilliaert, Sirène (Baigneuse), 1910,
Encre de Chine, pinceau, crayon de couleur sur papier, 647 x 491 mm (galerie Lancz)
Je vous montre toujours volontiers des œuvres de Léon Spilliaert, un de mes peintres belges préférés. J’ai admiré cette Sirène ou Baigneuse, une encre de 1910 – beaucoup plus moderne à mes yeux que La Violoniste ou La Musicienne, également présentée sur le stand. Elle joue du violon devant un décor qui correspond à cette période tardive où Spilliaert peignait des arbres et des paysages très stylisés (un catalogue de l’exposition de 2016 sur ce thème est disponible en ligne).

Cercle du Maître au Perroquet (1500-1549), Marie Madeleine lisant un livre,
Huile sur panneau, 45 x 29 cm (Jan Muller Arts & Antiques)
La peinture ancienne reste une valeur sûre. J’ai particulièrement aimé cette lectrice du XVIe siècle, Marie-Madeleine lisant un livre. Le petit paysage flamand avec ses promeneurs (en haut) offre une respiration dans ce beau portrait où tout est peint avec finesse, du beau visage de Marie Madeleine à ses vêtements, sa coiffe perlée, ses bagues, et le joli récipient sur la table (un brûle-parfum ? Il nous faudrait un Harold Hessel pour le désigner par le terme exact).

Josep Llimona i Bruguera, Desconsol, 1907 (modèle) - 1934 (exécution),
bronze et socle en marbre, fonte Barberi, 53 x 61 x 44,5 cm (Gothsland)
Rien de tel qu’une grande sculpture pour donner vie à un stand, comme cette œuvre emblématique de Josep Llimona i Bruguera, moderniste catalan. La première version de Desconsol, en marbre, se trouve au musée du Prado ; plusieurs répliques ont été réalisées de son vivant. Celle-ci offre un beau contraste entre ce corps féminin ployé par le chagrin et le socle en marbre.

© Isabelle Thiltgès, Heaven, bronze, 2021, 28 x 32 x 19 cm
A l’opposé de cette œuvre quasi funéraire, Heaven d’Isabelle Thiltgès, chante l’amour fusionnel : un bronze contemporain, tout « en courbes, contre-courbes, et rondeurs » (Sophie Cloart sur le site de l’artiste belge). J’adore, pas vous ? Si l’Art nouveau était forcément montré à Antica Brussels 2023, le thème de cette année était « Elles font l’art » : les « artistes, galeristes, expertes, collectionneuses,... et autres personnalités qui contribuent à l’histoire de l’art » étaient présentes tout au long du parcours.

© Marthe Guillain, Intérieur, s.d., Huile sur panneau (Jean Nélis)

Anna Boch, Les lanternes japonaises, s.d., huile sur toile, 57,5 x 75,5 cm (Remarkable Paintings)
Des œuvres de peintres belges ont retenu mon attention : une femme dans un Intérieur de Marthe Guillain, une toile haute en couleurs ; deux superbes dessins au crayon de Jenny Montigny ; un bouquet de fleurs de Juliette Cambier ; un intérieur de salle à manger d’Anna Boch, aux couleurs difficiles à rendre (photo jaunie par l’éclairage), Les lanternes japonaises. On y voit ces fleurs sur la table où deux personnes viennent de prendre le thé.

© Adolphe Keller (1880-1968), L'heure du thé (détail), huile sur toile, 73 x 93 cm (Van de Ven)

Rik Wouters, Femme en rouge, pastel sur papier, 44 x 28 cm
Aussi j’enchaîne avec cette jolie scène qui respire le plein air. L’heure du thé est signée Adolphe Keller, un peintre qui a habité un temps au Rouge Cloître. Il est né à Auderghem, commune bruxelloise voisine du Boitsfort cher à Rik Wouters dont ce beau pastel, Femme en rouge, est bien sûr un portrait de Nel, sa femme.

Fernand Khnopff, Etude de jeune fille, 1899 (galerie Raf Van Severen)
Je voulais éviter l’énumération dans ce billet, mais j’ai tout de même envie de vous signaler ce très doux nu féminin de Fernand Khnopff, « Etude de jeune fille », présentée dans un cadre doré spectaculaire – très beau, voire un peu « trop ». Il est vrai que la scénographie importe pour mettre des œuvres d’art en valeur : l’œil se laisse accrocher par un cadre ou une présentation bien choisie.

Galerie Philippe-John Farahnick

Dante Zoi, Danseuse orientale, vers 1910, Marbre de Carrare,
Socle en Portor, 117 x 54,5 x 31,5 cm
Voyez ces laques rouges et cette grande peinture qui se valorisent mutuellement devant le stand de Philippe-John Faraknick. Ou cette magnifique Danseuse orientale qui attire le visiteur sur celui de la galerie Artimo.

© Mark Dedrie, Silence (brown) / Insight / Early Bird (green),
bronzes (Early Birds Art Gallery)
Belle idée aussi, ces oiseaux perchés de Mark Dedrie chez Early Birds, vous ne trouvez pas ? Comme j’interrogeais ce galeriste de Knokke sur le sculpteur, j’ai appris que ces bronzes sont de son père. Cette première édition d’Antica Brussels (l’anglais, langue internationale, si commode pour éviter les appellations bilingues) était très réussie. Rendez-vous est pris pour la prochaine.