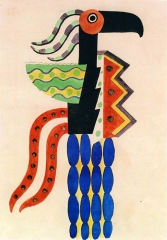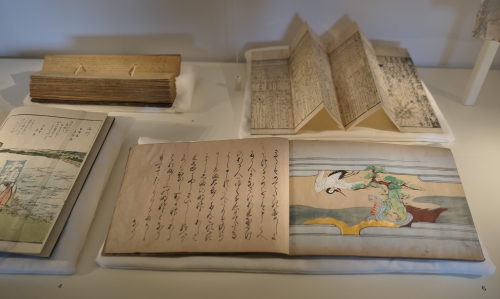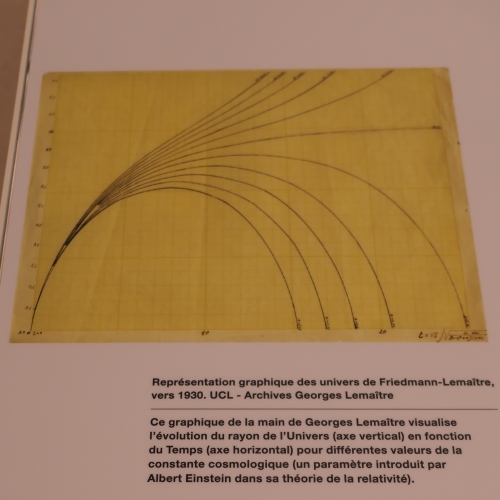Fernand Léger (1881-1955) a souvent déclaré que « le Beau est partout », c’est le titre de la rétrospective qui vient de s’ouvrir à Bozar, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. « Le Beau est partout, dans l’ordre de vos casseroles, sur le mur blanc de votre cuisine, plus peut-être que dans votre salon XVIIIe ou dans les musées officiels. » Ou encore, dans un rapprochement entre le tableau et la photographie, « Le Beau est partout autour de nous, il fourmille, mais « il faut le voir », l’isoler, l’encadrer par l’objectif. »

© Fernand Léger, Le Transport des forces, 1937, 4,7m x 8m. Adagp, Paris 2017 /
CNAP / Photographie Yves Chenot
On découvre d’abord une peinture monumentale, Le transport des forces, une toile de huit mètres sur cinq créée pour l’Exposition universelle de 1937. Les courbes de la nature y contrastent avec les formes géométriques du monde moderne. La peinture de Fernand Léger explore et réinvente le monde, ses objets, ses figures, dans une esthétique très reconnaissable « jouant sur l’opposition des formes et des couleurs, de l’aplat et du modelé, jusqu’à l’abstraction » (Guide du Visiteur, source des citations).
Ce n’est pas encore le cas dans La couseuse (1910), peut-être un portrait de sa mère, mais déjà la rupture avec l’impressionnisme est claire, et aussi l’influence de Cézanne. Avant d’appliquer sa mécanique « tubiste » à tout ce qu’il rencontre, Léger a cherché sa voie du côté du cubisme, à sa manière, comme le montre La noce avec son cortège autour des mariés (première toile exposée au salon des Indépendants en 1911, encore proche de Picasso).

© Fernand Léger, Le Mécanicien, 1918. Huile sur toile, 65 x 54 cm © Adagp, Paris 2010
Le peintre veut rompre avec « la peinture sentimentale ». Prenant exemple sur les objets industriels, il veut aboutir à un tableau « propre » au « fini » soigné – « les formes lisses de l’industrie traduisent la mécanisation de la vie moderne, qui transforme les êtres et les choses ». Elément mécanique montre sa façon de peindre les volumes en dégradé de gris, comme les courbes de son Mécanicien à moustache qui porte une bague et fume le cigare.
Devant les œuvres de Fernand Léger, je perçois deux sortes de peintures que j’appelle en moi-même les claires et les sombres – une différence de tonalité, d’ambiance, due à la part du blanc et du noir. Distinction sans doute absurde chez ce peintre ami des couleurs pures, comme on peut le voir dans le beau Disque de 1918 (Madrid). Claire, la toile Le Pont du remorqueur « dégage une impression d’harmonie qui repose sur l’équilibre entre les lignes, les volumes et, surtout, les couleurs auxquelles Léger conférait une valeur constructive » (Thierry Saumier, Sud-Ouest). Sombre, la Nature morte, A. B. C., typique des années 1920 où le peintre introduit des lettres et des bribes de mots dans ses compositions.

© Fernand Léger, Le Pont du remorqueur, 1920, huile sur toile 96,5 x 130 cm © Photo S. K.
Fernand Léger est à l’occasion illustrateur – Rimbaud, Cendrars – ou décorateur : il peint des décors pour L’inhumaine de Marcel Lherbier. Le cinéma est pour lui « l’art de la modernité par excellence ». On peut voir à l’exposition son film Ballet mécanique (réalisé en 1924) où les objets, le rythme, le cadrage, tout concourt avant tout au mouvement. Le peintre aimait beaucoup Charlot et en a construit une marionnette en planchettes de bois peint qu’il désarticule joyeusement. Plus loin, des écouteurs offrent le son d’une des « sept séquences oniriques » du film Dreams That Money Can Buy de Hans Richter où Léger anime des éléments de mannequins en guise de personnages.
Une grande salle est consacrée au cirque et à la danse, « l’apogée du spectacle populaire ». « Rien n’est aussi rond que le cirque », écrit Fernand Léger, et il le montre : costumes pour « La Création du monde » avec les Ballets suédois ; lithographie en jaune avec le mot « Cirque » sous un visage de clown, la bouche béante ; magnifique Cirque Medrano ! Par ici, les trapézistes, les cyclistes, les acrobates, les danseurs… On s’assied pour explorer l’énorme Composition aux deux perroquets où les corps s’empilent.

© Fernand Léger, Le Cirque Médrano, 1918, Legs de la Baronne Eva Gourgaud, Collection Centre Pompidou, Paris Musée national d’art moderne, Centre de création industrielle © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Jacques Faujour/Dist. RMN-GP © SABAM Belgium 2018
Une salle d’angle illustre l’intérêt constant de Léger pour la photographie (à son arrivée à Paris en 1900, Léger était assistant photographe). En 1930, la designer Charlotte Perriand photographie des objets ramassés sur la plage ou en forêt (silex, rochers, neige, bûches…) Les dessins qu’ils inspirent à Léger « témoignent d’une sensibilité nouvelle aux formes naturelles, loin de l’esthétique de la machine ».
L’architecture, elle, est le domaine des structures géométriques et de la couleur. Léger collabore avec plusieurs architectes et vise un art mural, « collectif et populaire ». Autres champs d’exploration : la céramique (commencée à Biot, où se trouve le musée national Fernand Léger), la mosaïque, le vitrail (maquettes pour l’église du Sacré-Cœur à Audincourt).

© Fernand Léger, La lecture, 1924, Huile sur toile, 113,5 x 146 cm
Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, RMN-Grand Palais / Jacques Faujour © ADAGP, Paris
La figure humaine est traitée par le peintre comme n’importe quel objet, on le voit bien dans La lecture aux volumes cernés de noir, contrairement aux formes claires des Deux femmes debout. Toute sa vie, Léger défend des valeurs humanistes et prône « un art pour tous ». Réfugié aux Etats-Unis en 1940, il adhère au parti communiste à son retour en 1945, sans devenir pour autant « un peintre de parti ». Il illustre le poème Liberté de Paul Eluard. Les loisirs, à la fin du parcours, résument bien sa volonté de traiter des sujets populaires.
Vous avez jusqu’au 3 juin prochain pour visiter Le Beau est partout. Le souvenir du Grand déjeuner de Fernand Léger vu à La Boverie m’a incitée à visiter cette exposition, d’abord montrée au Centre Pompidou-Metz l’an dernier. Toutes les œuvres montrées à Bruxelles ne sont pas de cette veine, mais on y voit quelques chefs-d’œuvre comme Les grands plongeurs noirs ou Les constructeurs (cinq mètres sur deux), spectaculaire hommage aux travailleurs. « Pourtant ce tableau offert à la CGT a été refusé par le syndicat qui estimait que le « peuple » ne le comprendrait pas. La CGT était alors adepte du réalisme socialiste stalinien. » (Guy Duplat dans La Libre)

Cette rétrospective montre bien le cheminement du peintre et on y apprend, à la fin, que Léger a longuement enseigné et même ouvert sa propre école en 1934, l’Académie de l’art contemporain. Ont fréquenté son atelier Maria-Elena Vieira da Silva, Louise Bourgeois, Nicolas de Staël, entre autres, et même Gainsbourg. A la sortie du Palais, un clin d’œil : sur la palissade entourant le chantier de construction voisin, on a copié des motifs de Fernand Léger et certains visiteurs n’hésitent pas à prendre la pose devant cette fresque colorée surmontée par une grande grue jaune – on reste dans le ton.
 « En lisant de plus près le livre offert par Manu [une monographie épuisée sur van der Weyden], j’ai appris que la figure de Luc est généralement considérée comme un autoportrait de l’artiste, et j’ai pensé : ça me va. J’imagine aussi bien van der Weyden que Luc avec ce visage allongé, sérieux, méditatif. Que le premier se soit peint sous les traits du second, cela me plaît d’autant plus que, moi-même, je fais la même chose. »
« En lisant de plus près le livre offert par Manu [une monographie épuisée sur van der Weyden], j’ai appris que la figure de Luc est généralement considérée comme un autoportrait de l’artiste, et j’ai pensé : ça me va. J’imagine aussi bien van der Weyden que Luc avec ce visage allongé, sérieux, méditatif. Que le premier se soit peint sous les traits du second, cela me plaît d’autant plus que, moi-même, je fais la même chose. »