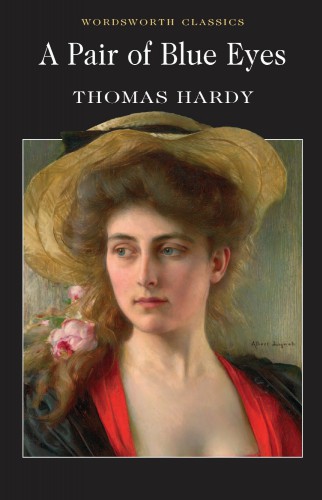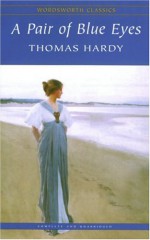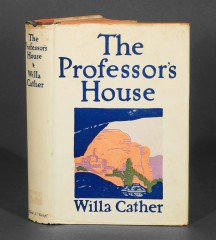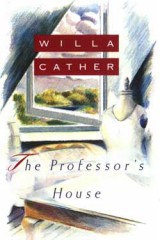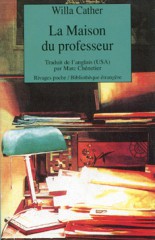« Tsunami » : le mot ramène au terrible tremblement de terre en Indonésie, fin décembre 2004, et à la vague meurtrière qui a tout emporté sur son passage. « Tsunami » : une œuvre extraordinaire de Nathalie van de Walle, à voir à Gembloux jusqu’à samedi prochain. Elle y a travaillé huit ans, bouleversée par les images du chaos, du tsunami et des autres catastrophes qui mettent notre terre sens dessus dessous.
Dans le cadre du Printemps des Sciences, au bel Espace Mohimont installé dans une ancienne ferme abbatiale, l’exposition « 360° Architecture du paysage » présente des œuvres de Nathalie van de Walle, ainsi que des créations de l’atelier sorcier et du projet « Art et science 2.0 ». Une vidéo d’un paysage à 360° accueille les visiteurs dans les salles du bas, l’exposition continue à l’étage, sous la charpente.
La double fresque « Tsunami », conçue d’abord pour être présentée en rond, à 360°, se présente ici, où elle est dévoilée pour la première fois dans son ensemble, en une longue courbe sous les voûtes anciennes. En entrant, on découvre d’abord, côte à côte, quinze xylogravures de 110 x 110 cm chacune, un gigantesque chaos, des scènes de destruction où reviennent certains motifs : des cabanes en bois, des pylones et des fils électriques arrachés, des arbres… Au verso de cette courbe se déploie une magnifique estampe sur papier laurier, longue de dix-sept mètres et de 120 cm de haut .

15 xylogravures; 110 x 110 cm, 2008-2013 © Nathalie van de Walle
Depuis toujours fascinée par les structures (murs, villes, chantiers, échafaudages...), Nathalie van de Walle déconstruit, reconstruit, réinvente sans cesse, explore des techniques variées, comme on a pu le voir dans ses expositions depuis 1980, en Belgique et en France. « Tsunami », œuvre monumentale, coupe le souffle par l’intensité avec laquelle elle montre le monde dans ses dévastations : en Indonésie, mais aussi ailleurs, là où la terre a tremblé, où un train a déraillé (Buizingen), où des tours se sont écroulées (11 septembre)…

Détail d'une xylogravure © Nathalie van de Walle
En découvrant les xylogravures, en déchiffrant leurs motifs, ici les roues d’une voiture retournée, là les bras d’un arbre mutilé, exploration sans fin des débris, on plonge dans la tragédie, les heures sombres. Tout cela semble figé dans l’horreur, mais le temps continue à se mouvoir dans l’espace. Spectateur, témoin, impossible d’être impassible. Impression de ne plus respirer, besoin de reprendre son souffle dans les clartés du ciel avant d’explorer plus avant le chaos sur terre.

Estampe, 17 x 1,20 m, 2013 © Nathalie van de Walle
Quel contraste quand on passe de l’autre côté ! Le dessin est le même, pas la technique : place au noir et blanc de l’estampe, à l’œuvre en continu, d’une force incroyable, lisse, surprenante. Ce sont les mêmes scènes de chaos sur terre, cette fois interprétées par la ligne, le trait, la pureté du dessin – « épure de la tragédie » (Chris Vander Stappen) Des deux côtés, la main de l’artiste a beaucoup œuvré, mais les gestes ont été très différents et pour le regard, l’expérience est tout autre aussi en allant du papier au bois, du bois au papier.

Estampe (détail) © Nathalie van de Walle
Autour du « Tsunami », Nathalie van de Walle expose aussi des œuvres de 2004, « paysages nuits », « paysages d’aubes » (eau-forte, collage, acrylique) d’une grande douceur. Le ciel et la terre, la ligne qui les relie, c’est leur fil conducteur. Regardez, par exemple, « Brume et paysages ». C’est comme si la paix répondait à la guerre.

Brume et paysages, 2004 © Nathalie van de Walle
Espace André Mohimont, Gembloux Agro-Bio Tech., avenue de la Faculté d’Agronomie, n° 5 à 5030 Gembloux (en semaine sur rendez-vous, le samedi 29 mars de 14h à 18h). Mise à jour 25/3/2014.