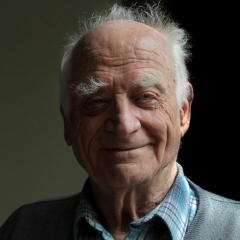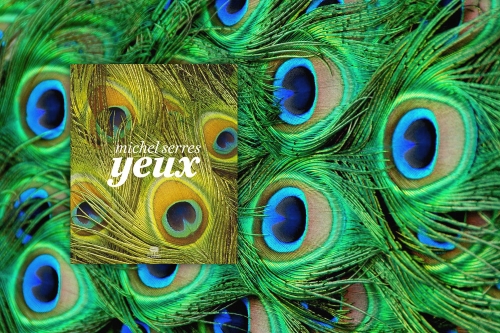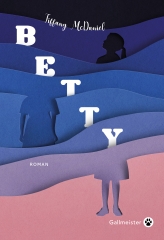Pourquoi pas une poignée de porte pour ouvrir ce premier billet balade de 2022 ? Je m’étonne, je me réjouis chaque fois que je me promène dans mon quartier et que j’y vois soudain, alors que je suis passée là mille et une fois, un détail jamais remarqué et pourtant remarquable. Cette fois, c’était peut-être à cause du soleil, si bas à cette saison, qui en ce premier jour de l’an faisait briller une poignée jaunie par le frottement des mains, joliment sculptée en forme de poisson.
La lumière est magicienne, j’en suis persuadée. Elle cache, elle montre, elle révèle. Voyez cette belle maison art nouveau que nous ne manquons jamais d’admirer au passage. Du côté ombre de l’avenue à cet instant, l’harmonie de sa façade était particulièrement mise en valeur. Quel accord en douceur entre ses briques claires et les bandeaux de pierre bleue, les reliefs des contours de porte et de fenêtres (des jolis nœuds du haut aux volutes du bas) éclairés juste comme il le fallait.
Un autre jour, le soleil allait bientôt se coucher sur la campagne quand au bord de la route – nous avions évité les chemins détrempés après une série de jours pluvieux –, ces deux autruches se sont tournées vers nous. Dans ce coin du Brabant flamand, les chevaux ont souvent remplacé les vaches d’autrefois. Verrons-nous se multiplier ces drôles de volatiles ? Impressionnant, leur regard noir.
Vous aurez deviné, si vous avez l’habitude de visiter ce blog, quel est le parc schaerbeekois que voici par un beau jour de janvier. Les jardiniers communaux ont bien travaillé cet hiver, le parc Josaphat a belle allure après la taille, le ramassage des feuilles, le nettoyage autour des étangs. Par un jour sans vent, ceux-ci offrent de jolis jeux de miroirs.
Et qu’apercevons-nous sur ces nouveaux abris flottants destinés aux canards, avec deux maisonnettes ? Des oiseaux que nous n’avions jamais vus ici : on dirait bien un couple de cormorans. Un coup d’œil à la belle galerie du photographe Philippe Massart permet d’apprécier la variété des oiseaux à observer au parc et dans les parages.
En revenant sur nos pas, nous n’avons plus trouvé les cormorans au même endroit, mais sur un autre étang. A peine ressortis de l’eau où ils allaient chercher leur pitance, ils replongeaient si vite qu’il était fort difficile de prendre une bonne photo. La lumière, magicienne et malicieuse, nous jouait des tours.