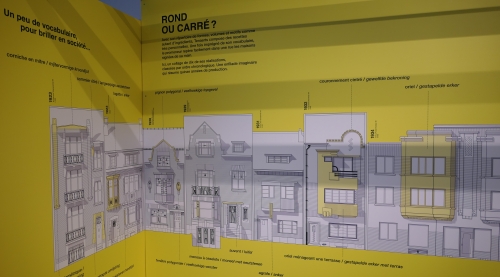L’été s’est déclaré à Bruxelles bien avant le solstice, cette année, et ce mois de juin largement ensoleillé a fait oublier le triste mai, gris et trop frais. Les floraisons abondent dans les jardinets de ville, je m’en émerveille à chaque promenade. Les roses trémières déploient leur palette de couleurs, les rosiers ne sont pas en reste.
J’aime quand, échappée naturellement d’un jardin ou d’un parterre ou semée par quelque fantaisiste, une plante surgit à l’imprévu, comme cette mauve au pied d’un réverbère.
Quand une fleur jamais vue attire l’attention, telles ces boules de belle allure – ail d’ornement ? – au-dessus de pivoines encore en boutons. Reflets dans une fenêtre parée de géraniums de balcon...
Quand une alliance de tons inattendue retient le regard
ou le bord effrangé d’une passerose
ou son cœur de fleur plus foncé…
Les travaux de réaménagement du rond-point entre l’avenue Demolder et le square Riga s’achèvent et tout le monde est content de voir disparaître les barrières du chantier, en particulier les clients qui ont retrouvé la terrasse du café Riga depuis sa réouverture. J’attends avec impatience le retour de l’olivier du rond-point où un supporter des Diables Rouges a planté un drapeau belge à sa place (un petit drapeau suisse a suivi ; avec l’Euro foot, les drapeaux nationaux flottent en nombre dans le quartier). Et les nouvelles plantations dans les parterres aménagés dans les trottoirs élargis (pas visibles sur la photo).

21, 22, 23 juin 2021, ciel de pluie. Les autres photos datent de jours précédents.
De l’autre côté du square, l’avenue Georges Eekhoud, où les travaux d’égouttage ne sont pas encore tout à fait terminés, ne manque pas de charme ; j’y reviendrai peut-être ici un jour, quand il sera plus aisé de prendre des photos.
Georges Eekhoud (1854-1927), un écrivain belge dont je n’ai lu que des extraits, avait fondé une revue littéraire, Le Coq Rouge (1895-1897), où Eugène Demolder, Maurice Maeterlinck et Emile Verhaeren figuraient dans le comité de rédaction. Les avenues à leur nom les rapprochent encore aujourd’hui dans ce quartier schaerbeekois. Si cette revue vous intéresse, je vous recommande la lecture du texte fondateur, « Le Coq rouge » (en pdf, source de l’illustration).
De mes balades sur la Toile, je vous rapporte enfin deux liens vers Mu in the City : le premier à propos de l’autre exposition d’Elise Peroi déjà évoquée ici, le second sur l’exposition actuelle de Chiharu Shiota à la galerie Templon qui la représente en France et en Belgique depuis des années. A sa manière très personnelle, la Japonaise s’y exprime sur des mois de confinement. Le site de la galerie propose une vidéo sous-titrée où elle explique son travail pour « Living inside ».
Bel été à toutes & à tous !