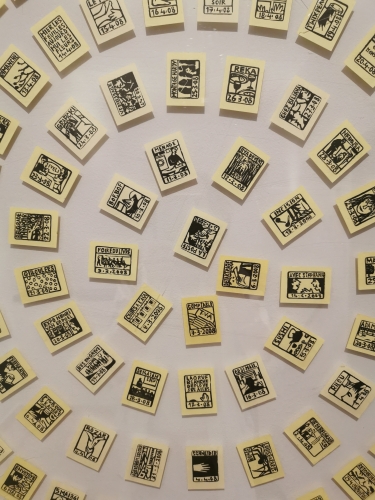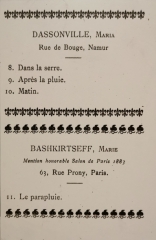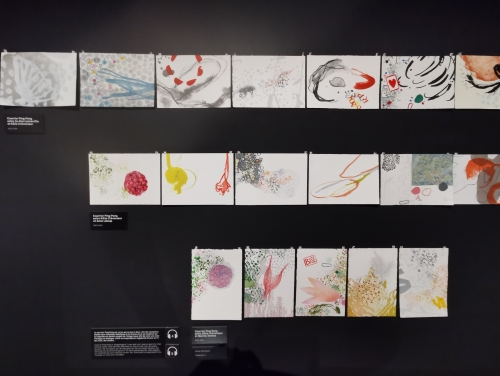Une belle expo au musée Rops, c’était bien sûr aussi l’occasion d’une promenade dans Namur. J’ai trouvé la ville particulièrement pimpante sous le soleil de juillet (une date bien choisie, le lendemain il pleuvait). Au-dessus de la Meuse, les flâneurs apprécient l’Enjambée, cette passerelle ouverte en 2020 qui relie Jambes et Namur.

Namur : l'Enjambée sur la Meuse
Cet été, on peut découvrir à Namur « Le jardin extraordinaire de Kalbut ». L’artiste wallon conçoit ses œuvres à partir de matériaux de récupération et représente des animaux de la région. Juché sur une branche d’arbre près de l’église Saint-Loup (église baroque qui a fasciné entre autres Victor Hugo et Baudelaire), Martin le pêcheur nous a séduits par son allure et ses couleurs. (Les maquettes des neuf sculptures sont exposées à l’Office du tourisme.)

Namur : Martin le pêcheur © Kalbut
En plus du grand patrimoine architectural namurois, c’est un plaisir, en se promenant dans la vieille ville, d’observer des détails aux façades des maisons comme ce bas-relief « A la maison blanche » au-dessus de la porte d’un établissement désaffecté.

Namur : Agrandir pour voir "A la maison blanche" au-dessus de la porte
Dans la rue Haute Marcelle, une fresque de Kahef rend hommage au folklore local : « Vive Nameur po tot » (Vive Namur pour tous) peut-on lire près du gamin ouvrant un livre d’où sortent deux échasseurs (« du wallon namurois « chacheu » qui désigne le jouteur sur échasses » dixit Wikipedia). Les échasseurs namurois, qui ont plus de six siècles d’existence, sont aussi représentés par une statue en bronze (au rond-point des Échasseurs).

Namur : street art signé Kahef
De nombreuses potales (« du wallon potè, qui signifie petit trou ») ont survécu aux façades, ces niches qui abritent une statue de la Vierge ou d’un saint. Celle de « La vieille maison », sur une façade datée de 1775, est mise en valeur entre deux lanternes au-dessus de la porte de ce café-bar et de la jolie croix ouvragée de l’imposte.
Il y a des boutiques attrayantes dans les ruelles, comme la sympathique enseigne d’« Il fera beau demain » où nous sommes entrés, juste pour ressentir cette ambiance de caverne d’Ali Baba qui contribue « à entretenir un petit coin de rêve, de charme, de poésie au sein du vieux Namur » (site). J’y ai photographié cette vaisselle Copenhague que nous utilisions chez ma grand-mère, un classique qui garde la cote, apparemment.

Namur : vaisselle Copenhague (Il fera beau demain)
Voici le merveilleux Gérard le renard de Kalbut, sur une place dont je vous parlerai prochainement. Son socle accueillait quelques amatrices de crèmes glacées, d’autres passants cédaient à l’envie de se faire tirer le portrait en sa compagnie. Ses couleurs sont bien choisies et ses griffes semblent redoutables.

Namur : Gérard le renard © Kalbut
Autre personnage du folklore namurois, le Molon, un coq à la main gauche et une boîte de quête à la main droite. Avec un « 40 » au-dessus du « M » de son chapeau, la statue se dresse devant la maison natale de Nicolas Bosret, auteur de l’hymne namurois « Li Bia Bouquet », le premier directeur « des 40 molons ». La royale société Moncrabeau, « probablement la plus ancienne société folklorique de Wallonie », à vocation philanthropique et musicale, organise un concours de menteries au monument dédié à Nicolas Bosret, un buste à l’arrière duquel se trouve le siège où doit s’asseoir le candidat menteur (détails ici).

Namur : Le Molon © Vinciane Renard
Parmi les animaux figurés par Kalbut, les oiseaux ont ma préférence. Voici Léon le héron, un poisson dans le bec, sur l’esplanade de la Confluence où arrive l’Enjambée et où les enfants peuvent se rafraîchir aux jets d’eau aléatoires. Un peu plus loin, un autre volatile, Victor le pic-vert : il a l’air malicieux, non ?


Namur : Léon le héron & Victor le pic-vert © Kalbut
Namur : Vue de la Confluence vers la Citadelle (la Tortue brille sur l'herbe, à droite)
Nous montons là les escaliers pour admirer d’en haut le confluent de la Sambre et de la Meuse. On se retourne vers l’esplanade pour admirer, au-dessus des briques rouges du Parlement wallon, la citadelle de Namur où brille désormais la Tortue dorée de Jan Fabre, Searching for Utopia, posée là lors d’une exposition en 2015 et conservée depuis lors. Nous irons la voir de plus près à l’occasion d’une autre balade namuroise en bonne compagnie.