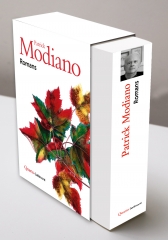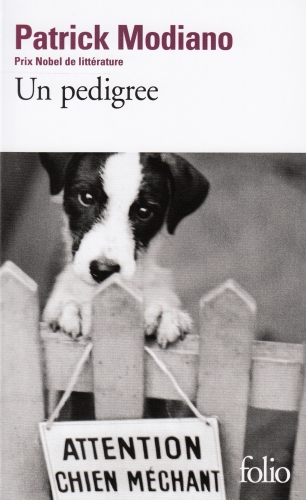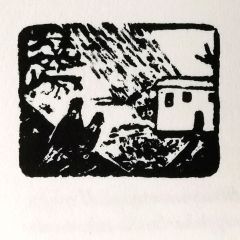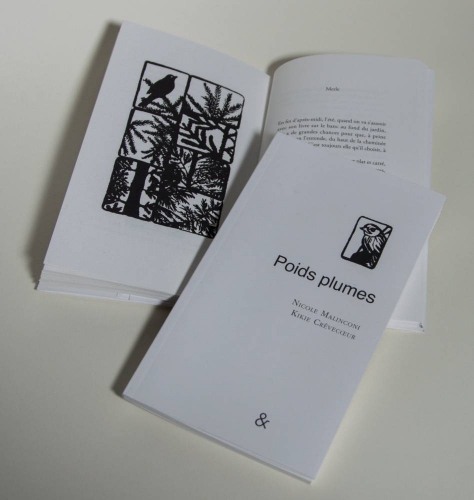Emma Doude van Troostwijk (°1999), une Néerlandaise qui a grandi en France, a vu son premier roman publié en janvier 2024 aux Editions de Minuit : Ceux qui appartiennent au jour. Augustin Trapenard l’a invitée à La Grande Librairie, le roman a reçu plusieurs prix. Dans un français singulier qui lui donne un ton à part, elle raconte l’histoire d’une jeune femme qui rentre à la maison (un presbytère) après un an d’absence et y retrouve sa famille. Des observations, la vie quotidienne, les liens entre eux, c’est par petites touches que la romancière nous fait entrer dans ce quasi-huis clos.

Presbytère de Chartrené, XVIIIe, photo JC Allin (Wikipedia)
Sa première impression en arrivant est celle d’un certain délabrement des lieux. Dans son fauteuil à bascule, Opa, son grand-père ne la reconnaît pas : « Il tend la main et dit, enchanté de vous rencontrer madame, je vous attendais. » Son frère Nicolaas essaie de mettre de l’ordre dans le jardin qui ressemble à un terrain vague. Leur père pasteur, en burn-out, ne bouge pas de son lit ; elle passe des heures à le regarder « s’assoupir et se réveiller ».
« Quand il rentre de son stage, Nicolaas s’allonge près de nous. Il dépose un baiser sonore sur le front de Papa et dit, plus qu’un mois et je suis pasteur, t’imagines ? Mon père se redresse un peu, tapote l’épaule de mon frère et dit, et moi je suis devenu homme au foyer. Ils rient. » Le père lui-même souffre de trous de mémoire qu’il tâche de compenser à l’aide de post-it au mur.
Par séquences d’une ou deux pages, ou quelques phrases, nous découvrons ce que regarde la narratrice : le visage creusé d’Opa, les « cafés servis par Oma dans des tasses aux motifs anciens. Du bleu de Delft. » Régulièrement, elle mentionne les différences entre le français et le néerlandais. « Il ne faudrait pas dire nature morte. Il faudrait dire vie silencieuse. Stilleven. » Quand son grand-père la réveille à trois heures du matin : « Ça va aller Opa, alles gaat goed, alles gaat goed » (Tout va bien).
« En français ils perdent la tête. En néerlandais ils perdent le chemin. Ze zijn de weg kwijt. » Les troubles de la mémoire occasionnent des moments suspendus, parfois des fous-rires. En pleine nuit, son grand-père se croit en retard pour l’heure du culte qui a sonné au temple protestant. Son fils est devenu pasteur comme lui et bientôt ce sera le tour de Nicolaas, son petit-fils. Entre le frère et la sœur, on sent une grande complicité.
A l’approche de son ordination, Nicolaas s’interroge. « Tu crois en Dieu, Papa ? » Son père ne répond pas tout de suite « et finit par dire, je crois à la puissance des histoires. » Opa entraîne sa petite-fille au jardin pour lui confier un secret – « Ne le dis à personne » – puis sort de sa poche un papier froissé : un mail qu’il ne lui a jamais envoyé, où il disait sa joie à la lecture d’un texte qu’elle avait écrit et lui confiait que son prénom, Zacharie, veut dire « Dieu s’est souvenu », ce qui le fait sourire.
Mama, sa mère, est à la cuisine ou à l’ordinateur ou en réunion avec le conseil presbytéral. Quand son fils se demande s’il va y arriver, elle dit « tu sais, écrire une prédication c’est un peu comme parler d’amour. » Au petit déjeuner, prière, lecture de la Bible. Opa met du thé au lieu de lait dans ses corn flakes. Plus tard, il sifflote en posant une pièce d’un puzzle « à un endroit improbable ».
Les souvenirs d’enfance affluent dans le récit. On regarde des scènes du passé sur des cassettes VHS, dans des albums. Sur le mur de la chambre, il y a les traits de son frère plus petit qu’elle, à onze ans encore – « Maintenant je suis obligée de me hisser sur la pointe des pieds pour poser mes joues contre les siennes. » Son frère célèbre un enterrement, un baptême. A une semaine de son ordination, on lui demande en visioconférence pourquoi il veut devenir pasteur. Un silence, puis « Nicolaas reprend, mais j’ai des doutes ces derniers temps sur le sens de. [sic]» A sa sœur, il dira « avoir envie de faire un métier qui n’existe plus », vouloir « faire un truc qui compte, un truc qui compte vraiment. »
Emma Doude van Troostwijk (littéralement : du quartier de la consolation) met une douceur infinie dans les rapports entre ses personnages, les suit avec délicatesse jusque dans les égarements de la raison, de la mémoire, des corps. « L’un des romans les plus originaux de la rentrée littéraire », « par la forme et le fond » écrit Guy Duplat dans La Libre : « Tous les personnages sont sur le fil de la vie, fragiles à en tomber. »
Sophie Creuz parle joliment d’un « petit livre d’heures », « un livre écrit à l’encre de la tendresse » (RTBF). « En français, ils ne tiennent qu’à un fil. En néerlandais ils appartiennent au jour. Het zijn mensen van de dag. » Voilà qui explique le titre magnifique : il donne la tonalité de ce premier roman lumineux où on chante, on sourit, on danse, on pleure, on prie, on doute, on s’épaule. Qu’ajouter ? En phrases simples, on s’aime.