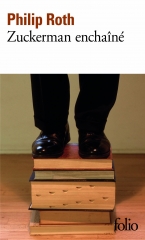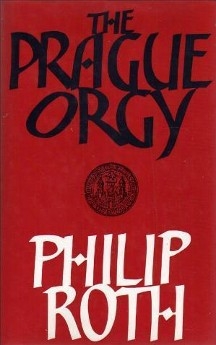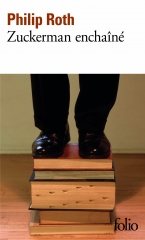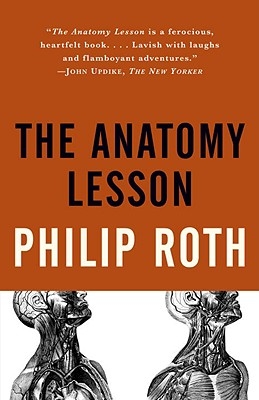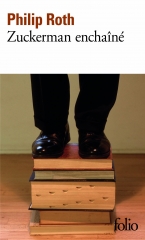L’orgie de Prague (1985), l’épilogue du Zuckerman enchaîné de Philip Roth dont je vous entretiens depuis quelque temps, compte moins de cent pages. Publié deux ans après La leçon d’anatomie, il se présente comme « extrait des carnets de Zuckerman ». Voici le début, daté du 11 janvier 1976 à New York :
« Votre roman, dit-il, est absolument l’un des cinq ou six livres de ma vie.
- Vous pouvez donner l’assurance à M. Sisovsky, dis-je à sa compagne, qu’il m’a suffisamment flatté.
- Tu l’as suffisamment flatté, lui dit-elle. »
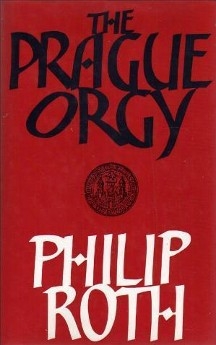
Elle, « la quarantaine, des yeux pâles, de larges pommettes, une chevelure sombre, séparée par une raie sévère – un visage frappant, égaré », toute en noir, se tient au bord du sofa de Zuckerman. Lui, « plus jeune, peut-être de dix ans », une allure d’« exilé ruiné », se dit intéressé par le scandale provoqué par le roman de Zuckerman en Amérique, parce que les Tchèques ont réagi de même à propos du sien – sans vouloir les comparer : « Le vôtre est une œuvre de génie, et le mien n’est rien. »
Il faudra qu’Eva Kalinova intervienne pour que Zdenek explique pourquoi il a fui la Tchécoslovaquie : « Là du moins je puis être tchèque – mais je ne puis être écrivain. Tandis qu’à l’Ouest, je puis être un écrivain, mais pas un Tchèque. » Zdenek préfère parler d’elle, « la grande actrice tchékhovienne de Prague (…). Après elle, il n’est pas de Nina, pas d’Irina, pas de Macha. » Ils se disputent. Il la dit « poursuivie par des démons juifs », elle qui n’est pas juive du tout, mais a eu le tort de jouer des rôles de juive, aux yeux de l’occupant soviétique et de ses serviteurs. (On est loin, en 1976, du Printemps de Prague. L’année suivante verra la publication de la Charte 77.)
L’orgie de Prague ferait une bonne pièce de théâtre, les dialogues y occupent la plus grande place. Zuckerman finit par comprendre ce que Zdenek attend de lui. Il voudrait récupérer les récits en yiddish de son père, restés à Prague chez son épouse Olga. Il voudrait publier en Amérique ces nouvelles d’un « écrivain merveilleux et profond » et flatte le point faible de Zuckerman : « Elle vous plairait. Elle a été très belle autrefois, avec de jolies jambes très longues et des yeux de chat gris ».
Deuxième temps : Nathan Z. est à Prague, le 4 février 1976, il se rend à une réception chez Klenek, un cinéaste ménagé par le régime. Sa maison, connue pour ses orgies – « Moins de liberté, plus de baise » –, est truffée de micros de la police secrète. Bolotka lui explique « qui est qui et qui aime quoi », jusqu’à ce qu’une grande femme mince aux yeux gris, « des yeux de chat » et un sourire engageant, chuchote à Zuckerman : « Je sais qui vous êtes ».
Olga prétend que son amant veut la tuer ; les hommes la cherchent tous. Son mari s’est enfui en Amérique avec une belle actrice tchèque et elle vit avec Klenek. Olga demande à Zuckerman s’il compte faire l’amour à quelqu’un à Prague et ne cesse de le provoquer, interrompue par un sexagénaire qui veut absolument qu’elle se montre à un garçon qui l’accompagne, qui n’a jamais vu de femme. Quand elle en revient, Nathan résiste à ses avances et lui propose de déjeuner ensemble le lendemain. Ses lecteurs n’en reviendraient pas.
Le lendemain, Olga le réveille, elle l’attend dans le hall de l’hôtel et se présente comme sa « future épouse ». Mais un employé de la réception, après s’être excusé auprès de lui en anglais, s’adresse à elle en tchèque : il veut sa carte d’identité ; elle exige qu’il lui parle en anglais aussi pour que Zuckerman comprenne la manière insultante dont on traite les citoyens tchèques. Quand elle apprendra la raison de sa présence, Olga sera furieuse : « Pour qu’il puisse gagner de l’argent sur le dos de son père mort – à New York ? Pour qu’il puisse lui acheter des bijoux à elle, maintenant à New York aussi ? »
Zuckerman arrivera-t-il à la persuader de lui donner ce qu’il est venu chercher ? Lisez L’orgie de Prague si vous voulez connaître la suite, pleine d’imprévus. Philip Roth y restitue le climat oppressant que subissent les Tchèques dans les années 70, en particulier les intellectuels relégués aux emplois manuels et voués à la débrouille pendant que d’autres collaborent et tirent profit de leur proximité avec le pouvoir. Roth a séjourné à Prague dans ces années-là et a soutenu des dissidents tchèques, il sait comment il y était surveillé.
Après L’écrivain fantôme, Zuckerman délivré, La leçon d’anatomie, l’épilogue de Zuckerman enchaîné change de contexte, mais les thèmes du premier cycle consacré par Philip Roth à Nathan Zuckerman restent bien présents : la relation père-fils et l’origine juive, l’écriture et la littérature, les femmes et la sexualité, la solitude et les rencontres, la liberté intellectuelle et l’audace.