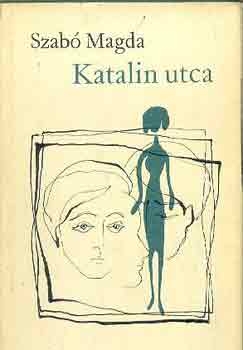J’ai rarement terminé de lire un roman avec le cœur si serré : La porte de Magda Szabó (Az Ajtó, 1987, traduit du hongrois par Chantal Philippe) a remporté le prix Femina en 2003, le New York Times l’a élu meilleur livre de l’année en 2015. Il aura fallu des années à cette grande dame des lettres hongroises pour être lue à l’étranger, elle en a connu la reconnaissance à la fin du XXe siècle, avant de décéder il y a dix ans.

Le récit s’ouvre sur un rêve, un cauchemar, un aveu : « c’est moi qui ai tué Emerence. Je voulais la sauver, non la détruire, mais cela n’y change rien. »
La narratrice a engagé Emerence, une « vieille femme silencieuse » sous son foulard qu’elle ne quitte jamais, après avoir déménagé avec son mari dans un appartement bien plus grand que son studio où elle faisait le ménage elle-même. « Redevenue un écrivain à part entière », elle a besoin d’aide. Emerence, jamais mariée, sans enfants, aimée dans tout le quartier et aussi concierge, tout près de chez eux, lui a été recommandée par une ancienne camarade de classe : « elle espérait qu’elle nous accepterait, car si nous ne lui plaisions pas, ce n’est pas l’argent qui l’inciterait à travailler pour nous. »
Guère aimable au premier entretien, la vieille femme a des exigences et des manières inattendues, des horaires irréguliers, mais elle compense par une « incroyable activité », travaille « comme un robot » et parfaitement. Le jour où, sans prévenir, son employeuse frappe à sa porte pour l’avertir d’un paquet à réceptionner en son absence, Emerence hurle qu’elle ne veut pas être dérangée après son travail et « qu’elle n’était pas payée pour ça ».
N’aurait-elle pas toute sa tête ? Au fil des jours, la personnalité d’Emerence qui ne reçoit jamais personne chez elle effraie, inquiète l’écrivaine. Adélka, « la veuve du préparateur en pharmacie », lui raconte comment un locataire colombophile s’en était pris au premier chat d’Emerence, excellent chasseur, et l’avait pendu à sa poignée de porte, suscitant la réprobation de toute la maison, du quartier, et valant même à Emerence l’amitié de la police, en particulier du lieutenant-colonel qui va la voir de temps en temps, alors encore sous-lieutenant.

L'affiche du film de István Szabo,
avec Helen Mirren et Martina Gedeck dans les rôles d'Emerence et de Magda
Taciturne, intransigeante, la vieille femme est en réalité l’âme du quartier, où tout le monde l’admire : toujours au travail, au courant de toutes les nouvelles, portant un « plat de marraine » à qui a besoin de nourriture reconstituante, balayant la neige devant la plupart des immeubles, jamais couchée, littéralement – « elle se contentait de sommeiller sur un de ces minuscules canapés autrefois en vogue et appelés causeuses, (…) elle n’avait pas besoin de lit. »
Restée distante pendant des années, Emerence manifeste sa préoccupation à leur égard quand « le maître » tombe malade et doit être opéré : aux petits soins pour l’écrivaine, pour la première fois, elle lui tient compagnie, se raconte. L’enfance paysanne, la mort des deux jumeaux laissés à sa garde, quand elle avait neuf ans, foudroyés sous un arbre, sa mère se jetant dans le puits, et puis la vie de domestique. Elle économise pour construire un tombeau, « très grand, plus beau que tout ce qu’on n’a jamais vu », où tous les siens reposeront avec elle.
Sans que la vieille femme change de comportement, quelque chose s’est produit ; elle ne la considère plus comme une étrangère déconcertante, mais comme une amie. Pourtant ses absences, sa fierté, ses réactions inattendues les éloignent à nouveau. Jusqu’à l’arrivée d’un chien. Son mari guéri, l’écrivaine et lui tombent, une veille de Noël, sur un chiot enfoui dans la neige et le ramènent chez eux pour le sauver d’une mort certaine. Emerence s’en empare aussitôt pour le frictionner, le bercer, le maintenir en vie.
« Mon mari le tolérait, le caressait parfois quand il se montrait particulièrement intelligent ou amusant, moi, je l’aimais. Emerence l’adorait. » Ils lui ont donné « un joli nom français », Emerence l’appelle Viola et leur connivence est totale : le chien comprend tout ce qu’elle dit, la réclame, la suit, même si elle le bat quand il fait une bêtise.
Magda Szabó, une romancière préoccupée des « liens de dépendance entre les êtres » (Le Monde), raconte le destin d’une vieille femme aussi visible dans les mille services qu’elle rend à autrui que secrète dans sa vie privée. Entre l’écrivaine et elle, l’affection qui grandit n’a rien d’ordinaire et s’exprime de manière imprévue, souvent brutale même. Chacune est indispensable à l’autre, même si souvent elles ne se comprennent pas. Emerence, l’héroïne déroutante de ce magnifique roman, est très intelligente ; anti-intellectuelle, elle méprise ceux qui ne savent pas balayer eux-mêmes. La narratrice fait peu à peu son portrait et en même temps le sien, celui d’une femme passionnée avant tout par l’écriture et se débattant avec les contraintes matérielles de la vie.
Si sa carrière littéraire lui vaut de plus en plus de reconnaissance publique, elle sait envers qui elle en est, jour après jour, redevable. Et quand Emerence, à son tour, aura besoin d’elle, elle ne se sentira pas à la hauteur, maladroite, ne comprenant que trop tard ce qu’elle aurait dû faire – ou pas – pour ne pas se sentir éternellement coupable.
 « – Il faut faire quelque chose qu’elle connaît, dit le garçon. Elle est encore petite et pas très futée.
« – Il faut faire quelque chose qu’elle connaît, dit le garçon. Elle est encore petite et pas très futée.