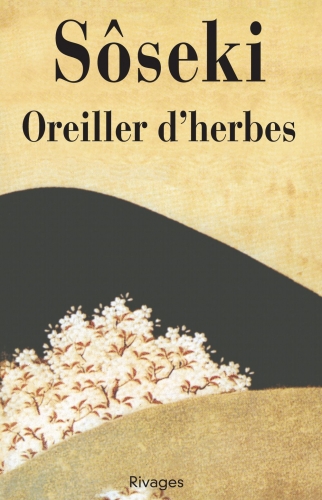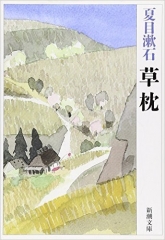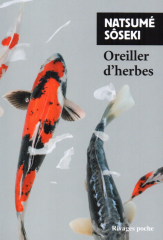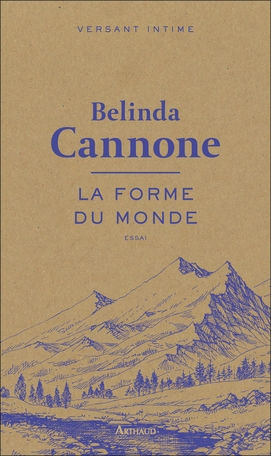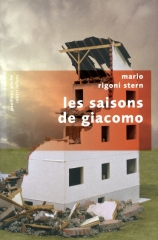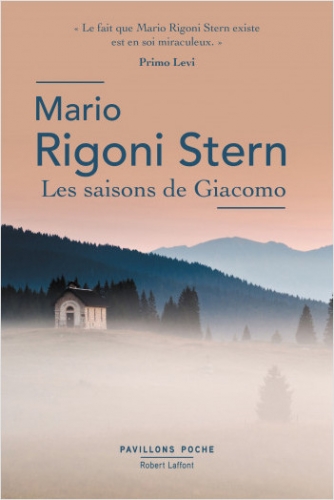A propos d’Oreiller d’herbes (Kusamakura, 1906, traduit du japonais par René de Ceccaty et Ryôji Nakamura), Natsumé Sôseki a écrit : « Si ce roman-haïku (l’expression est certes bizarre) s’avère possible, il ouvrira de nouveaux horizons dans la littérature. Il ne me semble pas que ce type de roman ait déjà existé en Occident. En tout cas, il n’y en a jamais eu de tels au Japon. »
Le titre est la traduction littérale d’un nom qui signifie le fait de ne pas dormir chez soi. Oreiller d’herbes est le récit d’un peintre et poète qui se rend à la montagne à la recherche d’un endroit paisible pour créer : « Dès que vous avez compris qu’il est partout difficile de vivre, alors naît la poésie et advient la peinture. » Il dit l’importance de l’art : « Tout artiste est précieux car il apaise le monde humain et enrichit le cœur des hommes. »
A plus de trente ans, tandis qu’il gravit un sentier de montagne, il est conscient de la proximité inévitable entre la lumière et l’ombre, la joie et la mélancolie, le plaisir et la souffrance. Il porte une boîte de peinture en bandoulière. Le chemin est difficile, il trébuche sur une pierre en longeant le lit d’une rivière. Puis viennent des lacets sur lesquels il avance en écoutant le chant des alouettes, en découvrant un champ de colza « doré ».
« Le printemps nous endort. Les chats oublient d’attraper les souris et les hommes oublient leurs dettes. On oublie alors le lieu de son âme et notre raison s’égare. Ce n’est qu’à la vue des fleurs de colza qu’on s’éveille. Quand on entend le chant de l’alouette, on reconnaît l’existence de son âme. » Le voilà de plain-pied dans le monde poétique de Wang Wei et de Tao Yuanming (deux grands poètes chinois), où « se promener et errer, ne fût-ce qu’un instant, dans l’univers impassible. C’est une ivresse. »
Le soir, les montagnes franchies, il arrivera à la station thermale de Nakoi. L’impassibilité, voilà le but de son voyage, loin des passions terrestres. Aussi, tous ceux qu’il rencontrera, il projette de les considérer comme des « figurants dans le paysage de la nature », de les observer à distance, comme des personnages dans un tableau.
Une averse l’oblige à se réfugier dans une maison de thé signalée par un postillon. Une vieille femme lui apporte du thé, son visage lui rappelle celui d’une vieille vue sur une scène de théâtre nô ; au fond du bol, « trois fleurs de pruniers sommairement dessinées d’un seul coup de pinceau ». Un bon feu lui permet de se sécher. Quand le ciel se dégage, elle lui montre le rocher du Tengu qu’il contemple (il y a souvent de quoi repenser au livre de Le Clézio sur la poésie des Tang).
Le peintre d’Oreiller d’herbes se réfère souvent à des écrivains anglais et à un tableau en particulier, la fameuse Ophélie peinte par Millais. Un bref arrêt de Gembei, le postillon, conduit la conversation sur « la demoiselle de Nakoi », la fille de Shioda, l’aubergiste, qu’on dit malheureuse comme « la Belle de Nagara » autrefois – une fille de riche famille dont deux garçons étaient amoureux en même temps et qui a fini par se noyer dans la rivière.
A l’auberge de Nakoi, le bruissement des bambous l’empêche de dormir. Il a tout loisir de détailler le décor de sa chambre et de rêver de la Belle de Nagara, quand il entend une voix qui fredonne puis s’arrête : en regardant dehors, il lui semble voir une silhouette au clair de lune, adossée à un pommier pourpre en fleurs, puis disparaître – la fille des Shioda ?
Dans son carnet d’esquisses, il cherche à « résumer en dix-sept syllabes » ses impressions nocturnes, avant de sombrer dans le sommeil. Quand celui-ci se transforme en « demi-sommeil », il entend la porte coulisser, voit une femme entrer : « Comme un ange qui marche sur les flots, elle avance sur les nattes sans le moindre bruit. » Un bras ouvre et referme le placard, la porte se referme. Quand il la rencontrera le matin, sa beauté et l’expression de son visage le laisseront perplexe, et plus encore son ironie quand elle l’invite à aller voir : « On a fait le ménage dans votre chambre. » Sous ses propres vers, quelqu’un en a écrit d’autres !
Oreiller d’herbes va et vient entre la contemplation des choses, de la nature, des paysages, des nuances de la lumière et des couleurs, et l’observation des personnages rencontrés à Nakoi ou alentour, le désir de peindre et d’écrire. « Si je dois à tout prix m’en expliquer, je dirai que mon cœur bouge simplement avec le printemps. » Dans ce « paradis sur terre » où le printemps lui donne envie de rester immobile comme une plante, tout éveille sa curiosité : la nourriture, une poterie chinoise, « la jeune madame » dont le barbier du village lui conseille de se méfier – « elle a un grain ».
Peindra-t-il un jour Nami, la fille de Shioda, dont les apparitions ponctuent le cours de ses réflexions ? Le peintre de Sôseki, en « artiste véritable », veut voir tout ce qu’il voit « comme un tableau ». Sôseki le poète y parvient aussi.