Le roman de Paolo Cognetti Les huit montagnes (2016, traduit de l’italien par Anita Rochedy) est tout à fait à la hauteur des éloges lus dans la presse et dans la blogosphère : la passion du père pour la montagne, d’abord pesante pour son fils (le narrateur), imprègne toute leur vie de famille. Les parents avaient quitté la campagne pour vivre à Milan. « Leurs premières montagnes, leur premier amour, ça avait été les Dolomites. » Ils s’étaient mariés au pied des Tre Cime di Lavaredo – un mariage rejeté par les parents de la mère, célébré entre amis, en anorak, un matin d’octobre 1962.

Photomontage : https://www.gliscrittoridellaportaaccanto.com/
A Milan, ils habitent au septième étage, sur un grand boulevard, dans le vacarme. La mère infirmière travaille comme assistante sanitaire, elle accompagne les femmes enceintes jusqu’au premier anniversaire du bébé. Le père, chimiste, n’en peut plus des grèves et des licenciements dans l’usine, dort mal. Vers la fin des années 1970, ils reprennent leurs chaussures de marche : cap à l’est, « direction l’Ossola, la Valsesia, le val d’Aoste, montagnes plus hautes et sévères »
Découvrant le mont Rose, son père tombe amoureux de la région. Il lui faut les trois mille, les glaciers ; sa mère préfère les deux mille ou mille, la vie des « villages de bois et de pierres ». C’est elle qui trouve une maison, en 1984, dans le village de Grana. Pour le père, ce qui compte alors, c’est de monter au sommet ; pour la mère, d’agrémenter la vieille maison et aussi de pousser son fils Pietro à se lier davantage avec les autres.
Le torrent tout proche devient le terrain de jeu de l’enfant ; il finit par faire connaissance avec un garçon qui garde des vaches dans les prés, Bruno Guglielmina, qui a quelques mois de plus que lui, sans savoir encore qu’il se fait un ami pour la vie. C’est pour le retrouver à l’alpage que le garçon va suivre son père en haute montagne et apprendre ses règles : prendre un rythme et s’y tenir sans s’arrêter ; ne pas parler ; aux croisements, choisir la route qui monte.
Heureusement sa mère lui a appris le nom des arbres et des plantes – « pour mon père, la forêt n’était rien d’autre qu’un passage obligé avant la haute montagne ». Il n’a pas son endurance, mais parvient tout de même à le suivre jusqu’à la cime où son père s’arrête enfin pour lui passer en revue « les quatre mille d’est en ouest, toujours du premier au dernier, parce qu’avant d’y aller, il était important de les reconnaître, et de les avoir longtemps désirés. »
A la mort de son père, à soixante-deux ans, Pietro en a trente et un : « Je n’étais pas marié, je n’étais pas entré à l’usine, je n’avais pas fait d’enfant, et ma vie me semblait à moitié celle d’un homme, à moitié celle d’un garçon. » Il vit seul dans un studio à Turin. Fasciné par les documentaires, il s’est inscrit à une école de cinéma. Son père lui a légué une propriété à Grana, dont il ne sait rien, mais où Bruno va le conduire, lui qui a beaucoup accompagné son père dans ses courses en montagne.
« Une paroi de roche lisse, haute, inhabituellement blanche, tombait sur ce plateau tourné vers le lac. De la neige dépassaient les restes de trois murs à sec, taillés dans la même roche blanche (…). Deux murs brefs et un long devant, quatre par sept, comme disait mon plan cadastral. » Un petit pin cembro. « Le voilà, mon héritage : une paroi de roche, de la neige, un tas de pierres de taille, un arbre. »
Bruno était avec le père de Pietro quand il a vu et puis voulu ce terrain, « la barma drola » (la roche étrange), pour y construire une maison. Il en a dessiné les plans et fait promettre à Bruno de la construire. Pietro n’ayant pas d’argent, son ami lui propose de payer uniquement le matériel et de lui donner un coup de main. Ce sera « la maison de la réconciliation ».
« Bruno et moi vivions peut-être le rêve de mon père. Nous nous étions retrouvés dans une pause de nos existences : celle qui met fin à un âge et en précède un autre, même si ça, nous ne le comprendrions que plus tard. » Cette maison devient le centre du monde pour Pietro, il y amène des amis, un jour une fille, Lara, qui tombe elle aussi amoureuse des alpages.
Puis il repart. Sa passion pour l’Himalaya est la plus forte et quand Bruno, attaché pour la vie à « sa » montagne, l’interroge au retour de son premier voyage au Népal, il répond que « débarquer là-bas, c’est comme voir enfin un temple en entier après avoir contemplé des ruines toute sa vie. »
Une lecture à ne pas manquer pour tous ceux qui aiment la montagne. Ceux qui ont fréquenté les chemins du Piémont ou du val d’Aoste retrouveront dans Les huit montagnes (prix Strega, prix Médicis étranger, 2017) des impressions inoubliables, en plus d’une belle approche des liens familiaux et de l’amitié.
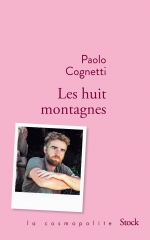 « Tout en disant ces mots, il traça à l’extérieur de la roue une petite pointe au-dessus de chaque rayon, puis une vaguelette d’une pointe à une autre. Huit montagnes et huit mers. A la fin, il entoura le centre de la roue d’une couronne qui devait, pensai-je, être le sommet enneigé du Sumeru. Il jaugea son travail un instant et secoua la tête, comme s’il avait déjà fait mille fois ce dessin mais avait un peu perdu la main dernièrement. Il planta quand même son bâton au centre, et conclut : « Et nous disons : lequel des deux aura le plus appris ? Celui qui aura fait le tour des huit montagnes, ou celui qui sera arrivé au sommet du mont Sumeru ? »
« Tout en disant ces mots, il traça à l’extérieur de la roue une petite pointe au-dessus de chaque rayon, puis une vaguelette d’une pointe à une autre. Huit montagnes et huit mers. A la fin, il entoura le centre de la roue d’une couronne qui devait, pensai-je, être le sommet enneigé du Sumeru. Il jaugea son travail un instant et secoua la tête, comme s’il avait déjà fait mille fois ce dessin mais avait un peu perdu la main dernièrement. Il planta quand même son bâton au centre, et conclut : « Et nous disons : lequel des deux aura le plus appris ? Celui qui aura fait le tour des huit montagnes, ou celui qui sera arrivé au sommet du mont Sumeru ? » 




























