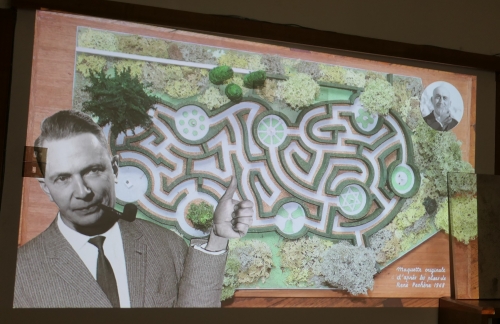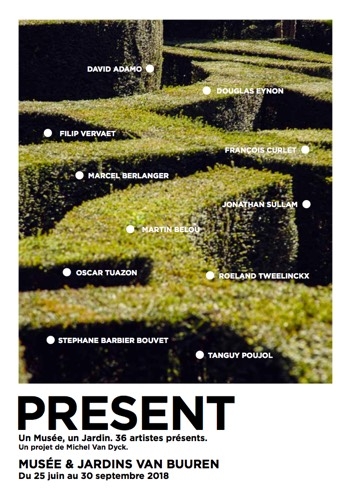Le dernier des Camondo, de Pierre Assouline, accueille ses lecteurs en trois temps : une dédicace touchante – « A Maman, pour la remercier de m’avoir aidé dans mes premières rédactions » –, une épigraphe signée Marcel Proust – « Un peu d’éternel, ou tout au moins de durable, était entré dans la composition de cet éphémère… » et un arbre généalogique. D’Abraham Salomon Camondo (1781-1873) à Nissim de Camondo (1892-1917), le biographe raconte une saga familiale et bien davantage, l’histoire d’une famille entre Orient et Occident, entre fidélité aux racines et position sociale, entre prospérité financière et collection d’art.

Le salon bleu
http://madparis.fr/en/museums/musee-nissim-de-camondo/views
Son point de départ est aussi son point d’arrivée : le musée Nissim de Camondo au 63, rue de Monceau, dans le VIIIe arrondissement de Paris. (Ne l’ayant jamais visité, je me réjouis d’y prolonger cette lecture un jour.) Assouline y est entré pour la première fois en 1981, quand il enquêtait sur Marcel Dassault : « Depuis, cette maison m’habite. » Le premier chapitre décrit la rue de « toutes les grandes familles » – dix hôtels particuliers sur 95 numéros. En 1910, Moïse de Camondo y a fait raser l’Hôtel Violet et commandé à son architecte « non un musée mais une maison » pour ses collections du XVIIIe siècle, des meubles surtout, du « bon goût » sans ostentation. La description est impressionnante, enrichie d’un vocabulaire d’antiquaire : « chaises voyeuses », « marbre sérancolin », « gourgouran »…
« On les appelait les Rothschild de l’Orient ». Dès l’évocation des ancêtres commerçants en Espagne, il est question de la situation des Juifs en Europe, d’abord tolérés puis rejetés, même les marranes – qui se convertit au catholicisme reste soupçonné d’être « juif dedans, chrétien dehors ». Certains se rendent au Portugal, en Italie, en Afrique du nord. Les Camondo, après Venise, choisissent « l’empire de la Sublime Porte » et y développent leurs talents de négociants.
« Ils savent d’expérience qu’ils ne font que passer, que c’est leur destin, même si, chaque fois qu’ils s’installent, c’est pour toujours. » Abraham Salomon Camondo, né à Istanbul, devient « au milieu du XIXe siècle le plus riche des 200 000 juifs que comptait alors l’empire ottoman ». A 52 ans, il est l’héritier « et le seul maître de la banque Isaac Camondo et Cie » et règne sur un empire immobilier à Galata. Philanthrope généreux, il a son clan, les « Francos », qui « demeurent des Européens dans l’âme ».
Abraham Camondo prend en charge une école juive et encourage la maîtrise des langues (le turc, le français, en plus de l’hébreu et du judéo-espagnol) pour « rendre les juifs compétitifs sur l’échiquier économique ». Au service de l’esprit des « Lumières », il se heurte aux mentalités archaïques : des rabbins conservateurs l’accusent de vouloir convertir les jeunes juifs au christianisme, on le juge « trop réformateur, trop moderne ». Après la mort de sa femme puis de son fils unique, à qui il offre des funérailles grandioses, Camondo retourne en Italie où Victor-Emmanuel II devient roi. En 1867, celui-ci l’anoblit, il portera le titre de « comte de Camondo », accordé trois ans plus tard également à son petit-fils Nissim de Camondo. Celui-ci, avec son frère Abraham, décide de transférer la banque familiale à Paris.
Dans ce récit biographique très documenté, Pierre Assouline prend soin de situer chaque épisode de la saga familiale dans son contexte historique, économique et social. Il explique comment, dans la France de 1870, se répartissent les askhénases et les séfarades, les juifs « du pape » et ceux du Marais. Rotschild, premier des banquiers, rivalise avec Pereire. A la tête du Crédit mobilier, celui-ci vend aux Camondo le terrain de la rue de Monceau. Quand Abraham, le patriarche, meurt en 1873, il aura des doubles funérailles, à Paris puis à Constantinople, avec tous les honneurs.
La France juive d’Edouard Drumont, en 1886, qui considère le « cosmopolitisme » juif contraire aux intérêts français (l’auteur fondera ensuite la Ligue nationale antisémite), reflète le changement de mentalité à la fin du XIXe siècle. Affaires et scandales vont se répercuter sur la réputation des Camondo, considérés comme des « Orientaux », « à la manière des Grecs qui considéraient comme barbares tous ceux qui n’étaient pas grecs ». Mais ils se tiennent à leur devise, « Fides et charitas », on ne fait pas appel en vain à leur générosité. En 1889, les deux petits-fils, Nissim et Abraham, meurent tous deux de maladie. Il ne reste alors que deux cousins Camondo : « Deux, c’est peu. Surtout quand l’un n’avait pas l’intention de fonder une famille, et que l’autre ne se voyait pas mourir banquier. »
Isaac, 39 ans, et Moïse, 30 ans, sont célibataires. Isaac est collectionneur d’art et accumule acquisitions et appartements pour les y installer. « Comme une réponse de seigneur à l’antisémitisme ». Il souffre d’être considéré comme un amateur fortuné, compose de la musique. Moïse finit par reprendre le flambeau familial en épousant Irène Cahen d’Anvers en 1891, « une juive du meilleur monde », une femme ravissante. Renoir a peint son portrait à huit ans (La petite fille au ruban bleu), un tableau dont Assouline racontera l’histoire plus loin.

Renoir, Portrait d'Irène Cahen d'Anvers
L’adresse est d’importance dans le grand monde, où trois quartiers de Paris sont considérés comme « habitables » : le Faubourg Saint-Germain pour l’aristocratie française, le Faubourg Saint-Honoré où vivent les Rothschild et la plaine Monceau. Irène organise de belles réceptions dans son château de Champs-sur-Marne magnifiquement restauré. Moïse, comte de Camondo, tient son rang en devenant consul général de Serbie à Paris, en chassant à cheval, en fréquentant l’Opéra, les stations balnéaires, les clubs.
Mais Irène, infidèle, finit par demander le divorce pour épouser le comte Sampieri, malgré le scandale. Moïse reporte alors toute son ambition sur ses enfants, Nissim et Béatrice, neuf et sept ans. Il se console en collectionnant puis en faisant construire son nouvel hôtel dans la rue de Monceau. Il gère aussi les donations de son cousin au Louvre après son décès : 130 peintures, pastels, aquarelles et dessins, 400 estampes japonaises.
En 1914, le « petit Trianon » du comte de Camondo est achevé rue de Monceau. La guerre éclate. Son fils Nissim, 22 ans, engagé volontaire pour la France, meurt le 3 septembre 1917. Parmi les nombreux messages de sympathie, une lettre de Proust. Pierre Assouline suit pas à pas les dernières années de Moïse de Camondo, qui n’a pas fini de soutenir les arts ni d’entreprendre. Le dernier des Camondo a pris soin, dix ans avant sa mort en 1935, de léguer à l’Etat français cette « reconstitution d’une demeure artistique du XVIIIe siècle » pour le musée des Arts décoratifs, à condition de la conserver dans son intégralité.