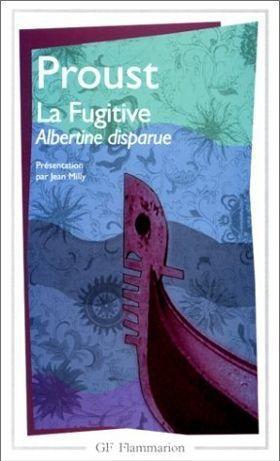Chercher Ludmila Oulitskaïa sur ce blog, ne pas l’y trouver, sentir le temps qui passe : aucun roman, juste une citation ! Ni Les pauvres parents, ni Sonietchka, qui l’a révélée en France, ni Sincèrement vôtre, Chourik, qui m’avait tant fait rire. Le chapiteau vert (Zeliony Chatior, 2010, traduit du russe par Sophie Benech, 2014) nous embarque pour près de cinq cents pages dans l’histoire de trois amis d’école : Ilya, Sania et Micha. Le roman s’ouvre sur la mort de Staline (1953) et se ferme sur celle du poète Brodsky (1996).

« Un attachement aussi solide entre des êtres ne peut naître que dans l’adolescence. Le crochet s’enfonce alors en plein cœur, et le fil qui unit des gens liés par une amitié d’enfance dure toute la vie, sans jamais se rompre. » Cela se vérifie pour le trio qui se tient à l’écart des meneurs à l’école primaire, deux brutes. Micha, « le rouquin classique », est un orphelin juif recueilli par sa tante Guénia après la mort de son père à la guerre, il porte des lunettes – une cible idéale. Sania a plus de chance, il a toujours de l’argent pour acheter une glace, sa mère (radiologue) et sa grand-mère (prof de russe) encouragent son rêve de devenir pianiste malgré ses petites mains. Ilya, lui, veut gagner de l’argent pour s’acheter un appareil photo.
Anna Alexandrovna, la grand-mère de Sania Steklov, les emmène dans les musées pendant les vacances d’hiver – « un choc pour Micha, qui était constitué par nature pour moitié de curiosité, de passion et de soif de connaissances scientifiques et autres, et pour moitié d’une ferveur créatrice indéterminée ». Ilya aussi est impressionné, plus que Sania, « familier des lieux ». Micha tombe amoureux de la vieille dame pour la vie et elle le lui rend bien, pressentant en lui un poète.
Le jour de la rentrée, Sania s’interpose lors d’une bagarre pour protéger Micha et se fait méchamment couper à la main – un drame mais aussi un soulagement : il n’a plus à prouver ses capacités pianistiques, il peut passer des journées entières à écouter de la musique, pur plaisir. Sa grand-mère donne des leçons d’allemand à Micha, et un manuel d’anglais. Grâce à l’appareil-photo d’avant-guerre que lui offre son père, Ilya commence sa collection « d’instants de vie ».
L’arrivée d’un nouveau professeur de littérature, Victor Iouliévitch Schengueli, surnommé « La Main » à cause de la moitié de son bras droit perdue à la guerre, va changer leur vie. Courtois et caustique, il récite des vers au début de chaque cours. Micha est fasciné, « presque le seul à avaler la poésie comme une cuillerée de confiture ». Bientôt ils forment le club des Amateurs de Lettres Russes, les Lurs, et suivent leur prof en promenade dans Moscou où il leur parle de Pouchkine, leur montre les endroits où ont vécu les écrivains ou leurs personnages. Apprendre à penser et à sentir aux gamins de treize ans est sa seule passion ; la guerre est à ses yeux « la chose la plus infâme ».
Le jour de l’enterrement de Staline, Ilya se glisse partout pour photographier les rues bloquées par la foule, « un fleuve noir » où il risque de se faire étouffer – il y aura au moins 1500 personnes écrasées. Recueilli chez les Steklov, où Anna Alexandrovna le lave et le soigne, il donne à Sania l’occasion troublante de voir son corps nu et vigoureux.
Passionnés par leurs vagabondages littéraires avec Victor, les garçons prennent conscience de ce qui compte le plus pour eux : pour Sania, la musique ; pour Micha, la littérature, « la seule chose qui aide l’homme à survivre » ; pour Ilya, la documentation photographique de son temps. Leur professeur voudrait écrire sur l’enfance et l’adolescence, temps de métamorphose – montrer comment se fait le passage vers une vraie vie adulte, « dotée de sens moral ».
Quand la mixité amène des filles à l’école, l’une d’elles, Katia, tombe amoureuse de lui. « Quand vous aurez fini vos études » lui répond-il, sans savoir qu’il va l’épouser, après qu’elle lui a prêté le manuscrit du Docteur Jivago qu’elle tient de sa grand-mère, amie de Pasternak – « magnifique post-scriptum à la littérature russe ». Ils se marient, Katia est enceinte, et leur vie paisible avec la petite Xénia contraste avec l’évolution aberrante de leur pays. Le rapport de Kroutchtev dénonçant le culte de Staline circule en samizdat, la dissidence s’organise. La rumeur annonce le licenciement de Victor pour conduite immorale, il démissionne avant.
Micha voulait s’inscrire en Lettres, mais les Juifs n’y étant pas admis, il opte pour l’Institut pédagogique. Ilya s’inscrit à l’Institut des techniques du cinéma à Leningrad, Sania en Langues étrangères. Au Festival de Moscou, ils font la connaissance de Pierre Zand, un Belge d’origine russe en reportage pour un journal de la jeunesse, il considère le communisme comme du fascisme. Ainsi commence leur « relation criminelle avec un ressortissant étranger », en plein triomphe de « l’amitié entre les peuples ».
Au chapitre « Le chapiteau vert » entre en scène Olga qui « plaisait autant aux hommes et aux femmes qu’aux chiens et aux chats ». Fille d’un général et d’une écrivaine, étudiante en Lettres, elle se marie trop tôt avec un étudiant dont elle a un fils, Kostia. Mais elle se fait renvoyer pour avoir défendu un professeur accusé d’antisoviétisme. Son mari repart chez sa mère, ils divorcent. Son père retraité accepte qu’elle s’installe près de lui à la datcha avec son fils et qu’elle y reçoive Ilya Brianski, son nouvel ami qui a quitté son épouse et leur enfant handicapé mental. Il a laissé ses études pour la dissidence et gagne sa vie avec le samizdat. Olga tape des textes de Mandelstam, Brodsky… Ilya les fait relier et circuler. Traduction, petits boulots, officiellement « secrétaires », ils se débrouillent pour vivre, comme la plupart.
Alors qu’ils reparaîtront dans les chapitres suivants, les destinées d’Ilya et d’Olga sont déjà racontées ici jusqu’à leur fin (il émigrera, elle tombera malade). A son amie Tamara, Olga raconte son rêve merveilleux : dans la queue pour entrer sous le chapiteau, elle reconnaît dans la queue plein de visages familiers, des vivants et des morts ensemble, et Ilya qui lui fait signe. Le roman jusqu’alors chronologique passe à une forme plus éclatée avec des retours en arrière, des digressions : on apprend que le général avait une maîtresse cachée, aux funérailles de la mère d’Olga, choses dont elle ne lui avait jamais parlé.
Voici Sania étudiant en musicologie, Micha en professeur pour enfants sourds-muets, Olga entre Tamara, sa meilleure amie, et Galia, ancienne camarades de classe dont le mariage avec un agent du KGB chargé de surveiller Ilya va leur être fatal. Interrogé, harcelé, arrêté, Ilya va-t-il finir par jouer un double jeu pour s’en sortir ? D’autres personnages attachants apparaissent, comme cette famille de Tatars chassée de Crimée et soutenue par Sakharov.
Biologiste devenue romancière (privée de sa chaire de génétique pour avoir prêté sa machine à écrire à des auteurs de samizdat), Oulitskaïa, née en 1943, défend ici l’honneur des dissidents de l’ère soviétique. Dans la Russie de Poutine, ceux-ci, dit-elle, sont présentés comme des démons : « Les dirigeants actuels font tout leur possible pour rétablir les fondements idéologiques du pouvoir soviétique et discréditer la dissidence. » (Le Monde)
Le chapiteau vert, fresque de la vie en URSS dans la seconde moitié du XXe siècle, montre courage et lâcheté, idéaux et difficultés quotidiennes, à travers des amitiés indestructibles. Un hommage à la liberté de pensée.