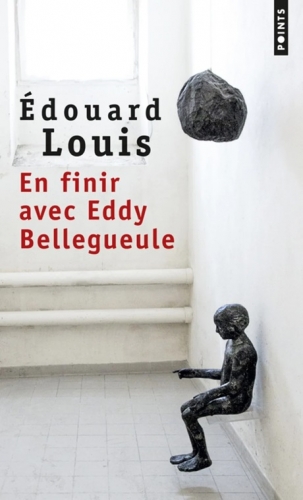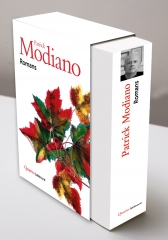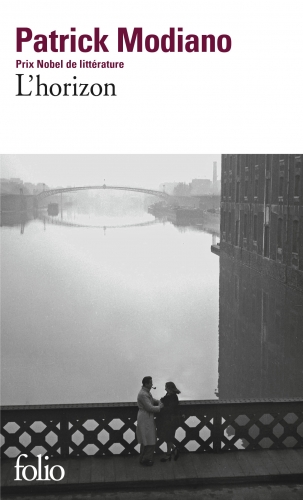En finir avec Eddy Bellegueule (2014), ses prénom et nom d’origine, c’est pour le narrateur raconter son ancienne vie et signer ce premier roman Edouard Louis. Le récit, très rude, s’ouvre sur une scène qui se répétera : à l’école, deux garçons, « le premier, grand, aux cheveux roux, et l’autre, petit, au dos voûté » lui crachent au visage – « Prends ça dans ta gueule » – avant de le rouer de coups : « C’est toi le pédé ? » Nouveau au collège, il avait dix ans.
« La violence ne m’était pourtant pas étrangère, loin de là. J’avais depuis toujours, aussi loin que remontent mes souvenirs, vu mon père ivre se battre à la sortie du café contre d’autres hommes ivres, leur casser le nez ou les dents. » Son père avait vu son propre père devenir violent dans l’ivresse, insulter et battre sa femme, avant de les abandonner, elle et son fils de cinq ans. Pour lui, il y eut peu d’école, beaucoup de bagarres – « J’étais un dur quand j’avais quinze ou seize ans » –, puis il était devenu ouvrier dans l’usine du village « comme son père, son grand-père et son arrière-grand-père avant lui. »
A la naissance d’Eddy, sa mère avait déjà un fils et une fille d’un premier mariage avec un alcoolique ; pour le père, c’était le premier fils à qui transmettre ses « valeurs viriles » : « il allait faire de moi un dur ». Très vite, il déchante. Une voix aux intonations féminines, plus aiguë que celle des autres garçons, des réactions différentes, alors ses parents l’insultent : « Pourquoi Eddy il se comporte comme une gonzesse. » Au village, on le trouve bien élevé, même s’il est spécial, bizarre, efféminé. Pour lui, l’enfance dans la campagne picarde était sinon agréable.
Mais au collège, les « durs » ne lui passent rien. Eddy préfère entrer dans le couloir sans surveillance où les deux garçons l’attendent chaque jour dans l’espoir qu’ainsi « personne ne nous verrait, personne ne saurait ». Pour donner « une image de garçon heureux », il est en quelque sorte « complice » de cette violence et il espère s’habituer à la douleur.
« Pour un homme la violence était quelque chose de naturel, d’évident. » Son père, pour ne pas répéter le schéma de ses parents, déchaînait sa colère contre les murs, couverts de trous à la longue. Son grand frère avait l’alcool méchant, sa sœur recevait des coups de son compagnon. Pour protéger Eddy du fils aîné, le père avait dû s’interposer, s’était retrouvé au sol, paralysé ; il avait fallu appeler le médecin. Violence, pauvreté, survie.
Sa mère fumait beaucoup, s’emportait souvent, allumait la télévision dès le matin, toussait. Elle lui racontait sa vie, celle de son père. « Sa vie l’ennuyait et elle parlait pour combler le vide de cette existence qui n’était qu’une succession de moments d’ennui et de travaux éprouvants. » Quand le père s’était retrouvé au chômage, elle avait commencé à faire la toilette des personnes âgées. A Eddy, elle disait être simple, aimer rire, ne pas vouloir jouer à la madame, mais il sentait sa honte.
« C’est pas une baraque c’est une ruine », disait-elle de la maison : humidité, moisissures, cloisons minces. Ni lumière ni bureau dans les chambres, le travail scolaire entre le père qui regarde la télévision et la mère qui vide un poisson sur la table. Pour Eddy, le seul répit était « la salle de classe », avec des enseignants respectueux. Sa mère se soucie de bien l’élever, mais l’heure des repas, c’est « l’heure de bouffer » : à la maison on parle une langue populaire, brutale, raciste ; on se moque des gens qui « dînent », « ceux qui ont les moyens, les riches ». (Les paroles sont indiquées dans le texte en italiques, sans guillemets.)
Eddy fait du théâtre au collège le vendredi soir, ça ne plaît pas à son père qui le laisse marcher quinze kilomètres à travers champs pour rentrer. Après s’être tenu à l’écart « de tout ce qui se rapprochait plus ou moins de l’homosexualité », Eddy et un petit groupe d’amis sont invités par leur « chef de bande », plus âgé qu’eux, à venir chez lui en l’absence de ses parents voir un film « de cul ». Il les encourage à se masturber. Puis, dans un hangar, à jouer les scènes du film, entre garçons – jusqu’à ce que la mère d’Eddy les découvre.
« Je pensais que la honte que nous partagions, moi, mes parents et mes copains, était trop puissante, qu’elle empêcherait qui que ce soit d’en parler et qu’elle me protégeait. Je me trompais. » Alors vient l’idée de fuir, faute de réussir à « être comme tout le monde ». Eddy se rapproche de filles, veut donner le change, en vain. Du secours viendra de la proviseure du collège qui, vu ses succès lors des représentations théâtrales, lui renseigne un lycée d’Amiens et sa filière d’art dramatique au baccalauréat. Il y découvrira une autre façon de se comporter.
Edouard Louis interrogé sur En finir avec Eddy Bellegueule : « Toute cette violence en moi, je ne pouvais plus la garder. Il fallait que ça sorte (…). C’était écrire ou mourir. Ce qui ne veut pas dire que je n’avais pas peur. J’avais peur. De ne pas être à la hauteur. De blesser. J’ai fait en sorte qu’il y ait le moins d’autocensure possible, mais il y a des limites à la littérature et des limites à ce que j’étais en mesure d’écrire. Certaines choses, je ne pouvais tout simplement pas les écrire. C’était trop vulgaire. J’avais peur de ne pas être pris au sérieux.» (Entretien avec Nathalie Petroswski, La Presse, 28/5/2014)
Photo de couverture : Kiki Smith, Girl With Globe (Points, 2015)