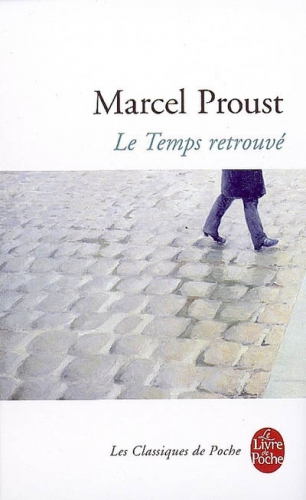Le temps retrouvé ramène le narrateur à Combray. Il a rejoint Gilberte à Tansonville, et ses impressions ne sont plus celles de l’enfance : les faits, les choses prennent un sens nouveau, il avait mal interprété alors le regard de Gilberte derrière la haie qu’il croyait méprisant, alors qu’elle avait envie de le connaître. Saint-Loup ne rend que de brèves visites à son épouse, élancé, rapide, « d’une vivacité fébrile » – une « allure de coup de vent ».
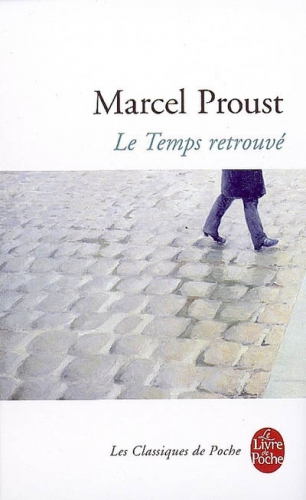
Robert de Saint-Loup refuse de parler des invertis avec son ami, se prétend « un soldat qui n’y connaît rien » ; en fait, il cache son amour pour Morel derrière des maîtresses. En parlant de lui et d’Albertine avec Gilberte, le narrateur se convainc davantage encore qu’ « aimer est un mauvais sort comme ceux qu’il y a dans les contes, contre quoi on ne peut rien jusqu’à ce que l’enchantement ait cessé. »
En lisant là le Journal des Goncourt (Proust en cite des extraits, un pastiche !), il prend conscience de sa manière à lui d’observer les gens, très différente : « Goncourt savait écouter, comme il savait voir ; je ne le savais pas. » Quoique la vérité en art ne soit pas celle d’un document, il regrette de n’être pas assez doué pour la littérature. Il y renonce.
A sa sortie d’une maison de santé, en 1916, le narrateur découvre les toilettes à la mode de guerre, la manière nouvelle dont on parle de certaines choses comme l’affaire Dreyfus, les changements mondains. Mme Verdurin, qui a déménagé, invite à présent les « ennuyeux » qui la sollicitent. Le couvre-feu donne l’impression, le soir, de se promener dans le noir à la campagne.
Gilberte lui écrit : elle a été obligée d’héberger des Allemands, Méséglise a été détruit. Saint-Loup montre sa « vraie noblesse » dans la guerre. En permission, il se montre aussi discoureur que Charlus, « aussi affable et charmant de caractère que l’autre était soupçonneux et jaloux ». Rencontré sur les boulevards, celui-ci est de plus en plus isolé et sa brouille avec Mme Verdurin perdure, elle l’accuse même d’être un espion, à cause de sa germanophilie. On meurt à la guerre et ailleurs (le Dr Cottard, M. Verdurin). Le baron de Charlus se moque des discours militaristes, des lieux communs sur la guerre, des expressions de M. de Norpois et se montre odieux d’autosatisfaction. Mais il a laissé s’installer dans son hôtel un hôpital militaire.
L’église de Combray est détruite. A Paris, les raids de gothas, les aéroplanes, les projecteurs font lever les yeux la nuit vers le ciel. Pour étancher sa soif, un soir, le narrateur entre dans le seul hôtel ouvert sur son chemin, d’où il croit voir sortir Saint-Loup, et se retrouve dans une maison de passe. Jupien procure là au baron, qui se fait enchaîner, des plaisirs sado-masochistes – un véritable pandémonium où le narrateur observe les jeux aberrants et la « folie » de Charlus.
Peu après avoir cherché en vain sa croix de guerre (égarée chez Jupien), Saint-Loup meurt au front, en cherchant à protéger ses hommes. Le narrateur écrit à Gilberte, sa veuve, mais pas à la duchesse de Guermantes qu’il croyait indifférente à son neveu, alors qu’elle en tombe malade de chagrin. Malgré tout, se rappelant sa mauvaise volonté envers Robert, il pense « au peu de chose que c’est qu’une grande amitié dans le monde. »
Les péripéties de la guerre font place, lorsque le narrateur est invité à une matinée chez le prince de Guermantes, aux plus belles pages de Proust sur la vocation littéraire. Alors qu’il n’y croyait plus, une sensation « d’une extrême douceur » ressentie en traversant les rues en voiture pour s’y rendre ressuscite un « passé glissant, triste et doux », suivie d’un véritable choc en découvrant Charlus devenu tout blanc comme le roi Lear et s’exprimant avec difficulté.
En butant contre des pavés dans la cour des Guermantes, lui qui se pensait voué aux plaisirs frivoles retrouve ces « joies de l’esprit » déjà ressenties (arbres, clochers, madeleine, sonate) et se rappelle ces dalles inégales à Venise où il avait buté de même. Tous ces signes qui se multiplient, ponts entre présent et passé, entre lieux lointains et actuels, lui rendent « foi dans les lettres », confiance en son instinct : l’impression sera son « critérium de vérité ».
Retrouvant dans la bibliothèque du prince de Guermantes (où il attend la fin du concert pour entrer au salon) François le Champi que lui lisait sa mère à voix haute, il oppose le « pouvoir de résurrection » à l’art réaliste. L’écrivain est un traducteur du réel – « Une heure n’est pas qu’une heure, c’est un vase rempli de parfums, de sons, de projets et de climats. »
« La grandeur de l’art véritable… », cette page fameuse et sublime (reprise dans Lagarde & Michard) exprime la conception proustienne du travail de l’artiste : le narrateur sait maintenant que « l’œuvre d’art était le seul moyen de retrouver le Temps perdu » et que tout ce qu’il n’a su « ni écouter ni voir » est enregistré à une profondeur où il peut retrouver la matière de son livre. Tout ce qu’il a vécu, ses chagrins amoureux, ses échecs, prend une signification nouvelle.
Comme pour ces figures vieillies reconnues avec peine chez le prince de Guermantes, le temps a passé sur lui. En voyant quelqu’un chercher son nom sur son visage, il s’interroge sur « l’apparence d’arbousier ou de kangourou que l’âge (lui) avait sans doute donnée ». Bloch est devenu quelqu’un, Mme Verdurin est à présent princesse de Guermantes par son troisième mariage, le Faubourg Saint-Germain ressemble à une « douairière gâteuse ». Gilberte a grossi.
La vie finit par tout feutrer « de ce beau velours inimitable des années ». Résolu à vivre désormais dans la solitude pour ce « rendez-vous urgent, capital » avec lui-même, pour écrire son livre, le narrateur voit à présent comment la société s’est transformée, « comme toutes choses changent en ce monde. » A lui de retisser les « fils mystérieux » entre les êtres, les événements, de construire son livre « comme une église », s’il en a la force – « Il était grand temps. »
Relire La Recherche (12)
Relire La Recherche (11)
Relire La Recherche (10)
Relire La Recherche (9)
Relire La Recherche (8)
Relire La Recherche (7)
Relire La Recherche (6)
Relire La Recherche (5)
Relire La Recherche (4)
Relire La Recherche (3)
Relire La Recherche (2)
Relire La Recherche (1)
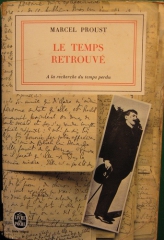 « La perception de ces vérités me causait de la joie ; pourtant il me semblait me rappeler que plus d’une d’entre elles, je l’avais découverte dans la souffrance, d’autres dans de bien médiocres plaisirs. Alors, moins éclatante sans doute que celle qui m’avait fait apercevoir que l’oeuvre d’art était le seul moyen de retrouver le Temps perdu, une nouvelle lumière se fit en moi. Et je compris que tous ces matériaux de l’oeuvre littéraire, c’était ma vie passée ; je compris qu’ils étaient venus à moi, dans les plaisirs frivoles, dans la paresse, dans la tendresse, dans la douleur emmagasinée par moi, sans que je devinasse plus leur destination, leur survivance même, que la graine mettant en réserve tous les aliments qui nourriront la plante. Comme la graine, je pourrais mourir quand la plante se serait développée, et je me trouvais avoir vécu pour elle sans le savoir, sans que jamais ma vie me parût devoir entrer jamais en contact avec ces livres que j’aurais voulu écrire et pour lesquels, quand je me mettais autrefois à ma table, je ne trouvais pas de sujet. Ainsi toute ma vie jusqu’à ce jour aurait pu et n’aurait pas pu être résumée sous ce titre : Une vocation. »
« La perception de ces vérités me causait de la joie ; pourtant il me semblait me rappeler que plus d’une d’entre elles, je l’avais découverte dans la souffrance, d’autres dans de bien médiocres plaisirs. Alors, moins éclatante sans doute que celle qui m’avait fait apercevoir que l’oeuvre d’art était le seul moyen de retrouver le Temps perdu, une nouvelle lumière se fit en moi. Et je compris que tous ces matériaux de l’oeuvre littéraire, c’était ma vie passée ; je compris qu’ils étaient venus à moi, dans les plaisirs frivoles, dans la paresse, dans la tendresse, dans la douleur emmagasinée par moi, sans que je devinasse plus leur destination, leur survivance même, que la graine mettant en réserve tous les aliments qui nourriront la plante. Comme la graine, je pourrais mourir quand la plante se serait développée, et je me trouvais avoir vécu pour elle sans le savoir, sans que jamais ma vie me parût devoir entrer jamais en contact avec ces livres que j’aurais voulu écrire et pour lesquels, quand je me mettais autrefois à ma table, je ne trouvais pas de sujet. Ainsi toute ma vie jusqu’à ce jour aurait pu et n’aurait pas pu être résumée sous ce titre : Une vocation. »