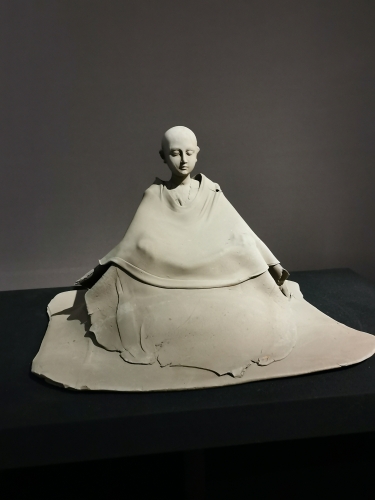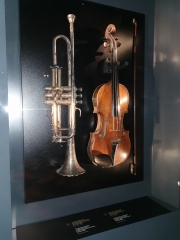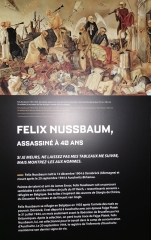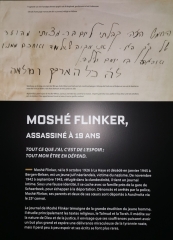A l’entrée de la Brafa 2026, les visiteurs étaient accueillis cette année dans un décor à la fois céleste – le ciel dans toutes ses nuances – et floral, les nuages et les atmosphères laissant place sur le tapis tantôt à un bouquet ancien (nature morte), tantôt à une large fleur imprimée aux carrefours des allées, comme ce dahlia.

Vue du décor à la Brafa 2026
La première toile que j’ai remarquée porte la signature d’un peintre français contemporain, Jean-Pierre Cassigneul (°1935) : une élégante au grand chapeau dans un jardin fleuri. Un tour sur le site de cet artiste permet de voir que son univers est décoratif et assez répétitif : des femmes plutôt indifférentes sous leur chapeau, au jardin, en bord de mer... Est-il bien connu en France ?

© Jean-Pierre Cassigneul, Se voir dans un regard, 1990,
huile sur toile, 130 x 97 cm, galerie Ary Jan
On aime retrouver d’année en année certains stands toujours harmonieux, comme celui de la galerie Mathivet où trônait une magnifique lampe oiseau de Lalanne. Un Chat maître d’hôtel de Diego Giacometti y invitait au salon sous une tapisserie d’Aubusson d’après Josef Albers, 2 ocres Jaune et Orange, de la série Hommage au carré. « Là tout n’est qu’ordre et beauté, / Luxe, calme et volupté ».

Vue partielle du stand de la galerie Mathivet
Chez Alexis Bordes, autre galerie parisienne, on se pressait devant une œuvre rarement montrée de Léon Spilliaert. En attendant de pouvoir m’en approcher, j’ai aperçu un petit bronze de Meunier dont je ne me souvenais pas, La Prière. Puis, en observant Mères et enfants sur le quai du port d’Ostende, je m’interroge : crayon gras ou pastel, comme suggère l’exposant ? Spilliaert mélange les techniques. On voit bien le trait qui marque les contours et le grain des couleurs comme frottées sur du papier vergé. A Ostende, il a souvent dessiné ou peint des scènes de port, des pêcheurs ou des femmes de pêcheurs comme ici, avec ce drôle de petit chien noir.

Léon Spilliaert, Mères et enfants sur le quai du port d’Ostende, 1910,
Crayon gras et crayon sur papier, 50,2 x 32,2 cm
Chez Patrick Derom, une superbe marine, Mer vue de Mariakerke, typique de Spilliaert, portait un point rouge : elle avait déjà trouvé son acheteur. Une nature morte sur papier m’a intéressée, elle est visible sur le site de l’exposant : une boîte blanche devant un miroir, une bouteille, des coquillages, des livres et un crayon. Le jeu des reflets déstabilise le regard entre l’avant et l’arrière. Sur chaque côté, un objet est coupé. Enigmatique et fascinant Spilliaert.

Léon Spilliaert, Vue de la mer depuis Mariakerke, 1909,
encre de Chine, lavis, pinceau, crayon de couleur et pastel sur papier, 47,7 x 71,1 cm
A la Brafa, on aime découvrir des choses jamais vues, des créateurs qu’on ne connaît pas encore et bien sûr, retrouver des artistes qu’on aime ou découverts lors d’une autre édition. Par exemple, un beau Bonnard peint vers 1911, Promenade à Paris (chez Alexis Pentcheff). Ailleurs un autre arbre à cocons de Charles Macaire ; une sculpture en marbre d’Atchugarry près d’une toile de Zao Wou-ki.

Pierre Bonnard, Promenade à Paris, vers 1911,
Huile sur toile, 40 x 60 cm, galerie Alexis Pentcheff
Au stand de BG Arts, qui rassemble des Lalique de toutes les couleurs, ce qui attire notre attention d’abord, c’est ce grand Vase aux éléphants d’Emile Gallé (Etablissements Gallé ?) qui se suivent à la queue leu leu autour d’un palmier. Ils se détachent en brun sur un fond jaune or, sous un feuillage vert. Très éclairé, superbe, on aimerait aussi voir ce vase impressionnant à la lumière du jour.

Emile Gallé, Vase "éléphants", vers 1925,
Verre multicouche soufflé-moulé dégagé à l'acide, BG Arts
Les artistes belges sont toujours mis en valeur à la Brafa et je constate que j’ai fait de même ici. J’admire Le Passeur d’Anto Carte qui date de la même époque, le cartel indique le musée M de Leuven pour la provenance. Une nature morte de Rik Wouters, Le saladier, me surprend puis m’émeut chez Virginie Devillez. La galeriste me fait observer la date : 1915. Mobilisé, Rik Wouters avait été envoyé aux Pays-Bas en 1914, où il a commencé à souffrir d’un cancer de la mâchoire. En 1915, il avait pu s’installer à Amsterdam où Nele est venue le rejoindre et il a continué à peindre, même après la perte d’un œil. Il y est mort en juillet 1916. Un saladier, un chou, quelques fruits sur une petite table…

Rik Wouters, Nature morte (Le Saladier), 1915,
Huile sur toile, 85 x 102 cm, Virginie Devillez Fine Art
Virginie Devillez (Bruxelles) était présente pour la première fois à la Brafa, avec une très belle sélection. Ne voyant pas le Nu couché en jaune et bleu de Gustave de Smet, repéré en préparant ma visite, j’ai eu le plaisir de pouvoir le découvrir dans une réserve du stand, à l’abri des fortes lumières. Lui aussi envoyé aux Pays-Bas pendant la Première Guerre mondiale, il s’est éloigné de l’influence d’Emile Claus en découvrant l’expressionnisme. Son évolution est bien présentée dans le dossier de presse de la galerie belge, en regard de ce dessin.

Henri Fantin-Latour, Vase de pivoines, 1902,
Huile sur toile, 41 x 37 cm, Douwes Fine Art
Pour terminer, je vous montre ces délicieuses pivoines de Fantin-Latour. Toujours attirée par les fleurs, j’ai admiré à divers endroits de superbes bouquets du XVIIe siècle. L’art ancien a retrouvé plus de place à la Brafa. Je vous en parlerai dans un autre billet, ainsi que de la Fondation Roi Baudouin, l’invitée d’honneur. Et peut-être aussi d’autres belles choses, plus tard.

Pour information, la foire des antiquaires de Bruxelles occupait cette année un hall supplémentaire, réservé aux bars et restaurants. Leur décor magnifique de végétaux et de fleurs en mettait plein la vue sous des ciels aux couleurs du couchant.