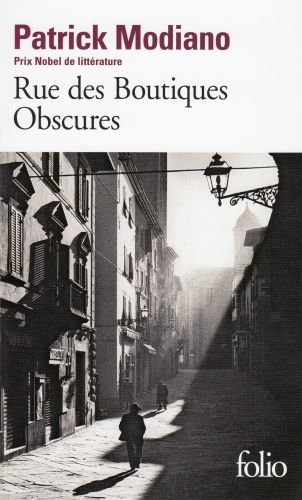Le titre choisi par Diana Filippova, De l’inconvénient d’être russe (2023), rappelle Cioran, mais ce sont Marina Tsvetaïeva (Le Mal du pays) et Georges Perec (Ellis Island) qu’elle cite en épigraphe. Née en 1986 à Moscou, arrivée en France en 1993, l’autrice porte un regard sans concession sur son pays natal.

L’attaque de la Russie en Ukraine l’a décidée à écrire, non pas son projet de « suite moscovite, comme Elena Ferrante et son quatuor napolitain, Knausgard et son hexalogue norvégien », un « grand roman russe » sur « l’âme insondable de ses habitants », mais son parcours d’assimilation, d’éradication même de sa « russéité » : « Devenir autre supposait de cesser tout à fait d’être russe. »
Sa mère est russe, son père est né en Russie de parents et de grands-parents grecs, à Iessentouki, « sorte d’Odessa du Caucase », « terre d’exil pour un certain nombre d’opposants et d’indésirables du régime communiste ». Grâce aux bons professeurs « trop mollement alignés » rétrogradés dans cette station thermale, « [son] père et ses camarades reçurent une excellente éducation européenne. » Sa passion pour la science l’amènera à s’exiler en France quand il ne pourra plus faire son métier dans des conditions décentes, peu après la chute de l’URSS.
Diana Filippova explique la particularité du passeport soviétique qui « classe, délimite, ordonne, interdit. » L’origine ethnique s’y ajoute à l’adresse de domiciliation : son père était « soviétique et grec », en décalage avec « le commun des Russes », mais moins que les Soviétique géorgiens ou juifs discriminés par « l’article cinq », appelés « les handicapés du groupe cinq ».
« D’aussi loin que remontent mes souvenirs, j’ai toujours su que je n’étais pas une Russe pure. » Les Grecs étaient perçus en Russie comme des « Caucasiens », non pas au sens de « Blancs européens », mais de peuple du Caucase (avec les Géorgiens, les Arméniens, les Ossètes, les Azerbaïdjanais...), voire comme des « tchernye – Noirs ». Derrière l’image internationaliste de l’URSS, le racisme en fonction de l’origine ethnique existait déjà, il se montrera plus violemment à partir des années 1990.
« Pâle et sombre, pur et mélangé : cette séparation m’était aussi familière que les visages de ma mère et de mon père. […] J’arborais pour ma part des cheveux foncés et des yeux noisette virant sur le jaune, ma peau était mate, comme celle de ma mère. » Son père, « l’homme idéal », s’occupait de ses couches, de la nourrir, de l’endormir. Ses parents étaient de jeunes scientifiques prometteurs, elle grandit entourée de livres.
De l’inconvénient d’être russe : « C’est l’histoire d’une femme française, métisse dans le pays où elle est née, formée avant toute chose par la littérature du monde entier, écrivant en français. C’est l’histoire d’une femme russe qui depuis sa plus tendre enfance a décidé de ne plus l’être. C’est l’histoire d’une lente désunion et du commencement de la réconciliation. »
Diana Filippova raconte comment elle a appris la guerre en Ukraine, la peur, l’aide aux Ukrainiens. Surprise que ses amis lui écrivent « Et toi, ça va ? », elle s’est sentie tout à coup rappelée à ses origines. Une journaliste ukrainienne s’était étonnée de l’entendre dire « autre chose que la propagande poutinienne ».
Dans « Les choses qui font que je suis qui je suis », elle parle beaucoup de ses lectures. De l’école de banlieue où elle se rendait à pied en traversant un parc : « Avant toutes choses, la France eut pour moi le goût du loisir, des parcs et de la marche. » De la honte pour les immigrés post-soviétiques « d’appartenir à une nation rétrogradée ». Peu à peu, elle cessera de penser à la Russie, de se penser comme russe – « et je cessai de l’être. »
De l’inconvénient d’être russe raconte le parcours d’une femme, son héritage familial, son regard sur la chute de l’URSS, l’ascension de Poutine, l’évolution politique. Diana Filippova dénonce, entre autres, le refus russe du travail de mémoire (l’ONG Memorial a été dissoute deux mois avant la guerre en Ukraine) et la complaisance de certains Russes parisiens envers le régime actuel.
Les grands écrivains russes, français et autres, occupent une place importante dans cet essai. L’enjeu de la langue aussi : d’intéressantes pages sur le « mat’ » russe, « langue carcérale », grossière, prisée des gens au pouvoir ; sur l’apprentissage du français et sa volonté d’écrire dans la langue de son pays, même si son français est « irrémédiablement infesté de [son] russe ».
« Aujourd’hui, Diana Filippova est une femme engagée, qui défend les droits humains à la mairie de Paris. On voudrait lui dire que, pour cette défense-là, être russe n’est pas un inconvénient mais un atout, une carte biface : cruauté à combattre d’un côté, humanisme à la coupole dorée à défendre de l’autre. » (Cécile Dutheil de la Rochère)
 « Les choses qui comptent sont autant ailleurs qu’ici. La connaissance de soi passe par la découverte de l’autre, de l’étranger, dans ce libre jeu entre l’ancrage et le mouvement qui fonde l’idéal cosmopolite. Si tant de personnes de la génération de mes parents demeurent encore nostalgiques des dernières années de l’empire soviétique, s’ils refusent de reconnaître ses vices, depuis la pénurie de papier-toilette jusqu’au racisme ordinaire, c’est qu’ils croyaient dur comme fer à cette utopie-là. Ces Soviétiques jeunes, instruits, optimistes, métissés à l’image de leurs bibliothèques, attendaient de la perestroïka qu’elle ouvre les vannes de la démocratie dans la même joie unanime qu’avait fait jaillir la glasnost, quand tout le monde se mit à lire les livres que la veille encore on planquait sous le manteau.
« Les choses qui comptent sont autant ailleurs qu’ici. La connaissance de soi passe par la découverte de l’autre, de l’étranger, dans ce libre jeu entre l’ancrage et le mouvement qui fonde l’idéal cosmopolite. Si tant de personnes de la génération de mes parents demeurent encore nostalgiques des dernières années de l’empire soviétique, s’ils refusent de reconnaître ses vices, depuis la pénurie de papier-toilette jusqu’au racisme ordinaire, c’est qu’ils croyaient dur comme fer à cette utopie-là. Ces Soviétiques jeunes, instruits, optimistes, métissés à l’image de leurs bibliothèques, attendaient de la perestroïka qu’elle ouvre les vannes de la démocratie dans la même joie unanime qu’avait fait jaillir la glasnost, quand tout le monde se mit à lire les livres que la veille encore on planquait sous le manteau.