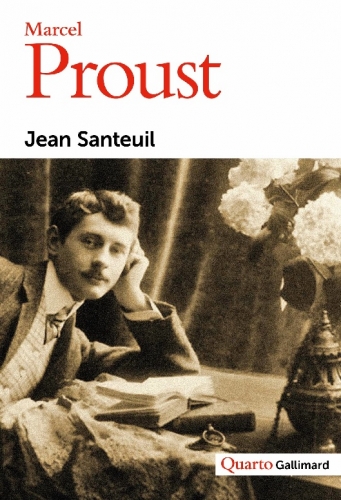Jean Santeuil compte plus de huit cents pages. Après « Les Réveillon », voici « Beg-Meil » : Jean a séjourné dans la petite station bretonne en septembre et octobre 1895. Des amis de sa mère y allaient souvent et vantaient cet endroit : « Là où nous menons une vie saine et heureuse, nous aimons à croire que réside [sic] en effet le secret de la force et le privilège de la beauté. »
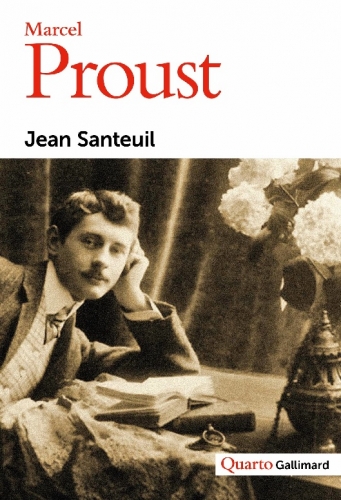
Couverture actuelle
Puis le voilà à Trouville (où Proust s’est souvent rendu durant son enfance et son adolescence), à l’hôtel des Roches-Noires – une note indique que l’auteur aurait hésité entre les deux endroits pour situer cette scène. Alors que sa chambre à Paris l’accueille gaiement et qu’il y entend les pas de sa mère venant lui faire « une petite visite », celle de l’hôtel lui semble étouffante, étrangère, une prison. Aussi en sort-il immédiatement pour aller lui téléphoner et c’est « comme la première fois » qu’il entend sa voix « si douce, si fragile, si délicate, si fondue – un petit morceau de glace brisée », toute de tendresse.
A la plage en compagnie d’Henri, souvenirs de lecture (Stevenson, George Eliot, Emerson), clairs de lune, voyage sous le vent et la pluie pour se rendre à Penmarch voir « une grande tempête », rencontres… Les fragments de ce chapitre se rapportent à divers moments et endroits. Proust passe sur une page de la troisième personne à « nous » et puis « je » pour des réflexions générales, prêtant à la nature « seule » le pouvoir de nous faire sentir « ce monde fabuleux de nos souvenirs qui est devenu le monde de la vérité. »
« Villes de garnison » montre Jean suivant « le troisième régiment d’infanterie de Fontainebleau » où Henri de Réveillon devait s’engager l’année suivante. Journées à la caserne, exercices dans les bois, dîners, Jean se plaît « dans la société de tous ces officiers qui étaient si aimables pour lui ». Il observe leurs airs, leurs manières, les différences d’éducation et de milieu qui définissent leurs fréquentations, leurs codes d’honneur.
« Le scandale Marie » concerne le plus vieux camarade de Santeuil (le père de Jean), « député, ancien ministre et l’homme politique le plus influent du monde parlementaire » à l’époque où il venait « dîner à l’improviste chez les Santeuil ». Ceux-ci ne lui voyaient pas de défauts, certains le disaient malhonnête. « Ainsi du jour au lendemain, à la suite d’un mandat d’amener, toute la France sut que Marie était un voleur, bien qu’on ignorât toutes ses opérations coupables ». Voilà qui reste actuel et ceci aussi : « On vient de clore la discussion sur les massacres d’Arménie : il est convenu que la France ne fera rien. » L’intervention de Couzon, un orateur d’extrême-gauche (le discours de Jean Jaurès est cité en annexe) est racontée avec force, et les campagnes de presse, les questions de Justice et d’Injustice. « Autour de « L’Affaire » » se rapporte à l’affaire Dreyfus.
« La Vie mondaine de Jean » : arrivée des voitures, échange de nouvelles des uns sur les autres, étonnement de croiser ici ou là des invités inhabituels, Jean observe tous les manèges du « monde ». On l’y prend pour un « artiste » ou pour « un homme de lettres », on le trouve « charmant », quoique trop aimable avec les domestiques. Qui inviter, qui éviter, cela donne lieu à des situations cocasses, comme quand il comprend être le quatorzième à table ou qu’on l’invite pour combler une absence puis le désinvite. La description des petitesses du snobisme et des ridicules est magistrale.
A une soirée chez la duchesse de Réveillon où il se promène avec « le roi de Portugal », M. de Lemperolles s’étonne auprès d’elle de voir Sa Majesté « avec ce petit Santeuil » : « Vraiment on gâte aujourd’hui les jeunes gens d’une manière ! sans se douter de ce dont ils sont capables. Ah, ma cousine, si vous connaissiez la vie comme moi ! qu’est-ce que cette fleur que ce Santeuil a à la boutonnière ! Moi, à mon âge, je n’oserais pas porter une fleur à ma boutonnière, et lui un jeune homme ! Mais ce n’est pas un homme, une vraie femme, une vraie femme, gronda-t-il en prenant un marron glacé. »
« Figures mondaines » atteste du flux et du reflux dans le désir d’être invité. Dans le monde, Jean « se sentait comme de l’âge, de la bravoure et du talent ». Mais il apprécie davantage les soirées amicales, comme chez le duc d’Etampes où des musiciens jouaient « les quatuors de Beethoven, de Franck, de d’Indy préférés du duc » ou d’être reçu chez un collectionneur de Monet. Nous le verrons même dans les affres d’un duel après avoir été insulté en public.
« De l’amour » nous montre Jean amoureux puis Jean jaloux (annonce d’« Un amour de Swann »), Bergotte, « Françoise » qui annonce Albertine. On y entend « cette phrase de la sonate de Saint-Saëns que presque chaque soir au temps de leur bonheur il lui demandait et qu’elle lui jouait sans fin ».
Jean Santeuil se termine avec « La vieillesse des parents de Jean ». Quelle maturité chez ce jeune écrivain : « Nous ne laissons rien de nous que ce qui a pu prendre vie dans les autres. » Les thèmes de la Recherche sont déjà là. On mesure le travail qu’il a fallu pour relier tout cela – basé sur ce que Proust a vécu entre 24 et 29 ans – dans une structure harmonieuse et parachevée, un parcours de la naïveté à l’analyse, de l’observation à la réflexion – hommage à la vie, à la nature, à la beauté, à l’art – une vocation littéraire.
 « A la juger d’après les principes de cette esthétique [celle de W. Morris telle que décrite par P.], ma chambre n’était nullement belle, car elle était pleine de choses qui ne pouvaient servir à rien et qui dissimulaient pudiquement, jusqu’à en rendre l’usage extrêmement difficile, celles qui servaient à quelque chose. Mais c’est justement de ces choses qui n’étaient pas là pour ma commodité, mais semblaient y être venues pour leur plaisir, que ma chambre tirait pour moi sa beauté. Ces hautes courtines blanches qui dérobaient aux regards le lit placé comme au fond d’un sanctuaire ; la jonchée de couvre-pieds en marceline, de courtepointes à fleurs, de couvre-lits brodés, de taies d’oreillers en batiste, sous laquelle il disparaissait le jour, comme un autel au mois de Marie sous les festons et les fleurs, et que, le soir, pour pouvoir me coucher, j’allais poser avec précaution sur un fauteuil où ils consentaient à passer la nuit ; à côté du lit, la trinité du verre à dessins bleus, du sucrier pareil et de la carafe […] »
« A la juger d’après les principes de cette esthétique [celle de W. Morris telle que décrite par P.], ma chambre n’était nullement belle, car elle était pleine de choses qui ne pouvaient servir à rien et qui dissimulaient pudiquement, jusqu’à en rendre l’usage extrêmement difficile, celles qui servaient à quelque chose. Mais c’est justement de ces choses qui n’étaient pas là pour ma commodité, mais semblaient y être venues pour leur plaisir, que ma chambre tirait pour moi sa beauté. Ces hautes courtines blanches qui dérobaient aux regards le lit placé comme au fond d’un sanctuaire ; la jonchée de couvre-pieds en marceline, de courtepointes à fleurs, de couvre-lits brodés, de taies d’oreillers en batiste, sous laquelle il disparaissait le jour, comme un autel au mois de Marie sous les festons et les fleurs, et que, le soir, pour pouvoir me coucher, j’allais poser avec précaution sur un fauteuil où ils consentaient à passer la nuit ; à côté du lit, la trinité du verre à dessins bleus, du sucrier pareil et de la carafe […] »