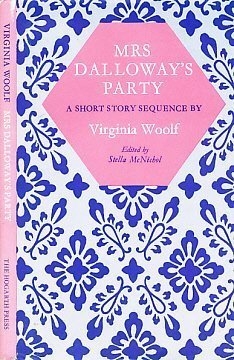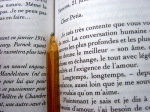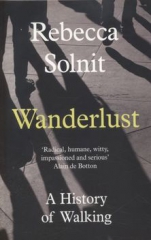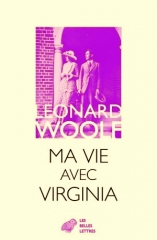Les sept textes de Virginia Woolf publiés dans La soirée de Mrs Dalloway, je les avais déjà lus dans d’autres recueils. Ils sont ici traduits par Nancy Huston qui introduit ce petit livre de façon convaincante, suivant Stella McNichol dans son initiative « de rassembler des nouvelles thématiquement et temporellement proches du roman » Mrs Dalloway.
Mrs Dalloway dans Bond Street, la première nouvelle, est la seule dont Clarissa Dalloway est l’héroïne principale. Le plaisir de relire cette déambulation londonienne dans le but de s’acheter des gants (à rapprocher d’une autre qu’elle m’a rappelée, à la recherche d’un crayon à mine de plomb) a redoublé en comparant cette traduction à celle de Josée Kamoun (dans le recueil La fascination de l’étang).
Ce pourrait être le premier chapitre d’un roman, comme elle l’écrivait dans son Journal en 1922. Huit pages sur douze décrivent les impressions de Mrs Dalloway en chemin ; les suivantes, ce qui se passe dans la boutique. Un régal d’écriture du « flux de conscience » chez une femme « charmante, posée, ardente, aux cheveux étrangement blancs vu le rose de ses joues : c’est ainsi que la vit Scrope Purvis, C.B., qui se hâtait vers son bureau. » (N. H.) – « charmante, équilibrée, pleine de goût de vivre ; curieux ces cheveux blancs avec ces joues roses ; ainsi la voit Scope Purvis, compagnon de l’Ordre du Bain, qui court à son bureau. » (J. K.)
Les temps changent, je m’en étonne. Big Ben « sonne » ou « sonnait », les passages du passé au présent varient d’une traduction à l’autre, le présent étant en principe réservé au monologue intérieur. On aimerait une édition bilingue pour voir ce qu’il en est dans le texte original.
Les nouvelles suivantes se déroulent à la soirée : homme ou femme, les invités dont Virginia Woolf rapporte les états d’âme sont mal à l’aise. Un camarade d’école n’a pas osé décliner l’invitation de Richard Dalloway croisé dans le quartier de Westminster, qu’il n’avait plus vu depuis vingt ans. « Pas du tout son genre » de s’habiller pour une soirée, mais il ne veut pas être impoli. Il observe : « Oisifs, bavards et surhabillés, sans la moindre idée en tête, ces dames et ces messieurs continuaient de parler et de rire » (N. H.) – « Et tout ce beau monde de rire et de papoter, ces gens désœuvrés, bavards, trop élégants ! » (Hélène Bokanowski dans le recueil La Mort de la phalène)
Il faudra bien qu’il joue le jeu lui aussi quand Dalloway lui présentera Miss O’Keefe, une trentenaire à l’air arrogant, avec qui il tiendra une conversation désaccordée après laquelle ces deux « amoureux du genre humain » se quitteront, « se détestant, détestant toute cette maisonnée qui leur avait fait vivre une soirée de douleur et de désillusion » (L’homme qui aimait le genre humain).
Virginia Woolf aimait et craignait en même temps la vie mondaine, son Journal l’atteste. Nul doute qu’elle prête à Lily Everit ses propres sentiments quand elle écrit que sa vraie nature était « de faire de grandes promenades solitaires méditatives, d’escalader des portails, de patauger dans la boue, le brouillard, le rêve et l’extase de la solitude, d’admirer la roue du pluvier et de surprendre des lapins » etc. (Présentations)
Ancêtres puis Ensemble et séparés illustrent à sa manière, subtile et ironique, les malentendus qui naissent de devoir converser aimablement avec des gens qu’on ne connaît pas et qui ne savent rien de votre vie. Faire bonne figure, écouter patiemment ceux qui ne s’intéressent aucunement à vous, tout peut être source d’irritation dans la grande comédie du paraître qu’est la vie mondaine. Même et parfois surtout, pour Mabel comme pour celle qui invente son histoire, la façon dont on est habillé (La nouvelle robe).
La dernière nouvelle, Un bilan (chez Nancy Huston, Mise au point chez Hélène Bokanowski), en moins de six pages, emmène deux invités des Dalloway dans le jardin : un fonctionnaire « très estimé » (lui aussi compagnon de l’ordre de Bath) et Sasha Latham, « dame élancée et élégante aux mouvements quelque peu indolents », contente de prendre l’air en compagnie de cet homme « sur qui l’on pouvait compter, même dehors, pour parler sans arrêt », ce qui lui permet de marcher « majestueuse, silencieuse, tous les sens en éveil, les oreilles dressées, les narines humant l’air, telle une créature sauvage mais très contrôlée, qui prenait son plaisir la nuit. »
Le génie de Virginia Woolf est d’enchaîner ainsi les situations, les sensations, les dialogues et le ressenti, l’ennui et l’émerveillement, donnant vie à ses personnages, avec admiration ou avec ironie, souvent avec empathie. « La soirée de Mrs Dalloway est aussi, sur le fond, une réflexion magistrale sur le thème de l’imperfection humaine. » (Nancy Huston)
Textes & prétextes, onze ans
Merci pour vos visites & vos commentaires.
Tania