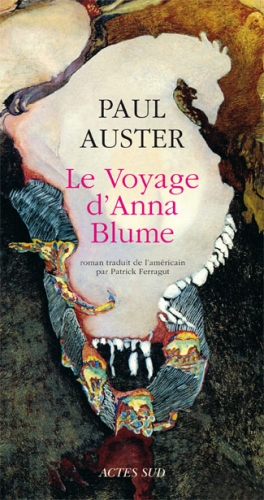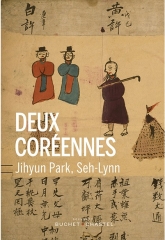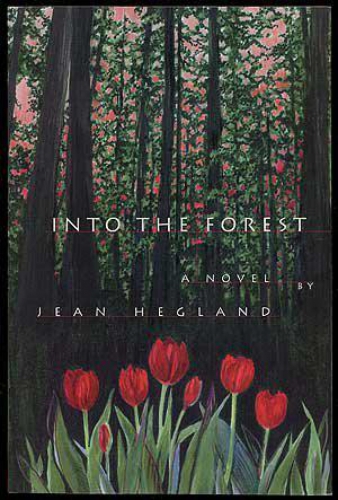Le voyage d’Anna Blume de Paul Auster paraît en français en 1989 (traduit de l’américain par Patrick Ferragut). Son titre original de 1987 est meilleur : In the country of last things (Au pays des choses dernières, titre adopté dans la collection Babel). 2019, je retrouve Anna Blume, trente ans après. Je me souviens d’avoir déjà pensé alors que « la survie » conviendrait davantage à cette histoire que « le voyage ».
Un voyage terrifiant, publié deux ans après La servante écarlate de Margaret Atwood dont je l’ai parfois rapproché en le lisant – vous voilà prévenus. Regardez la couverture choisie par Actes Sud. J’ai failli renoncer après quelques pages, je me suis reproché ma mollesse, j’ai tenu jusqu’au bout. Mon père m’a dit un jour : « Tu vas te bousiller avec ce genre de lecture », j’y ai repensé. Mais l’œuvre de Paul Auster m’accompagne depuis ces années-là. J’ai voulu retrouver pourquoi, quand il est question du grand romancier américain, l’auteur du fabuleux 4321, Le voyage d’Anna Blume est, avec Moon Palace, un des premiers titres qui me viennent en tête – simplement parce que ce sont les premiers que j’ai lus ?
Voici le début : « Ce sont les dernières choses, a-t-elle écrit. L’une après l’autre elles s’évanouissent et ne reparaissent jamais. Je peux te parler de celles que j’ai vues, de celles qui ne sont plus, mais je crains de ne pas avoir le temps. Tout se passe trop vite, à présent, et je ne peux plus suivre. » Anna Blume a pris le bateau pour aller à la recherche de William, son frère disparu. Dans une ville livrée au chaos, elle écrit à celui qui l’aimait et a tenté de l’en dissuader, prédisant qu’elle ne le trouverait pas : « Peu importe que tu le lises. Peu importe même que je l’envoie – en supposant que cela soit possible. Peut-être cela se ramène-t-il à la chose suivante. Je t’écris parce que tu n’es au courant de rien. Parce que tu es loin de moi et que tu n’es au courant de rien. »
Dès le début, il y a cette foi ou plutôt ce salut dans l’écriture, cette importance des mots. Même si paradoxalement un passage célèbre, beaucoup plus loin, raconte comment Anna Blume brûle des livres pour se chauffer. La description de la vie dans cette ville est insoutenable. « Une maison se trouve ici et le lendemain elle a disparu. » Les choses s’évanouissent, les êtres humains aussi – de faim, d’une chute, d’une agression : « On a beau dire, la seule chose qui compte est de rester sur ses pieds. »
Gravats, barricades et rackets, ordures, chaque rue a ses pièges, et « les habitudes sont mortelles. Même si c’est la centième fois, il faut aborder chaque chose comme si on ne l’avait jamais rencontrée. » Les choses disparaissent. « Les gens meurent et les bébés refusent de naître. » Les nouveaux venus sont des proies faciles : vols, escroqueries, coups, expulsions. « On s’extrait du sommeil chaque matin pour se retrouver en face de quelque chose qui est toujours pire que ce qu’on a affronté la veille ; mais, en parlant du monde qui a existé avant qu’on s’endorme, on peut se donner l’illusion que le jour présent n’est qu’une apparition ni plus ni moins réelle que le souvenir de tous les autres jours qu’on trimbale à l’intérieur de soi. » La « petite fille enjouée » n’est plus que « bon sens et froids calculs », décidée à tenir aussi longtemps que possible.
Dans le monde où elle a débarqué, les « Coureurs » s’entraînent pour se tuer en courant, les « Sauteurs » se jettent dans le vide, les « Cliniques d’euthanasie » proposent plusieurs tarifs, on peut aussi s’inscrire au « Club d’assassinat » si l’on préfère mourir par surprise. Les cadavres sont emmenés aux « Centres de transformation » – il est interdit d’inhumer. Le début du roman est une descente aux enfers, où ne subsiste que cette question : « voir ce qui se passe lorsqu’il n’y a rien, et savoir si nous serons capables d’y survivre. » Anna Blume tâche, pour y arriver, de ne pas céder à la tentation de la mémoire (les souvenirs donnent le cafard), même si elle n’y arrive pas toujours. Le rédacteur en chef lui avait dit que c’était une folie pour une jeune fille de dix-neuf ans « d’aller là-bas », d’autant plus qu’il avait déjà envoyé un autre journaliste à la recherche de William, un certain Samuel Farr dont il lui a donné une photo.
Un peu d’humanité apparaît dans le récit avec la rencontre d’Isabelle, une vieille femme qui pousse un chariot de supermarché. Anna, qui vit dans la rue, lui vient en aide un jour où elle a failli se faire écraser, puis la raccompagne chez elle. Isabelle s’inquiète pour son mari qui dépend d’elle et ne sort plus de leur appartement. Anna va vivre un certain temps avec eux dans une pièce de trente mètres carrés – le confort après des mois à la belle étoile.
A partir de là, Anna Blume n’est plus seule. Vous découvrirez, si vous lisez Le voyage d’Anna Blume, comment elle trouve ensuite un autre abri et tisse d’autres liens, à la fois forts et fragiles. Dans cette ville où posséder de bons souliers est vital, il existe encore des gens pour qui la vie n’a pas de sens sans écrire, échanger, secourir, aimer. C’est pourquoi l’héroïne (et non un héros comme habituellement dans les romans de Paul Auster) continue sa longue lettre, en écrivant de plus en plus petit, dans un cahier sauvé du désastre : « Anna Blume, ta vieille amie d’un autre monde. »