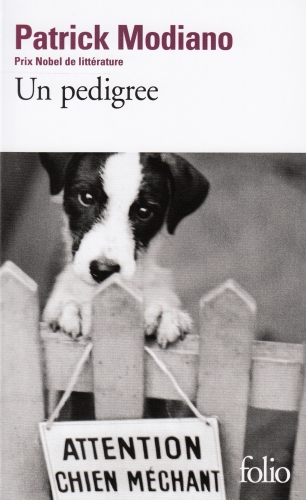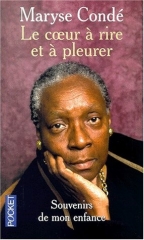Identité nomade, en un peu plus de cent pages, retrace l’itinéraire personnel de J. M. G. Le Clézio (°1940), de Nice à l’Afrique, de la Bretagne à l’Ile Maurice. Dans de courts chapitres, celui-ci revient sur des faits déjà abordés par ailleurs, notamment dans Chanson bretonne (L’enfant et la guerre), comme les bombardements à Nice où il vivait avec sa mère, sa grand-mère et son frère ; il ne connaîtra qu’à l’âge de dix ans son père médecin en Afrique (L’Africain).

© Mahi Binebine, sans titre, bas-relief, cire et pigments sur bois, 170 x 220 cm – 2021 (source)
Nice alors était loin de l’image luxueuse d’aujourd’hui. On n’y mangeait pas à sa faim, on y mourait de dysenterie ou de dénutrition, on n’y avait pas accès au bord de mer, fermé par des murs peints montés par les Allemands. « Le bien, c’est la joie que peut donner un moment de liberté » : cette phrase éclaire son état d’esprit dans la guerre. Celle-ci aussi : « Je crois que si on veut définir ce qu’est la guerre, je dirais que c’est un crime contre les vieux et contre les enfants. »
Sur le bateau pour le Nigéria, à huit ans, il écrit un « roman d’enfant » où un garçon africain de son âge, perdu en Europe, retourne en Afrique pour découvrir la terre de sa famille. Pour Le Clézio, l’Afrique était « la terre de l’abondance » avec ses fruits et légumes à satiété à chaque escale, le goût des fruits tropicaux. Là-bas, même si leur mère « faisait l’école », ils goûtaient ensuite à la liberté enivrante, « lâchés dans la savane », plus libres que les enfants africains qui devaient grandir très vite, jouaient moins, devaient très tôt se rendre utiles.
« J’ai en moi cette profonde reconnaissance que l’Afrique m’a donné la joie de vivre quand j’avais huit ans, alors que je venais d’un pays détruit. Je crois que je n’oublierai jamais cette bascule. » En 1950, son père les emmène au Maroc pour un voyage touristique – premier aperçu des injustices de la colonisation. Au Nigéria aussi, ils sont les témoins d’injustices cruelles. Le pays est alors prospère, agricole. Ensuite le pétrole « a tout détruit, tout sali, tout aboli. »
Ses parents sont mauriciens, mais à sa naissance, « le plus petit pays de l’Union des Etats africains » n’existait pas, c’était une colonie britannique. « C’est la raison pour laquelle je signe mes livres « JMG », en effet c’est ce qui est écrit sur mon passeport britannique : sur la couverture, on mettait les initiales du prénom et jamais le nom entier. » Français par sa mère, britannique par son père : à dix-sept ans se pose la question du service militaire. Il obtiendra des sursis pour terminer ses études « médiocres ». Il fera son service dans le civil, comme professeur de sciences politiques en Thaïlande ; expulsé pour avoir parlé du trafic d’êtres humains, il sera envoyé au Mexique.
Cette « vie aventureuse » malgré lui ne lui a pas donné d’identité stable et cela va très loin, au point d’écrire : « Encore aujourd’hui je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas si j’appartiens à la culture française » ! Le Clézio aime beaucoup la littérature anglaise, il indique ses lectures marquantes. Sa famille est « de lointaine origine bretonne », il porte un nom breton, hérité d’un ancêtre soldat révolutionnaire qui a refusé de couper ses cheveux longs et a quitté la France en bateau avec sa femme enceinte – elle a voulu rester à l’île Maurice.
Identité nomade évoque des racines familiales et aussi le goût de l’aventure, du voyage, des cultures étrangères (un mot que l’auteur n’emploie pas). Dans le dernier tiers de ce petit livre sont cités de nombreux auteurs anglais, marocains, suédois, allemands, américains, latino-américains, africains…
Quelle est l’utilité de la littérature ? Que vaut la littérature dite « engagée » ? A la question de savoir « si l’art peut quelque chose », Le Clézio se rallie à la définition de Mahi Binebine – dont un tableau figure au début du livre (non trouvé en ligne, d’où le choix d’une autre illustration) –, un artiste marocain, créateur, poète et romancier « qui exprime simplement la nécessité dans laquelle nous sommes de nous rencontrer entre voisins. »