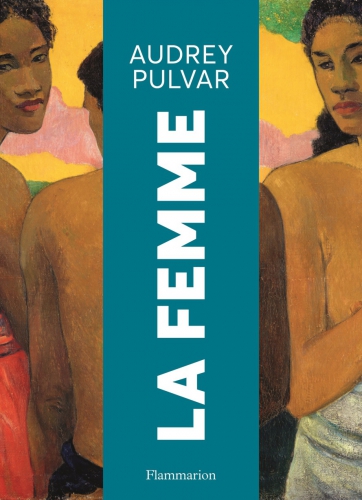Des nouvelles de Virginia Woolf ? Cela tombe bien pour ma 1000e note sur ce blog (soit une note pour deux billets par sujet en général). Rêves de femmes comporte six nouvelles (traduites et éditées par Michèle Rivoire) précédées d’un essai, « Les femmes et le roman » et suivies d’un petit dossier sur ce génie de la littérature anglaise.

« Edition dérivée de la Bibliothèque de la Pléiade », indique l’éditeur. J’hésite souvent devant ces nouveaux petits recueils, qui reprennent des textes déjà publiés par ailleurs. Et c’est bien le cas pour ce Folio classique : quatre de ces nouvelles figuraient déjà dans La mort de la phalène et dans La fascination de l’étang (édités au Seuil). Lisons, relisons. Ces textes datent de 1920 à 1940.
« Les femmes et le roman » reprend deux conférences données à Cambridge, avec des arguments que Virginia Woolf développera dans Une chambre à soi. « L’histoire de l’Angleterre est l’histoire de la branche masculine, non de la branche féminine. » Comment écrire l’histoire des femmes et parmi elles, des femmes créatives ? Pourquoi faut-il attendre la fin du XVIIIe siècle et le tournant du XIXe pour croiser en Angleterre des femmes qui « s’adonnent à l’écriture » avec succès ? Voilà à quoi elle entreprend de répondre, en espérant un âge d’or où les femmes auront « un peu de temps libre, un peu d’argent et un lieu à elles. »
Ce thème se prolonge dans « Une société » : six ou sept amies se retrouvent « un soir après le thé » et se penchent sur le cas de l’une d’elles, Poll, à qui son père a légué sa fortune « à condition qu’elle lise tous les livres de la London Library ». Quelle déception devant tant de livres médiocres à côté des Shakespeare, Milton ou Shelley ! Jane, la plus âgée, s’interroge : « Voyons, si les hommes écrivent de telles sornettes, pourquoi faudrait-il que nos mères aient gâché leur jeunesse à les mettre au monde ? »
Ainsi naît leur « société de questionneuses ». Elles font le serment de ne pas avoir d’enfant « avant d’en avoir le cœur net ». Ecrite en réaction aux opinions misogynes d’Arnold Bennettt, cette nouvelle satirique est très drôle, davantage que « Le legs » où un veuf hérite du journal intime de sa femme… et des surprises qu’il contient.
Dans « Un collège de jeunes filles vu de l’extérieur », c’est la lune qui jette un coup d’œil par les fenêtres, en particulier dans la chambre d’Angela où, sans souci du règlement, se trouvent aussi Sally, Helena, Bertha. Une nuit entre sommeil et rires où l’on entre dans les pensées d’Angela, où l’on épouse les songes de la lune observant « cette vapeur » qui s’exhale des chambres des dormeuses, « qui s’accrochait aux arbustes, comme la brume, et puis, libérée, s’envolait dans les airs. » Une vision impressionniste à rapprocher de « Au verger » où Miranda dort et rêve dans une chaise longue sous un pommier.
« Moments d’être : « Les épingles de chez Slater ne piquent pas » » est riche en sous-conversation. Fanny s’interroge sur cette remarque inattendue de Miss Craye (Julia), son professeur de piano, célibataire, qui lui semble bizarrement heureuse. « C’est dans le champ, sur la vitre, dans le ciel – la beauté ; et je ne peux l’étreindre, ni l’atteindre, moi (…), moi qui l’aime passionnément, et qui donnerais tout au monde pour la posséder ! »
Si plusieurs de ces nouvelles contiennent des allusions saphiques, comme Virginia Woolf l’a confié à Vita Sackville-West, « Lappin et Lapinova » se veut une comédie sur le mariage, à partir de petits noms secrets entre les époux. Ce jeu de langage permet un certain temps à Rosalind de se sentir heureuse, complice avec son mari Ernest, même en dehors de leur « territoire privé », par exemple quand elle s’ennuie au milieu de sa belle-famille. Mais le jeu durera-t-il ?
Rêves de femmes offre un aperçu de la condition féminine et des questions qu’elle soulève chez Virginia Woolf. Il me semble que pour apprécier ces nouvelles et en goûter les allusions, il vaut mieux déjà connaître un peu sa vie et son œuvre ou, en tout cas, lire les notes finales du recueil. A travers ces figures de femmes dans leur intimité, elle montre leur désir d’autonomie, tout en explorant l’art du récit et de la suggestion.
 « Et puis, au-dessus du pommier et du poirier deux cents pieds au-dessus de Miranda endormie dans le verger le sinistre tintement de cloches à la voix sourde, entrecoupée, édifiante sonna les relevailles de six pauvresses de la paroisse ; et le pasteur rendit grâce au ciel.
« Et puis, au-dessus du pommier et du poirier deux cents pieds au-dessus de Miranda endormie dans le verger le sinistre tintement de cloches à la voix sourde, entrecoupée, édifiante sonna les relevailles de six pauvresses de la paroisse ; et le pasteur rendit grâce au ciel.