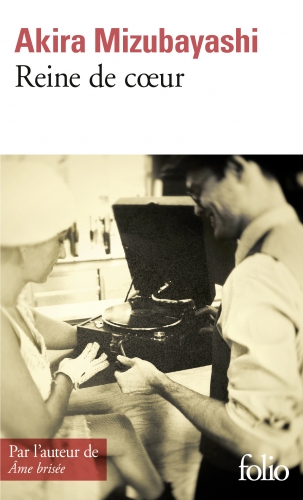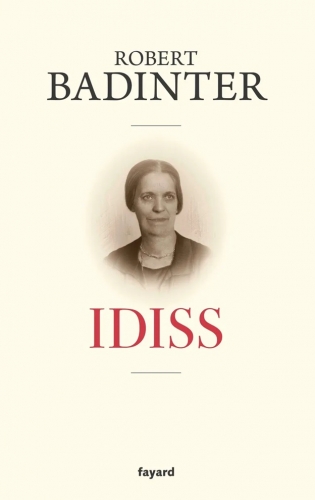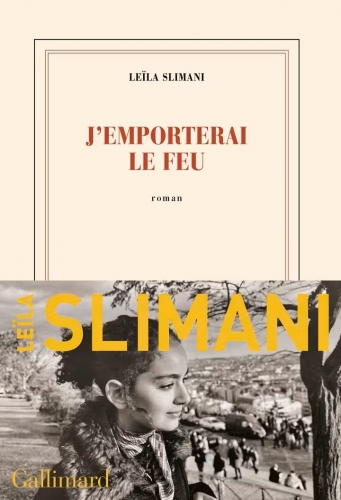Dans le prolongement du magnifique Ame brisée, Akira Mizubayashi a écrit deux autres romans sur le thème de la musique et de la guerre. Reine de cœur (2022), le deuxième de la trilogie, s’ouvre sur trois épigraphes autour d’un terrible épisode guerrier durant la guerre « d’agression coloniale en Chine » menée par l’armée impériale japonaise. L’écrivain tokyoïte (qui écrit en français) a des mots très durs pour ce passé impérialiste.
C’est dans ce contexte que nous découvrons une première scène de guerre : le jeune soldat Jun Mizukami, à qui le sergent-major tend son sabre après lui avoir montré comment couper la tête d’un ouvrier chinois, ne se sent pas « le droit de faire une chose pareille », malgré les menaces d’être accusé de « haute trahison », et finit par s’évanouir. En mai 1940, lors de l’exode vers le sud de la France, Anna (la vingtaine, enceinte) et son oncle Fernand, courent se réfugier dans un bois pour échapper aux tirs des avions et y découvrent un corps sans tête. Le 25 mai 1945, la jeune infirmière Ayako cherche un abri dans Tokyo contre un raid aérien imminent.
Après ce « premier mouvement », l’horreur cède le pas à de belles rencontres humaines : Jun, altiste, et Anna, serveuse dans le bistrot de son oncle et future institutrice, ont fait connaissance à Paris en 1937. Etudiant étranger au Conservatoire, Jun parlait déjà bien le français, appris à Tokyo. Monsieur Jean, un vieil homme qui l’avait vu plongé dans la lecture de Jean-Christophe, s’était pris d’amitié pour le jeune « musicien-philosophe », comme l’appelait Fernand. Jean était lui-même altiste. Deux ans et demi plus tard, Jun et Anna se séparent à Marseille, où Jun doit embarquer pour le Japon et y servir l’armée. Ils y passent la nuit ensemble pour la première fois avant son départ.
Le troisième mouvement se déroule en novembre 2007. Marie-Mizuné Clément vient de donner son premier concert en tant que premier alto solo au Théâtre des Champs-Elysées. Dans le bus qui la ramène chez elle, un sexagénaire remarque son instrument puis reconnaît l’altiste, il était au concert et la félicite pour son jeu dans le Don Quichotte de Strauss et la 11e symphonie de Chostakovitch. Il lui donne son journal où il a lu un article intéressant du Monde des Livres sur « La Musique à l’épreuve de l’Histoire ».
Le libraire confirme à Mizuné l’intérêt du livre présenté dans Le Monde et elle lui achète L’oreille voit, l’œil écoute. Un musicien japonais y raconte les dernières années de la guerre sino-japonaise en évoquant souvent la musique classique et Chostakovitch en particulier. Très émue par sa lecture, Mizuné se rendra chez sa mère, Agnès, pour l’interroger à propos de sa grand-mère Nanou. Son histoire et celle du livre semblent très proches. Au grenier, elle va trouver un cahier d’Anna et sept lettres de Jun.
Comme dans Ame brisée, Mizubayashi mêle dans Reine de cœur le thème amoureux à celui de la musique et de la guerre, ici en cinq mouvements, entre France et Japon. Lettres, journaux et courriels s’insèrent dans le récit. Certaines pages donnent envie d’écouter et de lire en même temps les œuvres musicales en quelque sorte décrites. Un violon japonais appelé « Reine » va changer de main – « Reine » est en fait la transcription phonétique de deux idéogrammes qui se prononcent « ré-i-né », c’est-à-dire « Merveilleuse sonorité ».