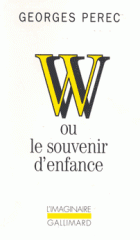En français : Les vies multiples d’Amory Clay. En anglais : Sweet Caress. The Many Lives of Amory Clay. Encore un mystère de la traduction des titres pour ce roman de William Boyd (2015, traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Isabelle Perrin). Il y manque les caresses, elles reviennent dans la citation de Jean-Baptiste Charbonneau en épigraphe : « Quelle que soit la durée de votre séjour sur cette petite planète, et quoi qu’il vous advienne, le plus important c’est que vous puissiez, de temps en temps, sentir la caresse exquise de la vie. » (Avis de passage)

Ensuite, une photo noir et blanc, « Amory Clay en 1928 » : une jeune femme en maillot foncé, les pieds dans l’eau, esquisse un pas de danse, un bras levé vers le ciel. Le titre du premier chapitre la définit très simplement : « La fille à l’appareil photo ». Née le 7 mars 1908, Amory – la narratrice, qui entreprend de raconter sa vie – est la fille aînée, avant Peggy (1914) et Xan (Alexander, 1916). D’autres photos, la plupart prises par elle, s’insèrent tout au long du roman.
Le récit chronologique de sa vie alterne avec son « Journal de Barrandale, 1977 », du nom de l’île où elle où elle vit les dernières années de sa vie avec son chien Flam dans un cottage. Amory a reçu de son père, nouvelliste et « homme de lettres polyvalent », ce prénom « androgyne », écrit Boyd. « A mes yeux, un prénom est une affaire bien trop grave pour être choisi à la légère : il devient votre étiquette, votre définition, votre identifiant. » Quand sa sœur est née, son père était déjà parti à la guerre et c’est Greville, le frère de leur mère, qui a choisi celui de sa sœur. Pour le troisième enfant, Clay avait choisi « Alexander » pour un garçon, « Marjorie » pour une fille – prénom féminin dont Amory s’est souvent servie quand elle était fâchée contre son frère.
Greville Reade-Hill va jouer un rôle important dans la vie de sa nièce. Cet « ancien opérateur de reconnaissance photographique dans le corps aérien de l’armée britannique » est devenu photographe mondain, étiquette qu’il rejette, lui préférant « photographe-tout-court ». Il lui offre pour ses sept ans un Kodak Brownie N°2, avec lequel elle prend sa première photographie lors d’une fête d’anniversaire, de « dames chapeautées en robe longue » dans le jardin de Beckburrow, dans l’East Sussex, « notre chez-nous ». Une maison achetée grâce aux droits dérivés d’une adaptation théâtrale qui avait soudain enrichi la famille.
Amory est placée en pension du fait d’un legs d’une grand-tante destiné à l’éducation de l’aînée de ses petits-neveux. Sa mère ne se montrait jamais affectueuse et c’est au pensionnat pour jeunes filles qu’Amory fait son apprentissage sentimental auprès de sa meilleure amie à qui elle confie que le seul homme qu’elle aimerait embrasser, c’est Greville, son oncle, « l’homme le plus beau, le plus amusant, le plus gentil et le plus sardonique » qu’elle ait jamais rencontré.
En famille, elle prend des photos qu’il lui a appris à tirer elle-même et met un titre et une date au dos de chacune au crayon, avant de les glisser dans son album. « Je crois avoir été consciente, même à l’époque, que seule la photographie peut réussir ce tour de magie avec tant d’assurance et de facilité : arrêter le temps, capturer cette milliseconde de notre existence et nous permettre de vivre éternellement. »
Elève douée, Amory remporte un prix de dissertation et est encouragée à présenter le concours d’entrée à Oxford, mais elle ne veut pas aller à l’université. Elle veut devenir photographe professionnelle. Quand son père annonce un jour sa visite au pensionnat pour lui « parler en tête-à-tête », elle s’inquiète – avec raison. Son père prétend que tout va bien – sa sœur Peggy est une pianiste prodige et son frère élève des cochons d’inde – et il l’emmène en voiture en direction du nord. Tout à coup, il bifurque en direction d’un lac artificiel vers lequel il roule de plus en plus vite en lui disant, juste avant de plonger dans l’eau : « Je t’aime, ma fille chérie. Ne l’oublie jamais. »
Elle arrive à se dégager de l’habitacle, puis à en sortir son père, qui fond en larmes (il imaginait le lac plus profond), et ils parviennent à nager jusqu’à la berge. Il sera déclaré fou et interné dans un « asile de luxe ». Amory s’en sort malgré une dépression nerveuse et mettra très longtemps à aller lui rendre visite. Elle a cherché une explication et découvert dans l’histoire de son régiment d’infanterie légère l’épisode de mars 1918 qui a traumatisé son père.
Amory Clay devient donc photographe, d’abord en assistant son oncle Greville chez qui elle s’est installée ; elle découvre que son élégance irréprochable est liée, sans qu’elle s’en soit jamais doutée, à son orientation sexuelle. Il travaille pour plusieurs magazines mondains. Elle couche alors avec un autre photographe, fait ses débuts en tirant le portrait d’une riche héritière sur un court de tennis – sa photo peu académique fait scandale.
Greville doit se séparer d’elle et lui conseille de se faire une mauvaise réputation, « une réputation sulfureuse », pour changer la perception que le monde a d’elle. Elle se rend à Berlin, dans les clubs « décadents », se lie avec une homosexuelle qui lui sert de couverture pour prendre des photos dans des bordels semi-clandestins, en cachant son appareil dans son sac où elle a bricolé une ouverture. C’est le début des années trente, elle y fait aussi de mauvaises rencontres.
Au retour, son exposition « Berlin bei Nacht » fait scandale à Londres. Après le vernissage, un article du Daily Express lui vaut une descente de police et la confiscation de ses clichés. Elle a réussi tout de même à attirer l’attention de Cleveland Finzi, attaché au Global-Photowatch, un magazine américain, qui lui propose un rendez-vous à son hôtel. C’est le début d’une histoire d’amour.
Dans Les vies multiples d’Amory Clay, William Boyd lui fait raconter les hauts et les bas de sa carrière de photographe internationale (en dernier durant la guerre au Vietnam), mais aussi de son parcours personnel : ses relations avec sa famille, ses amours et ses amitiés, son mariage et ses deux filles, la maladie qui la décide, tant qu’il est encore temps, à écrire tout cela pour que ses filles sachent un peu mieux qui était leur mère. Des souffrances, des risques, des bonheurs, de 1908 à 1983.

En refermant Les vies multiples d'Amory Clay, j’étais persuadée qu’Amory Clay avait vraiment existé, ainsi que certains autres personnages. Or ce roman est une fiction totale, illustrée de photographies anonymes ! William Boyd réussit à y rendre tous les aspects d’une vie de femme aventureuse : liens familiaux et goût de l’indépendance, soif d’émancipation et d’expériences, prise de risques, désirs amoureux, rêves et rencontres, interrogations sur son rôle de mère, combativité… Les allers-retours entre sa vie baroudeuse de photographe-reporter et ses réflexions de femme qui a vécu et tâche de vivre encore au mieux le temps qui lui reste – à elle qui croyait pouvoir « arrêter le temps » – apportent au récit une dimension supplémentaire, en profondeur.
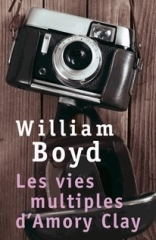 « Mes dîners avec Charbonneau [à New York] suivaient à présent une certaine routine. Comme Paris lui manquait, il essayait toujours de dénicher un restaurant français et, quelle que fût la qualité des mets, se déclarait toujours atrocement déçu par ce qu’il qualifiait de parodie de cuisine française, de fiasco américain. Je le contredisais souvent, histoire d’attiser son indignation – pour mon palais anglais, tout cela semblait délicieux. Il pouvait disserter sur tout ce qu’il mangeait ; jusqu’aux petits pains individuels et au sel qui n’échappaient pas à sa vigilance gastronomique. Presque malgré moi, j’appris beaucoup sur ce que l’on pouvait exiger de l’acte nécessaire de s’alimenter, des viandes, poissons ou légumes que nous mâchons et avalons pour pouvoir survivre. Mais Charbonneau appliquait à toute l’opération une analyse tellement experte que cela m’en paraissait presque malsain. »
« Mes dîners avec Charbonneau [à New York] suivaient à présent une certaine routine. Comme Paris lui manquait, il essayait toujours de dénicher un restaurant français et, quelle que fût la qualité des mets, se déclarait toujours atrocement déçu par ce qu’il qualifiait de parodie de cuisine française, de fiasco américain. Je le contredisais souvent, histoire d’attiser son indignation – pour mon palais anglais, tout cela semblait délicieux. Il pouvait disserter sur tout ce qu’il mangeait ; jusqu’aux petits pains individuels et au sel qui n’échappaient pas à sa vigilance gastronomique. Presque malgré moi, j’appris beaucoup sur ce que l’on pouvait exiger de l’acte nécessaire de s’alimenter, des viandes, poissons ou légumes que nous mâchons et avalons pour pouvoir survivre. Mais Charbonneau appliquait à toute l’opération une analyse tellement experte que cela m’en paraissait presque malsain. »