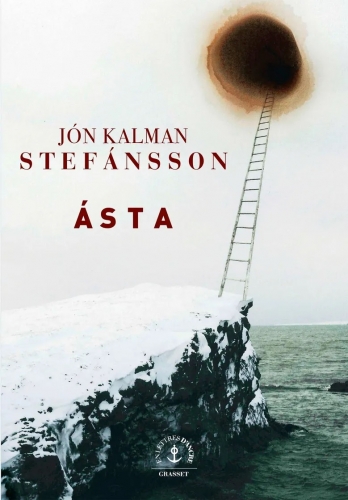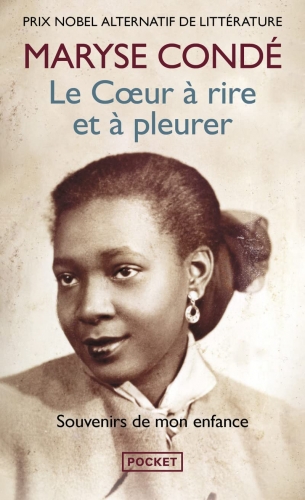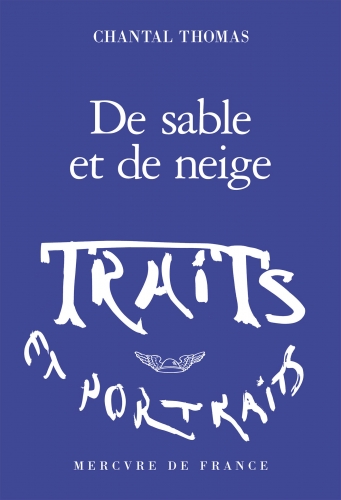Jón Kalman Stefánsson raconte dans Ásta (Saga Ástu, traduit de l’islandais par Eric Boury, 2018), l’histoire d’Helga et Sigvaldi, ses parents, mêlée à celle d’Ásta. Ils ont trouvé son prénom dans Gens indépendants, un roman de Halldor Laxness qui les avait fait pleurer. En voyant que sans la dernière lettre, il restait « Ást » (« amour » en islandais), Helga avait accepté le choix de Sigvaldi : « La vie d’Ásta était née de l’amour et elle grandirait entourée d’amour. » Voilà pour les bonnes intentions. Le roman a un sous-titre : « Où se réfugier quand aucun chemin ne mène hors du monde ? »
Helga, à peine dix-neuf ans, et Sigvaldi, son aîné « d’une bonne dizaine d’années » ont déjà une petite fille de sept mois quand Ásta est conçue, ils vivent à Reykjavik dans un logement confortable en sous-sol. Les marins faisant grève, cet ouvrier « courageux et robuste » est à présent peintre en bâtiment. Très amoureux de sa femme, il ne résiste pas quand elle lui fait des avances – les scènes de sexualité, crûment décrites, sont nombreuses.
« Et trente ans plus tard, Sigvaldi tend un peu trop loin le bras avec son pinceau sur son échelle, il perd l’équilibre et en quelques secondes, son corps s’abat sur le trottoir. » Il ferme les yeux, les rouvre, se revoit petit garçon courant et riant, « ses paupières se ferment. » Le défilé des images d’autrefois continue. Une vieille femme pose ses cabas à terre près de lui et lui parle en norvégien – il est en Norvège, à Stavanger, où il habite avec sa seconde épouse, Sigrid, et avec Sesselja, la fille d’Ásta.
Puis vient la « première lettre d’Ásta », adressée à son « amour » qui s’en est allé. Elle vit à Reykjavik rue Njálsgata, au-dessus de l’appartement d’Anna et Gudmundur qui ont deux enfants, et du sous-sol habité par sa « chère » Björg. Tard le soir, elle écrit à son amant qu’elle l’aime encore et souffre de son absence. Stefánsson prévient ses lecteurs : « Si tant est que ça l’ait été un jour, il n’est désormais plus possible de raconter l’histoire d’une personne de manière linéaire, ou comme on dit, du berceau à la tombe. Personne ne vit comme ça. » Son récit sera discontinu de bout en bout. Pour lui, « nous vivons tout autant dans les événements passés que dans le présent. » Il se demande s’il a eu raison de commencer par la conception d’Ásta…
La voilà soudain « au début des années soixante-dix », « internée en psychiatrie dans une banlieue de Vienne après une tentative de suicide ratée ». Ásta est à Vienne depuis six mois pour étudier le théâtre avec un spécialiste de Bertolt Brecht. Elle a perdu sa nourrice, qui l’a élevée quand sa mère l’a abandonnée, ensuite « celui dont elle préfère ne jamais prononcer le nom » et maintenant sa sœur aînée : « Ceux qui sont aimés des dieux meurent prématurément. »
L’auteur cite un passage du poème « A ceux qui viendront après nous » :
Dans les livres anciens, il est dit ce qu’est la sagesse :
Se tenir à l’écart des querelles du monde et, sans crainte,
passer son peu de temps sur terre. » (Brecht)
Sa sœur lui avait envoyé neuf lettres, presque toutes écrites à l’hôpital, et « Ásta n’en a envoyé que trois en retour. » Son aînée ne le lui reprochait pas, elle la savait très occupée par ses études.
« Si… seulement tu avais la moitié de la gentillesse de ta sœur, tu es aussi invivable que ta gorgone de mère, lui avait dit un jour Sigvaldi, leur père, ou plutôt, il l’avait vociféré, il l’avait crié, au moment où il avait jeté Ásta dans la cage d’escalier de l’immeuble de la rue Skaftahlid, deux ans après qu’elle avait emménagé chez lui. »
En psychiatrie, elle passe ses plus belles journées depuis la fin brutale de son enfance, à quinze ans. Après avoir été une élève modèle, elle était devenue une ado rebelle, victime d’un mauvais gars, envoyée pour travailler l’été chez un paysan des fjords de l’Ouest, en guise de redressement. A la vie chaotique d’Ásta se mêle l’histoire de son père, avant sa chute fatale.
Des moments heureux se glissent entre les drames de leur vie. Comme dans les autres romans de Stefánsson , une bande-son accompagne le récit, ainsi que de nombreuses lectures. Sexe, violence, alcool, mais aussi de la poésie, des instants de contemplation, de complicité, des aurores boréales… Cà et là, des grossièretés – « Tu iras loin avec ta chatte » –, des aphorismes – « Le quotidien est la pierre sur laquelle nous bâtissons notre existence. »
Ásta pâtit, à mon avis, de ce méli-mélo où Stefánsson nous entraîne à sa manière, avec des débuts de phrase ou des questions en guise de titres. Le texte m’a semblé parfois creux : « Quand il faut rentrer le foin, il faut le rentrer. » Ou « Ça fait du bien à l’être humain d’attendre. Ça le pousse à réfléchir un peu. Et une personne qui réfléchit comprend mieux la vie. » Je suis restée à distance, cette fois. Plus enthousiastes, voici les critiques de Télérama et de Libération. Et vous, qu’en avez-vous pensé ?