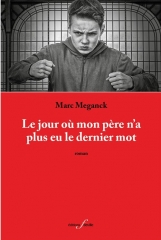Avant de raconter dans La tristesse des anges (Harmur Englanna) ce qui arrive au gamin islandais d’Entre ciel et terre et aux autres « qui vivent à la limite du monde habitable », Jón Kalman Stefánsson donne d’abord la parole aux défunts hantés par les souvenirs alors que le sommeil les fuit. Leur « cohorte égarée entre la vie et la mort » reste à l’affût de la lumière, même vacillante.

Dans une tempête de neige, une nuit d’avril, un homme et deux chevaux « avancent péniblement contre le vent du nord qui est plus fort que toute chose en ce pays ». Quand ils arrivent devant une grande maison, le cheval qui porte le cavalier frappe la première marche du perron. Le gamin hébergé chez le vieux capitaine Kolbeinn, venu voir à la porte, annonce que « Jens le Postier sur un cheval de glace » demande Helga.
Celle-ci s’étonne de ne pas le voir entrer, Jens s’excuse : le gel l’a collé au cheval. Helga et le gamin ont fort à faire pour le détacher et faire monter les marches en le soutenant à cet homme de plus de cent kilos, qui demande qu’on s’occupe des malles et des bêtes et qu’on appelle Skuli, le rédacteur. Une fois séché, rhabillé et réchauffé, le postier lui communiquera les nouvelles.
Le gamin s’est habitué à dormir dans cette maison, seul dans une grande chambre, après avoir lu tout son saoul – « une enivrante liberté ». Tandis qu’aux baraquements des pêcheurs, Andrea est en train de lui écrire, lui craint d’être chassé : il fait la lecture à Kolbeinn, aveugle, d’Hamlet puis d’Othello, mais lit mal, sans respirer, il déçoit le capitaine qui s’est fâché. Les deux femmes de la maison, Geirbrudur et Helga, l’encouragent à s’exercer. Lui préfère les poèmes, comme ceux d’Ólöf Sigurðardóttir.
Au magasin de Tryggvi où on l’avait envoyé, l’apparition de Ragnheidur l’a troublé. La jeune fille « posée, lointaine », à l’allure si froide, a glissé une friandise dans sa bouche puis l’a enfoncée dans la sienne. On compte sur lui aussi pour accompagner Brynjolfur à son bateau, le navire ponté de Snorri qui n’a pas encore repris la mer ; pour traduire des vers anglais en islandais, à l’aide d’un dictionnaire ; pour écrire une lettre…
Chez Sigurdur, le médecin, Jens est réprimandé pour le retard du courrier, même si deux certificats témoignent du mauvais temps qui l’a retardé. Sigurdur cherche à l’impressionner. Jens patiente debout en pensant à Salvör, devenue fille de ferme après avoir fui son mari violent. Elle a perdu un fils, sa fille a été placée ailleurs. En douceur, Salvör et lui se sont rapprochés. Mais le médecin l’envoie remplacer un autre postier malade, loin du Village ; pour éviter les ennuis et gagner la prime promise, Jens accepte.
« La neige tombe si dru, écrit le gamin, qu’elle relie le ciel à la terre. » Il pense à sa sœur perdue, Lilja. Il relit les lettres de sa mère qu’il comprend mieux maintenant. De son frère, il n’a aucune nouvelle. Il voudrait écrire à Andrea de quitter Pétur, mais où irait-elle et de quoi vivrait-elle ? « Les mots semblent être la seule chose que le temps n’ait pas le pouvoir de piétiner. »
Le puissant Fridrik, le pasteur, et beaucoup d’autres critiquent le fait que Geirbrudur ne soit ni épouse ni mère. Kolbeinn lui a bien proposé le mariage, mais elle y perdrait l’autorité sur ses biens. Le vieux capitaine ne s’est jamais marié – « je lisais trop », répond-il quand le gamin s’en étonne. « Mais celui qui ne franchit pas la distance qui mène vers l’autre voit ses jours s’emplir d’un son creux. »
Un soir où Kolbeinn ne rentre pas, Helga et le gamin vont le chercher à l’hôtel tenu par Teitur et sa femme, le « Bout du monde ». Leur fille qui a l’âge du gamin est disgracieuse mais courageuse ; elle pourrait enseigner l’anglais au gamin, suggère Helga. Celui-ci n’a d’yeux que pour Ragnheidur dont il a aperçu les épaules blanches dans la salle ; quand elle le rejoint, elle lui annonce son départ prochain pour Copenhague et l’embrasse.
Geirbrudur a conçu tout un programme pour instruire le gamin qui s’en réjouit, c’était le vœu de ses parents. Mais d’abord, il devra accompagner Jens et l’aider, surtout dans les traversées en barque – le postier n’aime pas l’eau et le gamin s’y connaît bien. Alors commence « Le voyage », un terrible et interminable parcours dans la neige, qui occupe les deux tiers du roman.
Un voyage dantesque, semé d’embûches et d’égarements, de fatigues extrêmes et de dangers mortels. De rares étapes sont les seules occasions de se réchauffer le corps, mais pas forcément l’âme. Les défunts ne sont pas loin. Le gamin a bien du mal à suivre le vaillant postier ami du silence alors que lui a besoin des mots pour se sentir en vie. Et partout, la tristesse des anges : « Voilà les larmes des anges, disent les Indiens au nord du Canada quand la neige tombe. »