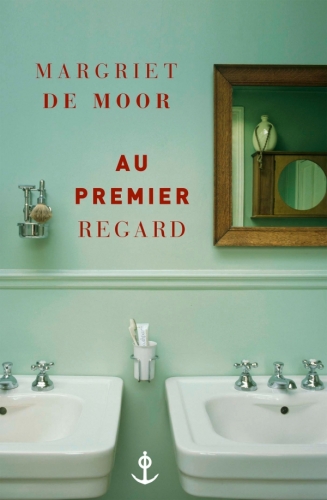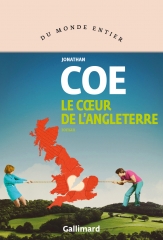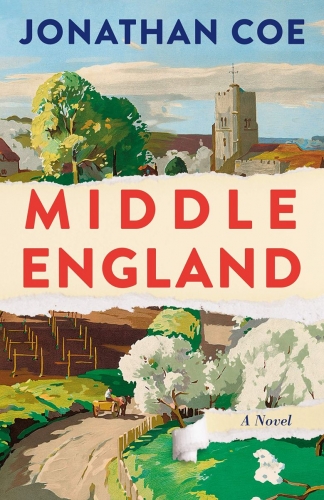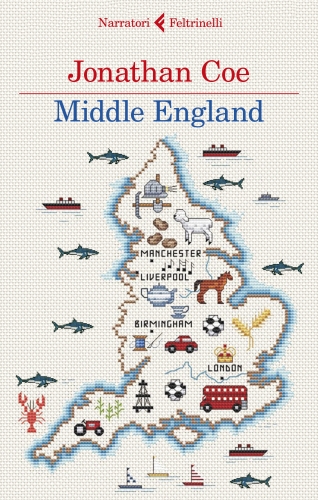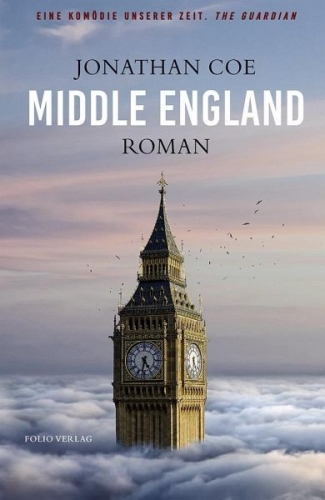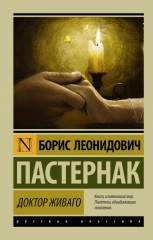Publié en 2018, Le cœur de l’Angleterre de Jonathan Coe (Middle England, traduit de l’anglais par Josée Kamoun, 2019) est une chronique des années 2010 jusqu’au Brexit. Par ses personnages principaux, Benjamin Rotter et Douglas Anderton, elle remonte aux années 1970 ; tous deux sont de la promotion 78 du Collège King William à Birmingham. Vous aurez peut-être reconnu les amis de Bienvenue au Club (The Rotter's Club) et du Cercle fermé (réunis sous le titre Les enfants de Longbridge), mais il n’est pas du tout nécessaire de les connaître pour apprécier ce roman.
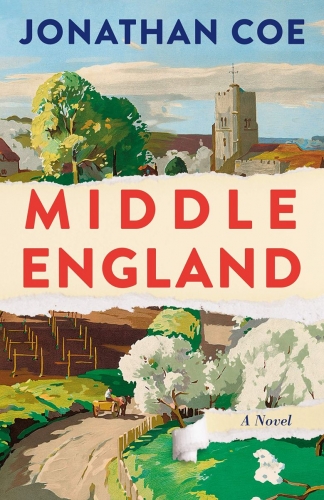
En avril 2010, Benjamin et son père quittent sans dire au revoir le pub où ils se sont réunis après l’enterrement de sa mère. Comme son père n’a pas envie de se retrouver seul, Benjamin l’emmène chez lui, dans le moulin sur la Severn qu’il a acheté après avoir très bien vendu son trois-pièces londonien. Ils y sont bientôt rejoints par Lois, sa sœur bibliothécaire, et sa fille Sophie, inquiètes qu’il ne réponde pas (il avait éteint son portable), puis son ami Doug. A son frère Paul, revenu de Tokyo, Benjamin n’a pas dit un mot, ils ne se parlent plus depuis six ans.
A cinquante ans, Benjamin vit seul dans cette grande demeure, où il rêvait de passer ses vieux jours avec Cicely Boyd, l’amour de sa vie. Celle-ci, atteinte de sclérose en plaques, est partie en Australie pour un traitement qui a bien réussi et y est restée – tombée amoureuse d’un médecin. Doug et Benjamin évoquent la situation sociale (Doug est commentateur politique), sa femme (qui ne dort plus avec lui) et leur fille Coriandre. Quand il se retrouve dans sa chambre, Benjamin peut enfin écouter une chanson de Shirley Collins (Adieu to Old England) qu’il écoutait avec sa mère, partie en quelques semaines, et pleurer tout son saoul.
Avec l’évolution de la société et de la politique anglaises, la vie de couple et la famille, la musique et l’écriture sont les principaux thèmes du roman. Sophie, la nièce de Benjamin, a connu plusieurs déceptions sentimentales ; elle rejoint souvent à Londres son ami gay, Sohan, sa seule relation stable. Décidée à rencontrer un type bien bâti qui la change des universitaires, elle aura le coup de foudre pour Ian qui anime avec Naheed des stages de sensibilisation à la bonne conduite automobile, rencontré après un excès de vitesse (58 en zone 50).
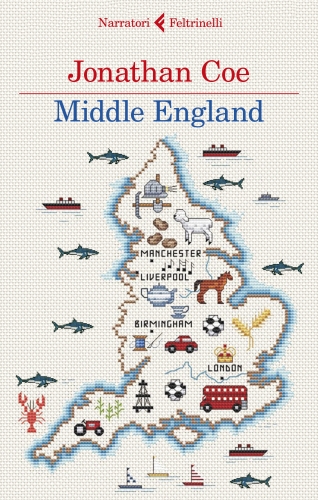
De nouvelles nominations à Downing Street amènent Doug à des contacts réguliers avec Nigel Ives, attaché de presse pour David Cameron. Quant à Benjamin, il rencontre Philip Chase, un ami devenu éditeur de sujets historiques, à la grande jardinerie Woodlands (on y trouve de tout et même un restaurant), leur lieu de rendez-vous à mi-distance entre eux. Ils s’y entretiennent avec un auteur qui a écrit un texte refusé partout à propos d’un projet d’Etat paneuropéen où « l’homme à venir serait métissé ». La question de l’immigration est un autre leitmotiv du récit.
Quand Sophie s’est installée chez Ian, elle l’accompagne voir sa mère qui est veuve, Helena. Ian lui rend visite tous les dimanches. Sophie trouve Helena, grande femme de 71 ans, « redoutable ». Elle se plaint des petits commerces d’antan qui ont disparu, s’étonne du sujet de la thèse de Sophie, une étude des portraits d’écrivains européens noirs au dix-neuvième siècle comme Pouchkine, Dumas.
Quant à Coriandre, la fille de Doug, elle est bouleversée par la mort d’Amy Winehouse. A quatorze ans, elle est en crise, ne supporte ni son père de gauche ni sa mère qui s’occupe d’œuvres de bienfaisance, ni l’école privée où l’ils ont inscrite. Quand des émeutes éclatent à la suite du meurtre d’un Noir par la police, elle y prend part, attirée par « le goût vivifiant de la colère ».
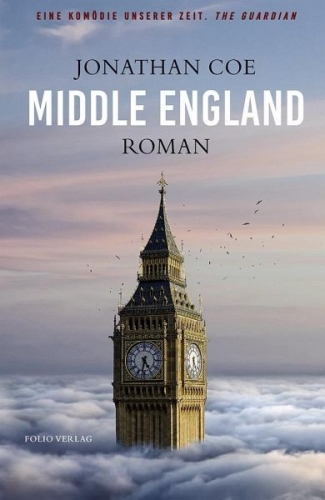
Une succession d’affrontements liés au racisme ou au refus de la mondialisation révèlent la « ligne de fracture abyssale dans la société britannique ». Au mariage de Sophie et Ian, les seules personnes de couleur sont Sohan et Naheed, assis l’un près de l’autre. Quand sa collègue Naheed aura droit à la promotion que Ian espérait, à part Sophie, tout son entourage mettra cela sur le compte du pouvoir croissant des minorités et du politiquement correct.
Depuis des années, Benjamin écrit une fresque de l’histoire européenne depuis l’entrée de la Grande-Bretagne dans l’Union en 1973 et compile des fichiers musicaux qui l’accompagnent. Sur les conseils de son ami éditeur, il renonce aux considérations « historico-politiques » et accepte de ne publier que l’histoire de son amour pour Cicely, sous le titre « Rose sans épine ». Benjamin est resté très proche de sa sœur Lois, qui a vécu un drame dans sa jeunesse, et il l’aide à prendre soin de leur père.
Voilà les principaux ingrédients que fait mijoter Jonathan Coe dans Le cœur de l’Angleterre, un roman savoureux, riche en réflexions, en rencontres des corps, des cœurs et des esprits, avec l’un ou l’autre intermède à Marseille ou en croisière sur la Baltique. A travers l’éloignement entre Londres et l’Angleterre profonde, entre les élites et le peuple, attisé par les médias, on perçoit comment le Brexit s’est imposé au Royaume-Uni et l’a profondément divisé. On y reconnaît notre époque que l’écrivain décrit avec ce qu’il faut d’ironie pour ne pas verser dans trop de mélancolie. (Un seul regret : n’avoir pas pris note de tous les morceaux musicaux cités, comme cet émouvant Envol de l’alouette de Ralph Vaughan Williams.)
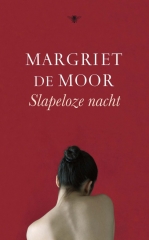 « Une fois au restaurant, nous avons commencé à parler du passé, chez nous, et nous nous sommes demandé l’un l’autre ce qui nous manquait le plus. Nos plats n’étaient pas encore arrivés mais le vin était déjà débouché sur une soucoupe en argent, il a rempli mon verre et me l’a tendu, et j’ai répondu, sans aucune hésitation : « Les petites attentions ». Et lui, qui avait l’air de venir d’une famille de sept enfants, a dit : « L’intimité. »
« Une fois au restaurant, nous avons commencé à parler du passé, chez nous, et nous nous sommes demandé l’un l’autre ce qui nous manquait le plus. Nos plats n’étaient pas encore arrivés mais le vin était déjà débouché sur une soucoupe en argent, il a rempli mon verre et me l’a tendu, et j’ai répondu, sans aucune hésitation : « Les petites attentions ». Et lui, qui avait l’air de venir d’une famille de sept enfants, a dit : « L’intimité. »