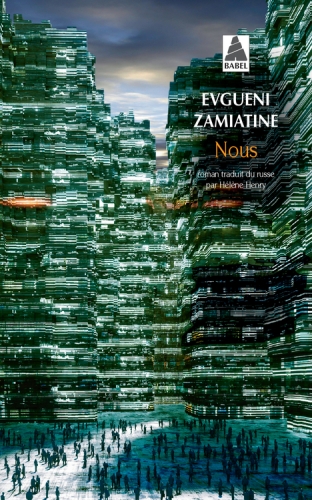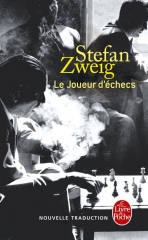Evgueni Zamiatine a écrit Nous en 1920, trois ans après la révolution d’Octobre. Ce récit d’anticipation aurait inspiré Le Meilleur des Mondes d’Aldous Huxley (écrit en 1931 à Sanary-sur-mer) et 1984 (publié en 1949) de George Orwell, qui l’a lu en français sous le titre Nous autres (première traduction en 1929). Dans un avant-propos à sa nouvelle traduction, Hélène Henry rappelle qui était Zamiatine, né en Russie en 1884 : un ingénieur naval doué et, « dès 1916, un écrivain reconnu et publié ». En 1917, il quitte le parti bolchevique dont il a d’abord partagé les idées.
L’URSS a interdit la publication de Nous. Des copies du texte ont circulé, une traduction, des extraits en russe à l’étranger : le régime soviétique engage alors des poursuites contre l’auteur d’un « infect pamphlet contre le socialisme ». Zamiatine démissionne de l’Union des écrivains et, en 1931, sur les conseils de Boulgakov, demande à Staline l’autorisation d’aller vivre à l’étranger. Il participe, comme Pasternak, au Congrès des écrivains de 1935 à Paris, où il meurt en 1937. Ce n’est qu’en 1952 que le texte complet de Nous paraît en russe, à New York. Les Russes n’y ont eu accès qu’en 1988.
« Note n° 1 » (tous les chapitres sont numérotés ainsi) s’ouvre sur un extrait du Journal officiel à la gloire de l’« INTEGRALE » dont la construction s’achève : « cette machine électrique de verre qui souffle le feu » devrait permettre à « l’Etat Unitaire » de soumettre ceux qui vivent en dehors de lui pour leur apporter « un bonheur mathématiquement exact » et « les obliger à être heureux ».
D-503, constructeur de l’INTEGRALE, ému par l’annonce, décide de prendre des notes : « Je ne ferai qu’essayer de transcrire ce que je vois, ce que je pense, ou plutôt ce que nous pensons (oui, nous, et ce « NOUS » sera le titre que je donnerai à ces notes.) » Un ciel de printemps sans nuage coule tout « dans le même cristal éternel, irréfragable, dont sont faits la Muraille verte et tous nos édifices ». Il admire le « grandiose ballet mécanique » sur le chantier.
Le « numérateur » résonne : c’est l’heure d’O-90, la femme douce et ronde avec qui il se promène durant « l’Heure privative » d’après-déjeuner, comme tous les « Numéros », en rangs par quatre, dans leurs « Tenues d’uniforme bleutées, la plaque dorée sur la poitrine – immatriculation officielle ». Il en est ébloui, comme s’il voyait ce spectacle parfait pour la première fois.
Un rire et un visage de femme aux dents « extraordinairement blanches et aiguës » à sa droite le surprennent, comme si I-330 avait deviné ses pensées. Troublé par ses remarques inattendues et gêné par l’intervention d’O-90 pour dire qu’il « est inscrit » avec elle, il a juste le temps d’entendre son invitation à la rejoindre le surlendemain à l’amphithéâtre 112 – l’Heure privative est terminée. Juste le temps d’embrasser les yeux bleus de O en attendant leur prochain « jour sexuel », où l’on peut « baisser les stores » (à condition de posséder « un billet rose »).
Le narrateur, quand il relit ses notes, a conscience de n’être peut-être pas assez clair pour les inconnus qui les liront sans connaître « les Tables du Temps, les Heures privatives, la Norme maternelle, la Muraille verte, le Bienfaiteur ». Il rappelle qu’après « la guerre de Deux Cents Ans », on a détruit les routes pour couper les villes les unes des autres et les séparer par une « jungle verte » dont la couverture de verre de la Muraille les protège. Dans l’Etat unitaire, tous se fondent dans un corps unique avec le même emploi du temps, à l’exception des Heures privatives (16-17h, 21-22h).
Ce qu’on raconte des temps anciens lui semble absurde : « Absolument ascientifique, carrément bestial. Et pour les naissances, c’est pareil : au hasard, comme les bêtes. » S’il s’est réjoui jusqu’alors de vivre dans un monde parfaitement clair et organisé, D-503 ressent pourtant des émotions nouvelles quand il se rend à une convocation pour l’amphithéâtre 112 et voit apparaître I-330 dans « le costume fantastique d’une lointaine époque : une robe noire étroitement moulante » et décolletée.
C’en est fini de sa tranquillité d’esprit. D-503 se rend un jour avec elle à la « Vieille maison » au mobilier d’autrefois, où I-330 revêt une autre tenue originale : elle aime « se distinguer des autres », « enfreindre l’égalité ». La séduction opère. Il a beau chanter les bienfaits de l’Etat unitaire, il en découvre une faille qui va en s’élargissant. Le journal signale qu’on aurait « retrouvé les traces d’une organisation jusqu’ici demeurée insaisissable, ayant pour objectif la libération du joug bienfaisant de l’Etat. » Devrait-il la dénoncer ?
Entre la description du fonctionnement qu’il juge idéal de son monde totalitaire et le récit de ses rendez-vous avec cette femme imprévisible, dont O-90 sera jalouse, D-503 se découvre un moi divisé, doté d’imagination, malade peut-être. Toute sa vie en est ébranlée, sa vision des choses, ses relations avec les autres, sa place dans la société. Osera-t-il se lier avec ceux qui se révoltent ?