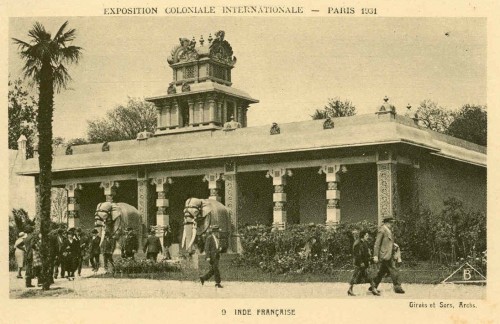Première incursion dans la littérature vietnamienne avec Terre des oublis, de Duong Thu Huong (2005). Sa défense de la démocratie lui a valu d’être exclue du parti communiste en 1990 et de vivre en résidence surveillée à Hanoi, interdite de publication. Elle envoie alors ses manuscrits à Paris, où elle vit depuis 2006. Le roman s’ouvre, comme la plupart des chapitres, sur une évocation très sensible du paysage : « Une pluie étrange s’abat sur la terre en plein mois de juin. D’un seul élan, l’eau se déverse à torrents du ciel, la vapeur s’élève des rochers grillés par le soleil. L’eau glacée et la vapeur se mêlent en un brouillard poussiéreux, aveuglant. »
Miên, partie à la récolte du miel avec d’autres femmes, s’est abritée dans une grotte. Quelque chose l’oppresse depuis le matin, elle est inquiète pour son fils que garde la tante Huyên et pour son mari, Hoan, parti en bateau pour ses affaires. Vu le temps, la journée est perdue, de toute manière. Au Hameau de la Montagne, devant sa maison sur la colline, entourée d’orangers et de pamplemoussiers, un attroupement inhabituel : un homme l’appelle, de l’intérieur, dont elle ne reconnaît pas la voix. C’est celle de Bôn, son premier mari, qu’elle n’a plus vu depuis quatorze ans, déclaré mort à la guerre. Deux ans après l’avis de décès, Miên a épousé Hoan, un riche propriétaire terrien, dont elle a eu un enfant, le petit Hanh.
« En ce temps-là, les jeunes soldats se mariaient précipitamment, juste avant de partir au front. Ils consumaient hâtivement leurs amours comme les éphémères se jettent en tournoyant dans les flammes. » Bôn mesure, à voir le luxe dans lequel vit Miên, la différence entre sa bicoque et cette vaste demeure au milieu d’une plantation. Les villageois, toujours curieux de ce qui se passe chez les autres et
envieux de la réussite d’autrui, se rangent d’emblée du côté de Bôn, qui a souffert pour son pays. Miên avait dix-sept ans quand ils se sont mariés, elle sait où est son devoir, impossible de s'y dérober, mais demande une semaine à Bôn, le temps de revoir Hoan qui va bientôt rentrer.
De jeunes volontaires communistes aident le soldat à retaper sa maison. Bôn a honte de sa sœur avec qui il cohabite, d’une sexualité débridée depuis l’adolescence, deux fois veuve, et qui élève ses enfants dans la crasse. Pour plus d’intimité, il fait construire une cloison de briques pour mieux séparer sa chambre. Sur la route qui le ramène
chez lui, Hoan, prévenu dès son arrivée au port, pense à ses parents, un instituteur et une commerçante qui l’ont forgé selon leurs valeurs : « intelligent, travailleur, bon, généreux, parfois naïf face à la vie ». Tombé très jeune dans le piège d’un mariage d’intérêt – la gérante d’une boutique l’avait attiré chez elle pour le faire boire et céder aux avances de sa fille enceinte à la recherche d’un mari –, il avait dénoncé leur union truquée dès le jour des noces et divorcé après neuf ans de vie séparée. Puis il avait rencontré Miên, son bonheur. Et voici que la fatalité les sépare. Miên essaie chacune des chemises de soie qu’il lui a rapportées, mais décide de ne rien emporter, à part des vêtements sombres. Pendant leurs derniers jours ensemble, aucune visite. « Et tout le monde traite le jeune couple comme des condamnés à mort attendant l’exécution. » Miên laisse tout ce qu’elle possède de précieux pour leur fils. Hoan l’assure que la maison sera toujours à elle et la force à accepter de l’argent. Mais elle refuse d’emporter les clés.
Chez Bôn, Miên remet de l’ordre, traque la saleté et envoie Bôn chez tante Huyên pour lui demander quelques bols et de la vaisselle correcte. Tandis qu’elle découvre le jardin en friche où plus rien ne pousse, Bôn attend impatiemment la nuit, obsédé par son désir. Quand il se jette sur elle, Miên reste froide comme une statue – « La beauté éblouissante de Miên sera comme un gouffre sans fond où il s’engloutira sans espoir de retour » – et le voilà impuissant, pour la première fois de sa vie, nuit après nuit. Son ami Xa le Borgne devine la situation et prévient Bôn : sa femme ne pourra pas vivre avec lui jusqu’à sa mort uniquement par devoir. Il lui conseille de se faire soigner la bouche – il empeste –, d’aller travailler à la plantation d’Etat, à cent kilomètres de là, et d’y refaire sa vie avec une femme revenue de la guerre. Mais Bôn s’entête. Seul l’argent de Miên leur permet de vivre décemment. Hoan, lui, est retourné en ville dans la maison de son père, que sa sœur avait divisée en deux. Il est doué pour les affaires et fait prospérer le commerce familial. Une fois par semaine, il
se rend au Hameau de la Montagne pour voir son fils.
Duong Thu Huong éclaire régulièrement le récit des malheurs de Miên et de ses deux maris par le monologue intérieur des trois protagonistes, en italiques. On comprend vite que leur situation est invivable. Liés par un amour invincible, Miên, soumise à l’opinion publique, et Hoan, respectueux du choix de Miên, attendent que Bôn en prenne lui-même conscience. Lui, malgré sa santé chancelante, ne veut pas abandonner son rêve de vivre comme avant. Il prend des remèdes pour la virilité, s’obstine à vouloir mettre sa femme enceinte pour se la lier définitivement. Le temps fera son œuvre, lentement, cruellement, jusqu’à délier un peu les peurs qui les étouffent.
Terre des oublis montre leur vie au présent, saison après saison, et plonge aussi dans les souvenirs de chacun. Les scènes de guerre qui hantent Bôn sont terrifiantes. La romancière les décrit crûment, comme elle le fait pour la violence sexuelle, en
contraste avec le lyrisme des moments de tendresse ou de fusion avec la nature, dans un style alliant force et finesse. Il vaut le voyage, ce parcours au cœur des souffrances d’un peuple et de ce trio aux prises avec la fatalité, amplifiée par les préjugés.