« Nous ne supportons plus le lierre qui nous étouffe, pensa-t-il, mais le jour vient où nous nous demandons si ce n’est pas le lierre qui soutient l’édifice de nos branches pourrissantes. »
Dawn Powell, Le Café Julien
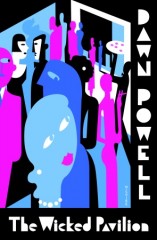
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
« Nous ne supportons plus le lierre qui nous étouffe, pensa-t-il, mais le jour vient où nous nous demandons si ce n’est pas le lierre qui soutient l’édifice de nos branches pourrissantes. »
Dawn Powell, Le Café Julien
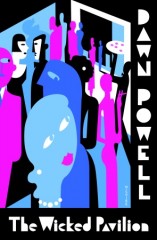
Si vous ignorez tout de la romancière américaine Dawn Powell (1896-1965), comme moi avant de lire Le Café Julien (The Wicked Pavilion, 1954), vous trouverez dans l’édition 10/18 une postface de Gore Vidal qui la présente et la défend contre les critiques qui ne lui ont pas donné sa place dans la littérature de son temps. Comme la plupart des personnages de son roman, elle a quitté la province pour tenter sa chance à New York. A Greenwich Village, où elle a passé toute sa vie, elle a fréquenté et observé le milieu des artistes fauchés et des riches mécènes qui inspire le cycle new-yorkais de son œuvre.
Le Café Julien est un lieu de rendez-vous branché : on y croise des gens intéressants, on s’y saoule de pernods ou de mazagrans, de rumeurs aussi. L’écrivain Dennis Orphen, un habitué, y écrit sans peine alors que dans sa chambre d’hôtel, rien ne sort de sa machine à écrire. Il connaît les habitudes des serveurs, ces « êtres orgueilleux, estimant que leur premier devoir était de protéger le café de ses clients », experts dans l’art de décourager les curieux.
Philippe, « le petit serveur replet aux allures de moine » a pris sous son aile le jeune Ricky Prescott qui s’évertue, chaque fois qu’il est à New York, à passer ses soirées au Julien dans l’espoir de revoir Ellenora Carsdale là où il l’a rencontrée la première fois. Sept ans avant cet hiver 1948, il est tombé amoureux et de la ville de ses rêves et de Greenwich Village et de cette fille d’artistes « incroyablement douée » avec qui le courant est passé tout de suite. Mais tandis que la standardiste annonce toutes les demi-heures un appel pour M. McGrew, Ellenora, elle, ne vient pas.
Dalzell Sloane, la cinquantaine, estime avoir échoué en amour et en art, mais il s’est laissé pousser la barbe. Il pense avec nostalgie à ses compagnons de peinture, Marius qui est mort, et Ben qui a disparu depuis des années. C’est un client de bistrot né, et quand il croise au Café Julien un grand gaillard nonchalant, qui se vante de sa forme physique à soixante ans, il le flatte volontiers, se présente, et se voit sollicité pour peindre son portrait, une aubaine. L’animation, ce soir-là, vient de la bande de Cynthia Earle, riche à millions, qu’accompagnent parasites et jeunes artistes qui offrent leur compagnie en échange de ses généreux chèques. Son ami expert en art, confie-t-elle à Sloane, est justement à sa recherche. La cote du peintre Marius ne cesse de grimper depuis sa mort, et il cherche à rencontrer ses anciens camarades dans l’espoir de retrouver quelques tableaux. Dalzell est plutôt écoeuré des éloges posthumes de Marius – de son vivant, sa grossièreté déplaisait à tout ce beau monde.
Pour compléter le tableau, voici Elsie Hookley, une riche Bostonienne qui s’amuse depuis des années à choquer sa famille, son frère Wharton en particulier, en s’encanaillant à New York. Elle s’est prise d’amitié pour Jerry, une jeune célibataire qu’elle veut lancer dans le monde. Initiée par elle, Mlle Delaine pourrait même faire un grand mariage – pourquoi pas avec McGrew, par exemple ? Jerry, ravie de profiter des largesses d’Elsie, comprendra que celle-ci a trop de comptes à régler avec la société dont elle est issue pour servir ses projets.
Il y a beaucoup de dialogues et de chassés-croisés dans Le Café Julien. Certains donnent des soirées, d’autres s’y invitent. Tout le monde veut réussir, sortir de l’anonymat. L’argent qu’on donne, l’argent qui manque, Dawn Powell en parle avec autant de précision que Balzac. Entre les hommes et les femmes, l’intérêt se mêle au désir, l’amour est rare. La comédie humaine, dans une version new-yorkaise des années 1940 pleine d’ironie et d’acuité.
« Petite lumière discrète dans les entrailles obscures d’un théâtre déserté et silencieux, la servante veille. C’est ainsi qu’on la nomme. Elle veille sur le sommeil des coulisses, sur celui de la scène où les voix se sont tues jusqu’au prochain lever de rideau, sur l’immobilité des décors, la vacuité de la salle où le public a laissé derrière lui une traîne qui flotte au-dessus des fauteuils, une note suspendue, à peine audible, qui peu à peu s’évanouit. »
Michèle Lesbre, La petite trotteuse
En quelque deux cents pages, Michèle Lesbre retisse l’écharpe de mémoire d’une autre dame qui marche, Anne, une visiteuse de maisons. Elle descend du train au début de La petite trotteuse, un roman publié en 2005. Caressant l’idée d’acheter la maison qu’elle va visiter, la trentième et la dernière, a-t-elle de toute façon prévu, elle aime surtout « explorer les lieux », s’approcher peu à peu de ce qu’elle cherche et qu’elle ne peut encore formuler clairement. Nous voilà entraînés dans son étrange parcours.
A l’auberge où elle s’installe, une femme et une jeune fille, un chat orange l’accueillent. Un homme occupe une chambre voisine, dont la porte ouverte montre une table encombrée de papiers, des livres, un petit ordinateur. « Les endroits où je ne fais que passer me procuraient une paix incomparable qu’aucun espace de mon propre univers ne m’avait jamais apportée. Le statut de nomade que j’étais en train d’acquérir depuis quelque temps devait s’expliquer ainsi. J’éprouvais à cet instant un sentiment de grande sérénité. » Quand Alex Pasquier, son voisin de couloir, apprend qu’elle va visiter la maison de La Pinède, il lui offre de l’y conduire – il l’a déjà vue, il aimerait la visiter aussi.
Anne aime observer les choses et les gens, les allées et venues à l’auberge. Souvent, quelque chose lui rappelle un autre endroit, quelqu’un d’autre, un souvenir. Un article sur Pasquier dans le journal parle de son projet : un « théâtre éphémère » sur le littoral. Tout cela l’intéresse. Le chat de l’auberge vient souvent à sa rencontre et ressuscite Izou, le chat de son père. Le premier homme qu’elle a aimé et qui lui a échappé, celui qui partageait leur vie sans partager la chambre de sa mère – il dormait dans une espèce d’alcôve, avec le chat. Dans son sac, Anne emporte toujours la montre de son père retrouvée dans un tiroir chez sa mère, arrêtée depuis des mois avec « la petite trotteuse noire » bloquée « entre le chiffre deux et le chiffre trois ».
Son père était tout mystère. Sous les plans de cadastre de son bureau, elle a découvert un jour des croquis de maisons, des ébauches – « J’aimais me glisser en douce dans ce petit secret, m’y reconnaître. » Quand Anne a visité la première maison, en décembre, elle a surpris la femme de l’agence en demandant à y rester quelques heures, le temps de s’habituer au lieu, de l’écouter, de « l’essayer, en somme… » Attirée par le bois tout proche, elle n’avait pas vu le temps passer, avait dû s’excuser quand le klaxon de la voiture l’avait ramenée à la maison où la femme l’attendait, choquée de sa désinvolture.
Cette fois, un homme l’accompagne. « Trois lignes claires, trois horizons se superposaient dans l’encadrement de la baie : l’océan, le sable, la rambarde de la terrasse. » La maison de La Pinède fait surgir le souvenir de vacances au bord de la mer – « Le passé, même lointain, est toujours tapi quelque part, prêt à bondir. » Des vacances avec ses parents, pleines de tension, qui s’étaient mal terminées. Les hommes s’en vont toujours, dans ce roman de Michèle Lesbre : le père, l’oncle André, Jules. A moins que ce ne soit elle : « J’avais déjà épousé un homme de ma vie, il y avait bien longtemps. C’était une autre histoire de laquelle d’ailleurs je m’étais échappée. »
Sur la plage, un homme a enfilé un peignoir en sortant de la mer, puis est venu vers la maison, dont il a vu la baie vitrée ouverte. Tout lui appartient, déclare-t-il à la visiteuse, dans ces pièces où il a connu un bonheur sans pareil. Avec Elise, la femme du couple qui a occupé cette maison en dernier. Pasquier, qui lui avait promis en la laissant à La Pinède de lui montrer son « théâtre éphémère » encore inachevé avant qu’elle ne parte, ne revient pas à l’heure prévue pour la ramener. Anne se laisse absorber alors par le « lointain pays de l’enfance » dont elle garde « l’image, douloureuse pour moi, d’une fillette abandonnée dans les bras de son père ».
Il y a des chats et des livres, du théâtre et des fenêtres dans le roman très introspectif de Michèle Lesbre qui navigue sans cesse entre le présent et les autres périodes de sa vie, l’enfance, mais aussi cette période essentielle, à la fin des années soixante, « celle des choix, du désir de tout changer, de tout inventer, de construire autre chose ». En quittant cette trentième maison – son père avait laissé trente dessins –, Anne se prépare à se séparer de la « petite trotteuse » de la montre paternelle et à entrer dans son propre temps.
« Cela faisait juste huit ans que Tourbine avait vu pour la dernière fois le jardin du lycée. Tout à coup, une peur inexplicable lui serra le cœur. Il lui sembla qu’une nuée noire avait couvert le ciel, qu’une sorte de cyclone était survenu et avait balayé toute sa vie comme un terrible raz-de-marée balaye les quais. Oh ! ces huit ans d’études ! Que de choses ineptes, tristes, et désespérantes cela signifiait pour une âme d’enfant, mais combien de joie aussi ! Jour gris, jour gris, jour gris, le ut consécutif, Caïus Julius Caesar, un zéro en cosmographie et, de ce jour, une haine éternelle pour l’astronomie. Mais aussi le printemps, le printemps et le tumulte dans les salles, les lycéennes en tablier vert sur le boulevard, les marronniers et le mois de mai, et surtout, éternel phare au-devant de soi, l’université – la vie sans entraves – comprenez-vous ce que cela signifie, l’université ? Les couchers de soleil sur le Dniepr, la liberté, l’argent, la force, la gloire. »
Boulgakov, La Garde blanche