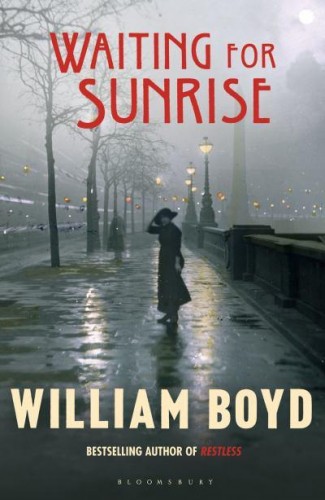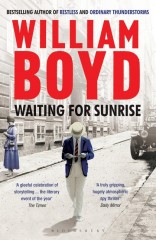Excellent cru dans l’œuvre de William Boyd, L’attente de l’aube (Waiting for Sunrise, 2012, traduit de l’anglais par Christiane Besse) raconte les aventures de Lysander Rief, acteur et espion malgré lui, entre Vienne, Genève et Londres, de 1913 à 1915.
A Vienne, en août 1913, un jeune dandy se rend à son premier rendez-vous chez le Dr Bensimon. Dans la salle d’attente, il se laisse persuader par une jeune femme elle aussi « à l’évidence anglaise malgré son teint exotique », de la laisser passer en premier, « une urgence ». Quand la porte du cabinet s’ouvre, un homme grand et mince en sort et Miss Bull, s’y précipite en pleurnichant. « Elle m’a l’air un peu dangereuse », dit le lieutenant Alwyn Munro après s’être présenté.
Rief consulte pour un problème d’ordre sexuel. Fiancé à une grande et belle actrice, il n’ose fixer la date de leur mariage à cause de ses ennuis. Bensimon lui conseille en premier lieu de noter ses rêves, ses pensées furtives, « tout et rien ». Au magasin de fournitures qu’il lui a recommandé, Lysander choisit un carnet à son goût juste avant de se retrouver en face de la petite Miss Bull, à présent souriante – sculpteur, pas sculptrice, insiste-t-elle. Elle vit à Vienne avec le peintre Udo Hoff et lui demande son adresse pour l’inviter à l’une de leurs soirées.
Dans ses « Investigations autobiographiques », Lysander Rief note le trouble né de cette rencontre. A Vienne, il préfère éviter les contacts et en particulier avec l’un des « êtres blessés, imparfaits, déséquilibrés, déréglés, malades » qui vont chez le Dr Bensimon. A la pension de Frau K, il prend des leçons d’allemand chez un vieux professeur de musique. Un lieutenant qui loge là aussi lui signale qu’il peut coucher avec la servante pour vingt couronnes. Si leur logeuse, qui classe tout en « bien » ou « agréable », représente la Vienne de surface, polie avant tout, en dessous « le fleuve coule, sombre et puissant – Quel fleuve ? – Le fleuve du sexe. »
Tôt ou tard, quand il rencontre quelqu’un, Lysander est amené à reconnaître qu’il est le fils de Halifax Rief, acteur connu, mort quand il avait treize ans. Sa mère, Lady Anna Faulkner, 49 ans, s’est remariée. Mais c’est un épisode de 1900 qui hante Lysander, un jour d’été où, surpris par sa mère – à quatorze ans, il s’était endormi à moitié déshabillé dans un bois après s’être masturbé – il se tire d’embarras en accusant le fils du jardinier, renvoyé sur le champ. Bensimon, disciple de Freud, se targue de pouvoir guérir Lysander grâce au « parallélisme », une sorte de réinvention imaginaire de l’épisode traumatisant, sujet de son « opus magnum » : « Nos vies parallèles, une introduction ».
Entretemps, au vernissage d’Udo Hoff, Lysander reconnaît l’affiche originale de « Andromeda und Perseus », un opéra de Toller, l’image provocante qu’il a vue partout déchirée dans Vienne : « une femme pratiquement nue, les mains pressées sur les seins » menacée par un dragon à la langue fourchue de serpent tendue en direction de ses parties intimes. Impossible à présent de ne pas y reconnaître Andromède, Miss Bull en personne. Celle-ci voudrait le sculpter, trouve son visage « des plus intéressants ». Lundi, 16 heures, à son atelier ? Il accepte.
Dans l’atelier aménagé dans une vieille grange, loin de la maison où elle vit avec Udo, Hettie lui sert un verre de madère avant de passer aux choses sérieuses, une fois qu’il se sera déshabillé – elle ne sculpte pas le corps vêtu. Décontenancé, ne voulant pas paraître collet monté aux yeux de cette « gamine » artiste, Lysander se soumet, s’efforce de paraître détendu en songeant à un monde parallèle. Miss Bull lui montrera son dessin, une étude très détaillée de ses organes génitaux, juste avant de l’entraîner au lit. Il surprend Bensimon, à la séance suivante, en lui apprenant que tout a parfaitement « fonctionné » avec cette femme pas du tout son genre ! Et le voilà engagé dans une liaison, à l’insu du peintre jaloux, et même après avoir découvert que le disciple de Freud fournit de la cocaïne à « l’effrontée ».
Le destin de Lysander bascule quelques mois plus tard, quand la police viennoise vient l’arrêter : il est accusé de viol par Hettie Bull, enceinte de quatre mois, c’est le peintre qui a porté plainte contre lui. Ridicule, pense Lysander, convaincu de pouvoir démontrer l’existence d’une liaison consentie, lieux de rendez-vous, billets et lettres à l’appui, mais la police ne transige pas jusqu’à ce que Munro, venu lui rendre visite en prison, l’informe que l’accusation a été modifiée en « attentat à la pudeur », ce qui autorise le versement d’une caution par l’ambassade anglaise où il sera confiné jusqu’à son procès.
S’ensuivra l’évasion rocambolesque qui ramène Lysander à Londres. Il y reçoit une facture énorme du Ministère de la Guerre qui lui sera rappelée quelque temps plus tard : Munro vient l’arracher au régiment d’infanterie où il s’est engagé. On a besoin de lui et de ses talents d’acteur connaissant l’allemand pour résoudre une affaire de courrier codé.
Lisez L’attente de l’aube pour découvrir les tenants et les aboutissants de ces complexes affaires de cœur, de sexe et de haute trahison : un suspense de plus de quatre cents pages en format de poche où William Boyd déploie tout son talent de romancier – parfait pour les vacances.